
Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Est-ce que vous pouvez situer ce livre par rapport à vos précédents ?
Maryssa Rachel : J'ai écrit trois livres sans savoir au départ qu'ils constitueraient ensemble une trilogie. État limite est à part des deux autres. J'ai commencé à écrire Décousue (5 sens éditions, 2015) à une époque de ma vie où je m'ennuyais et mon héroïne m'a permis de m'évader de mon quotidien. Je n'avais alors aucunement l'intention de le publier mais deux amis ont lu ce que j'avais écrit et m'ont encouragée à me lancer dans l'édition. C'est l'histoire de Rose, une femme qui aime faire des expériences sexuelles du côté libertin : elle exprime ainsi sa totale liberté sans que personne n'ait aucun droit de juger ses choix. Ensuite, l'histoire de Rose bascule dans Outrage (éditions Hugo & Cie, 2017) lorsqu'elle fait la connaissance d'un homme : l'un et l'autre sont autant déstabilisés par leur rencontre. À la suite de cette rencontre qui se transforme en un amour mortifère, où Rose ira très, très loin dans l’alcool et le sexe.
État limite est né de mon besoin d'offrir une suite à l'histoire de Rose, personnage qui continuait à crépiter dans ma tête. C'est assez étrange mais ce sont mes personnages qui me poussent à les écrire. J'ai cherché à la voir comme érotomane mais cela ne lui correspondait pas. Je me suis alors beaucoup intéressée aux états limites. Pour cela, je me suis complètement immergée dans le milieu psychiatrique : j'ai regardé de nombreux documentaires, je suis allée voir des professionnels de la santé (psychiatres, psychologues ainsi que des malades et des infirmiers psy). Il fallait que je sache ce qui se passait exactement dans les hôpitaux psychiatriques : j'ai alors interrogé des proches qui y travaillaient pour savoir ce que disent les malades et comment ils se comportent. Je ne voulais pas ce que livre soit un simple moment de divertissement : je voulais dénoncer certaines dérives dans le monde de la psychiatrie, son manque de personnel, et parler aussi d’une maladie que même le personnel de la santé mentale ne parvient pas trop à « cerner ». Lorsque j'avais 9 ans, mon père en raison de son alcoolisme a été interné dans des hôpitaux psy. Cette expérience m'a énormément marquée. Devenue adulte, je souhaitais réaliser un reportage photographique sur ce milieu, un truc à la Diane Arbus, mais ce n'était pas possible à cause des droits d’utilisation d’image et tout et tout. Lorsque le personnage de Rose est arrivée, j'ai entrevu la possibilité de revenir à ce thème en m'en servant comme exutoire de mon vécu personnel. Je me suis alors énormément renseignée sur le milieu psychiatrique et sur la maladie de Rose.
Cela arrivait après Outrage où Rose a été victime d'inceste. Il fallait dénoncer à travers elle toutes ces gamines victimes d'inceste qui se cachent et auxquelles on ne leur a pas offert l'opportunité de s'exprimer. Pour cette histoire, deux femmes qui ont subi l'inceste paternel et qui ont eu confiance en moi m'ont livré leur témoignage. Après les avoir écoutées, j'ai été révoltée : on ne peut pas continuellement les laisser dans le silence ! Face à de telles histoires, les gens sont confrontés à des réalités qu'ils ne veulent pas voir.
C. L. : Dans État limite l'inceste est omniprésent dans l'histoire de Rose : est-ce la continuité d'un récit qui ne pouvait encore avoir lieu dans Outrage ?
M. R. : Dans Décousue il n'en est pas question. Rose commence à en parler dans Outrage et si ce livre a fait polémique, c'est parce que l'on m'a dit que j'y faisais l'apologie de l'inceste alors que ce n'était pas le cas. J'ai terminé d'écrire État limite lorsque la grosse polémique d'Outrage a commencé. En fait, j'ai commencé à l'envers : j'aurais peut-être dû débuter avec le portrait psychologique de mon héroïne et petit à petit finir par de la douceur. Or je dresse seulement ce portrait dans État limite, livre qui peut malgré tout se lire sans connaître les précédents.
C. L. : On commence un récit avec un rapport difficile avec Rose : en tant que lecteur, difficile de l'apprécier, d'autant plus qu'elle se livre à des actes criminels, comme le fait de pousser une femme à se faire violer sous ses propres yeux.
M. R. : Déjà dans Outrage on la détestait autant qu'on l'aimait. Je commence à avoir des retours de lecteurs d'État limite qui me disent que ça leur fait peur car Rose les renvoie à des choses qui leur sont personnelles, tout en sachant qu'elle est malade : cela questionne sur leur propre intégrité psychique. Les états limites sont très compliqués à appréhender parce que même les psychiatres ne peuvent pas les mettre dans une case comme pour les schizophrènes. Si on dresse le profil psychologique d'un état limite, il est aisé de se retrouver dans certains points. Rose se fait beaucoup de mal : ce qu'elle vit est une sorte de masochisme sentimental, une façon de se dégrader elle-même lorsqu'elle donne Mia en pâture à ces hommes. Cela la renvoie à la relation avec son père qui la contraignait à se convaincre qu'elle aimerait la sexualité qu'il lui imposait. Ainsi son passé est réactualisé en elle. Dans l'hôpital psychiatrique, sous médicaments, Rose retrouve un rythme plus lent.
Je dénonce certains usages de la psychiatrie par les mots de Rose et de Simon, notamment autour du DSM. Lorsqu'elle arrête son traitement, elle a la chance de tomber sur Simon mais elle n'est pas non plus guérie. Cela montre aussi que l'on a besoin de la psychiatrie pour maintenir certains malades dans la vie. C'est pourquoi je ne pouvais pas terminer avec une note heureuse. Elle trouve son équilibre parce que Simon existe mais en son absence, la maladie reprend le dessus.
C. L. : Simon incarne à la fois le père salvateur que Rose n'a jamais eu et aussi une figure de psychanalyste qui tente de se racheter une nouvelle conduite après les excès des médicaments qu'il a prescrits à ses patients, sous l'emprise complice des firmes pharmaceutiques.
M. R. : En effet, comme il le dit : « j'avais besoin de toi comme tu avais besoin de moi » même s'il n'a pas réussi à la sauver. Lorsque dans sa lettre posthume il lui demande de ne pas sombrer, c'est une façon pour lui de partir en paix mais elle ne peut pas être sauvée. Lorsque Simon revient, c'est son père réel qui revient avec sa sexualité et toute sa monstruosité.
Ma dénonciation de l'univers psychiatrique se fait à travers le point de vue d'une malade. Ensuite, vient celui de Simon qui explique que la France est le premier pays vendeur d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. C'était important pour moi de glisser cette dénonciation de la médicamentation systématique actuelle. Si Rose expose la manipulation des médecins à son égard, Simon, en tant que médecin, montre lui aussi qu'il a été manipulé. C'était délicat à exposer mais je me suis renseignée auprès de médecins sur la réalité effective de ce sujet. Pour chaque chapitre que je terminais, j'ai demandé à un professionnel de la santé de le relire. Des modifications ont ainsi pu être apportées. Les phrases des malades qui sont d'une grande clairvoyance dans leur poésie, m'ont été rapportées par ces professionnels. J'avais besoin de leur lecture parce que le sujet était si délicat que je ne pouvais pas me permettre de faire fausse route.
C. L. : Au-delà de sa maladie, Rose est une femme artiste photographe indépendante : pourquoi l'avoir aussi caractérisée de cette manière, en lutte contre l'endormissement d'une société pétrie de conforts ?
M. R. : Pour cela, je me suis inspirée de moi-même puisque je suis photographe. Dans son cas, son indépendance économique repose sur un héritage mais dans tous les cas, être artiste à l'heure actuelle comme auparavant, c'est être considéré comme marginal. Sans l'art, nous ne pourrions pas rêver, ni évoluer, mais pourtant les artistes sont montrés du doigt. Il faut avoir les épaules sacrément solides pour pouvoir supporter ces conditions. Car on ne représente pas les clichés mêmes de la réussite. J'ai glissé cette vision sans qu'il s'agisse pour autant du sujet central du livre.
C. L. : En dialogue avec votre travail photographique, Rose cherche à photographier la beauté non lisse des femmes à travers leurs imperfections.
M. R. : Dans mon travail photographique, j'ai deux branches. Celle qui comprend la photothérapie où je propose aux personnes que je photographie de se sentir mieux dans leur tête et dans leur corps : le but est de photographier leur âme pour leur montrer à quel point elles sont belles. Ce qui est d'ailleurs complètement paradoxal avec ce que j'écris où il est question de ce qui est laid. Rose dans son art photographique réalise donc ce que je fais dans mon écriture : elle montre le « non montrable ».
C. L. : On sent à la lecture que Rose possède un charisme fort, quel que soit son état, qu'elle n'hésite pas à utiliser sur les personnes qui l'entourent.
M. R. : En même temps, je n'arrive pas à savoir exactement à quoi elle ressemble. Par moments, je vois très bien mes personnages parce qu'ils dansent autour de moi quand je suis en train d'écrire : je veux dire ainsi qu'ils deviennent parfois plus réels que certaines personnes que je peux côtoyer dans la vie réelle. Par moments, je percevais nettement Rose avec son charisme et en d'autres, elle était très floue. Je n'ai pas voulu trop entrer dans les détails de la description parce que je voulais que le lecteur se fasse sa propre vision de ce personnage. Le problème que je rencontre actuellement avec les courts métrages que je réalise autour de mes livres, c'est que je suis obligée de me mettre moi-même en scène pour éviter la situation où une actrice déciderait à la dernière minute de ne plus tourner. Certains lecteurs ont oublié que le livre est un roman et non pas une autobiographie, parce qu'ils me confondent avec Rose et les vidéos que j'ai réalisées alimentent effectivement malgré moi cette confusion. On m'imagine comme quelqu'un de transgressif, rock'n roll complètement barrée mais ce n'est pas du tout le cas. À part le fait d'avoir décidé d'être artiste, ma vie est extrêmement classique. J'ai donc longuement dû me justifier pour faire comprendre que je n'étais pas mon héroïne. Je pense que si Rose existait, je n'aurais pas eu la force de me confronter à elle, tellement elle me fait peur.
C. L. : En revanche, le fait de lui avoir écrit son histoire revient à se confronter à elle.
M. R. : Bien sûr et par moments je ne pouvais rien faire pour elle. J'ai pleuré en écrivant ce livre en pensant au fond de moi et en m'adressant à elle : « je ne peux pas t'aider ! » J'ai toujours associé la figure de l'écrivain à un Dieu qui regarde les personnages qu'il a créés et lorsqu'il observe certains tomber, il leur dit : « je ne peux rien faire pour toi ». Je ne voulais pas la condamner, je voulais qu'elle s'en sorte : j'étais accrochée à ce personnage et j'ai dû en faire le deuil. Certains amis, d'ailleurs, auxquels je parlais de mon écriture, me demandaient : « comment va Rose ? » Je me rendais compte que je la connaissais intimement... le deuil en fut d'autant plus difficile.
C. L. : État limite restera donc l'ultime volet de cette trilogie ?
M. R. : Oui et l'ensemble de ces récits aurait pu être résumé par la descente aux enfers d'une état limite. Au début de l'histoire, elle était vivante, fraîche, pleine d'humour avant de s'éteindre peu à peu. Dans Décousue, même si « la Bête » est déjà en elle, elle est encore très vivante et l'on ne sent que petit à petit sa maladie.
C. L. : Un siècle après la naissance de la psychanalyse, la remise en cause de cette discipline est forte, notamment au sujet du point de vue misogyne de Freud concernant la sexualité féminine. Est-ce aussi le constat que vous faites dans votre roman ?
M. R. : J'ai commencé à entrevoir ce sujet il y a plusieurs années en lisant Le Crépuscule d'une idole de Michel Onfray (2010) à propos de Freud. J'ai ensuite lu Le Livre noir de la psychanalyse (ouvrage collectif, 2005) et j'ai également vu des reportages où il était expliqué que les femmes étaient considérées comme « hystériques », terme qui vient étymologiquement du mot utérus. Les pratiques psychanalytiques à l'époque étaient totalement dingues : on a « soigné » des personnes avec des électrochocs ! On ne raconte jamais les résultats de Freud lorsqu'il a tenté de soigner des personnes, alors que ces résultats sont catastrophiques : il a rarement guéri ses patients. Parce qu'il avait lui-même des problèmes avec sa mère, plongé complètement dans le complexe d'Œdype, il a inventé un terme pour dire que tout le monde était comme lui. Les paroles de Freud, père fondateur de la psychanalyse, ont été prises comme « paroles d'Évangile » et les individus ont été « soignés » avec des électrochocs et des médicaments : cela continue encore aujourd'hui. Lorsqu'une personne naît avec deux sexes, c'est encore le médecin qui décide aujourd'hui le sexe qu'il conservera : ainsi, des enfants sont encore de nos jours mutilés. Alors que la sexualité est un tabou chez les enfants, les médecins n'hésite pas à charcuter le sexe de ces enfants.
J'ai été antipsychiatrie à un moment donné et je ne le suis plus à présent parce que je sais que l'on en a besoin en certains cas bien précis : l'aide médicamenteuse est alors appropriée. Je comprends que certaines personnes peuvent mettre en danger d'autres autant qu'elles-mêmes : elles ont alors besoin de médicaments pour réguler leurs humeurs. De nos jours, des médecins généralistes prescrivent des antidépresseurs et des enfants turbulents que l'on considère comme hyperactifs sont médicamentés ! On invente chaque jour de nouvelles maladies qui ne sont pas prouvées scientifiquement.
C. L. : Dans un épisode de votre livre qui se situe dans le milieu BDSM, une excision est mise en scène qui conduira Rose dans un état second à reproduire cette violence sur son propre corps. La violence du corps ne vient plus ici directement de la religion : elle est remise en scène ailleurs.
M. R. : Rose a été oppressée par la religion. C'était là une façon pour moi de dénoncer les religions lorsque leurs écrits sont pris au pied de la lettre. Tel était le comportement de la mère de Rose, complètement folle de religion. J'ai parlé avec des catholiques extrémistes et j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit que l'homosexualité était interdite par exemple. Lorsque j'ai été confronté à des religieux, il a fallu que je maîtrise leur sujet, c'est pourquoi j'ai lu la Bible et que je suis devenu athée. Alors que l'on parle d'un Dieu amour, comment peut-on détruire son enfant parce qu'il est homosexuel ?
C. L. : Dans le livre, cette mise en scène religieuse BDSM est assez intrigante.
M. R. : Le milieu BDSM d'une certaine manière est religieux. Je conseille d'ailleurs à ceux qui veulent de la littérature BDSM de lire la Bible [sourire]. Pour fréquenter le milieu BDSM, je peux attester que certaines mises en scène sont de l'ordre de la cérémonie religieuse mais sous la forme d'un jeu. Tout se passe comme si le BDSM déconstruisait les croyances à travers des jeux plus psychologiques que sexuels, à la différence du libertinage. Je voulais là aussi déconstruire certaines idées autour de ce qu'est en train de devenir le BDSM à cause et grâce à 50 nuances de Grey. Lorsque la fille se fait coudre le sexe, elle est consentante.
Rose ne supporte plus le milieu BDSM auquel elle a appartenu. Elle est donc dégoûtée de cet univers-là tout en sachant que cela procure du bien aux gens. Ainsi, des dirigeants d'entreprises et autres personnalités à hautes responsabilités sociales ont souvent besoin dans le milieu BDSM de vivre la soumission et la perte de contrôle.
C. L. : Rose suit un autre chemin inattendu : en arrêtant les médicaments en milieu hospitalier, elle réussit à se créer son propre thérapeute et à trouver ainsi un semblant d'équilibre.
M. R. : Lorsque j'ai créé le personnage d'Al, je ne savais pas encore précisément qui il était. Rose recommence ses hallucinations et même si elle pense que cette relation avec cet être est bénéfique, c'est le début d'une grosse dégringolade. Les professionnels de la santé m'ont expliqué qu'à partir du moment où la personne qui délire ne se fait du mal ni à elle-même ni aux autres, cette personne peut très bien vivre avec un traitement léger, parmi les autres dans la société. Cependant, a vision d'une société totalement saine dans Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley est angoissante. Lorsque les personnes dans la société se réveillent de leur normalité, elles en deviennent méchantes de colère. Il ne devrait pourtant pas y avoir de colère ni de haine. Je suis confiante malgré tout en l'évolution de la société lorsque je vois que la majorité des jeunes se battent contre les discriminations.
C. L. : En tant que chroniqueuse, vos livres de fiction permettent-ils de porter la voix de plusieurs milieux de personnes aux valeurs diverses ?
M. R. : J'ai toujours eu comme point d'honneur de fréquenter à la fois plusieurs milieux distincts pour pouvoir en parler. Comment pourrais-je être en mesure de parler des autres si je me fixe sur une seule communauté ? C'est ce qui me permet de parler de choses que je connais. Pour cette raison, je ne suis pas qu'auteure de fiction puisque je vais parler de milieu que je connais et qui sont réels. Je me situe ainsi davantage dans la lignée du dirty realism mais sans la moindre prétention de rivaliser avec Bukowski et Carver. J'aime montrer la face cachée de choses de la société à une époque où la littérature est condamnée à divertir et à faire rêver.
J'ai eu énormément de mal à faire éditer État limite parce que les éditeurs ne s'en donnent pas la liberté. Beaucoup de libraires ignorent même ce qu'est le dirty realism alors qu'il s'agit d'un courant littéraire en tant que tel ! En tant que lectrice, même si j'aime rêver, j'ai besoin aussi de m'ancrer sur terre et de voir la réalité cachée. Pour cela, je suis hélas obligée d'aller piocher chez les auteurs morts des années 1970.
Beaucoup d'éditeurs à l'heure actuelle m'ont dit qu'ils étaient avant tout des entreprises commerciales : nous sommes loin du souci de la découverte de nouveaux talents ! Les éditeurs que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas publier mon livre car, bien que bien écrit, il était trop sombre. Cependant, comment veulent-ils que je dépeigne la vie d'une personne souffrant de maladie psychiatrique, de dépendance à l'alcool, etc. ? On devrait laisser la liberté à chaque artiste de partager sa vision de la société. On aime les artistes que lorsqu'ils sont morts.
C. L. : La précarité des artistes est encore un sujet tabou à l'heure actuelle.
M. R. : C'est une honte en effet. Pendant longtemps, j'avais honte de dire que j'étais en situation précaire parce que je pensais que je n'allais pas être crédible en tant qu'artiste. J'ai découvert ensuite que la majorité des artistes l'étaient. Finalement, c'est cette précarité qui nous ouvre les yeux sur la réalité. Ainsi nous ne sommes plus consommateurs puisque nous ne pouvons plus consommés. La précarité en ce sens a du bon mais il faudrait que l'on ose en parler. Cependant, les artistes ne manifestent pas pour déclarer les galères auxquelles ils sont confrontés. Pendant longtemps, je me suis perdue à jouer le rôle d'une personne que je n'étais pas lorsque j'étais invitée en tant qu'artiste auprès d'huiles dans des événements médiatisés. Ainsi, avant je m'habillais en tailleur et talons, surmaquillée mais à présent lorsque je me déplace pour une séance de dédicaces, je me dis que l'on vient voir une auteure, pas une représentation de la haute société. Je n'aime pas la distance qui se crée entre les fans et les artistes. En montrant que l'on est tous au même niveau, cela permet de partager l'envie pour chacun d'oser à son tour s'exprimer et suivre un cheminement artistique. C'est sûr que c'est grisant de jouer les stars dans les festivals, mais on se perd totalement. Je suis à présent plus appréciée aujourd'hui que ce que j'ai pu l'être hier parce que je suis davantage authentique. Je sais que je ne peux pas être aimée de tout le monde : autant être vraie ! Les gens se perdent dans des rôles et ils en deviennent hypocrites et on a l'impression d'avoir en face de soi des robots. Il n'y a pas plus ingrat que l'écriture, il ne faut donc jamais imaginer que l'on sortira un best-seller et qu’on pourra s’acheter une grande maison, une grosse voiture et vivre dans l’abondance. Si les gens veulent se lancer dans quelque chose qui rapporte du fric, autant qu’ils se lancent dans la politique [rire]. On n'écrit pas pour vivre de sa passion : l'écriture est davantage une promesse de galères et de solitude. J’écris parce que c’est vitale, comme l’eau, la bouffe, le sommeil. Si on m’enlève l’écriture, je risque de crever à petit feu.
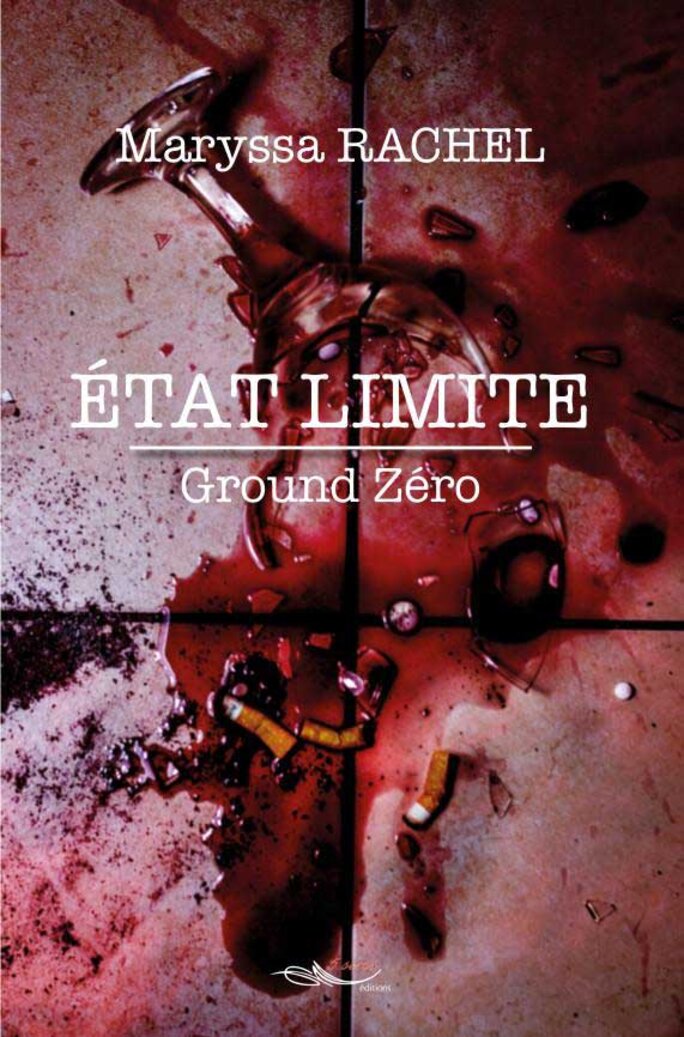
Agrandissement : Illustration 2
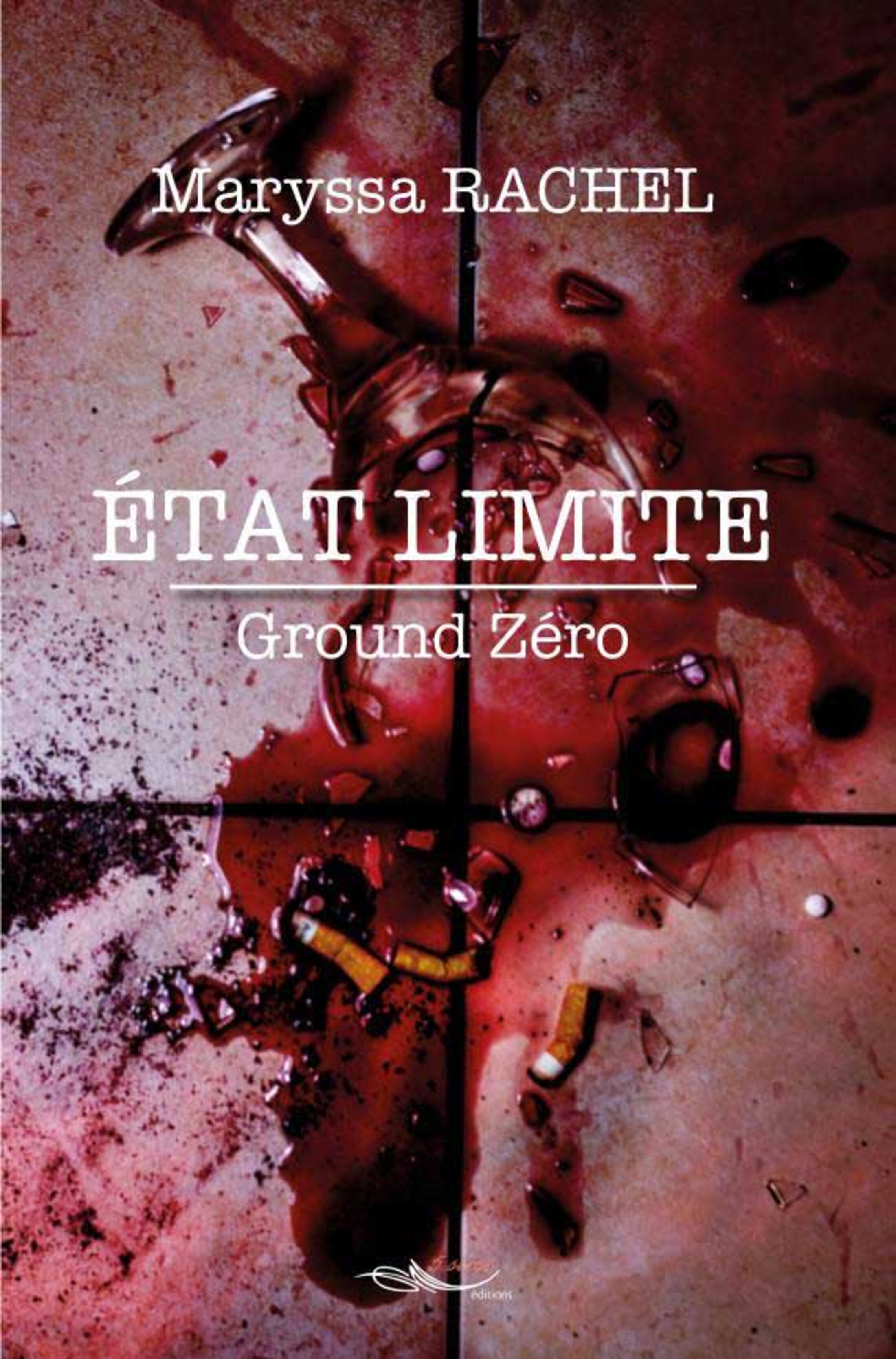
État limite, ground zéro
de Maryssa Rachel
Nombre de pages : 434
Date de sortie (France) : 28 mai 2019
Éditeur : 5 sens Éditions



