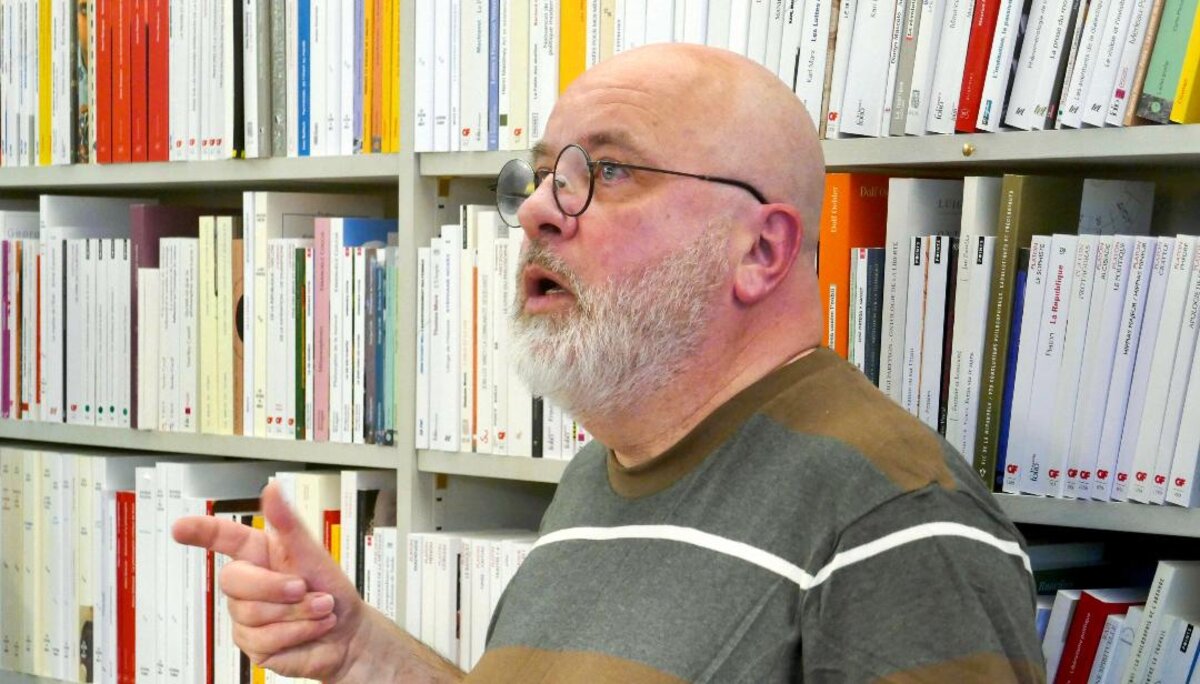
Agrandissement : Illustration 1
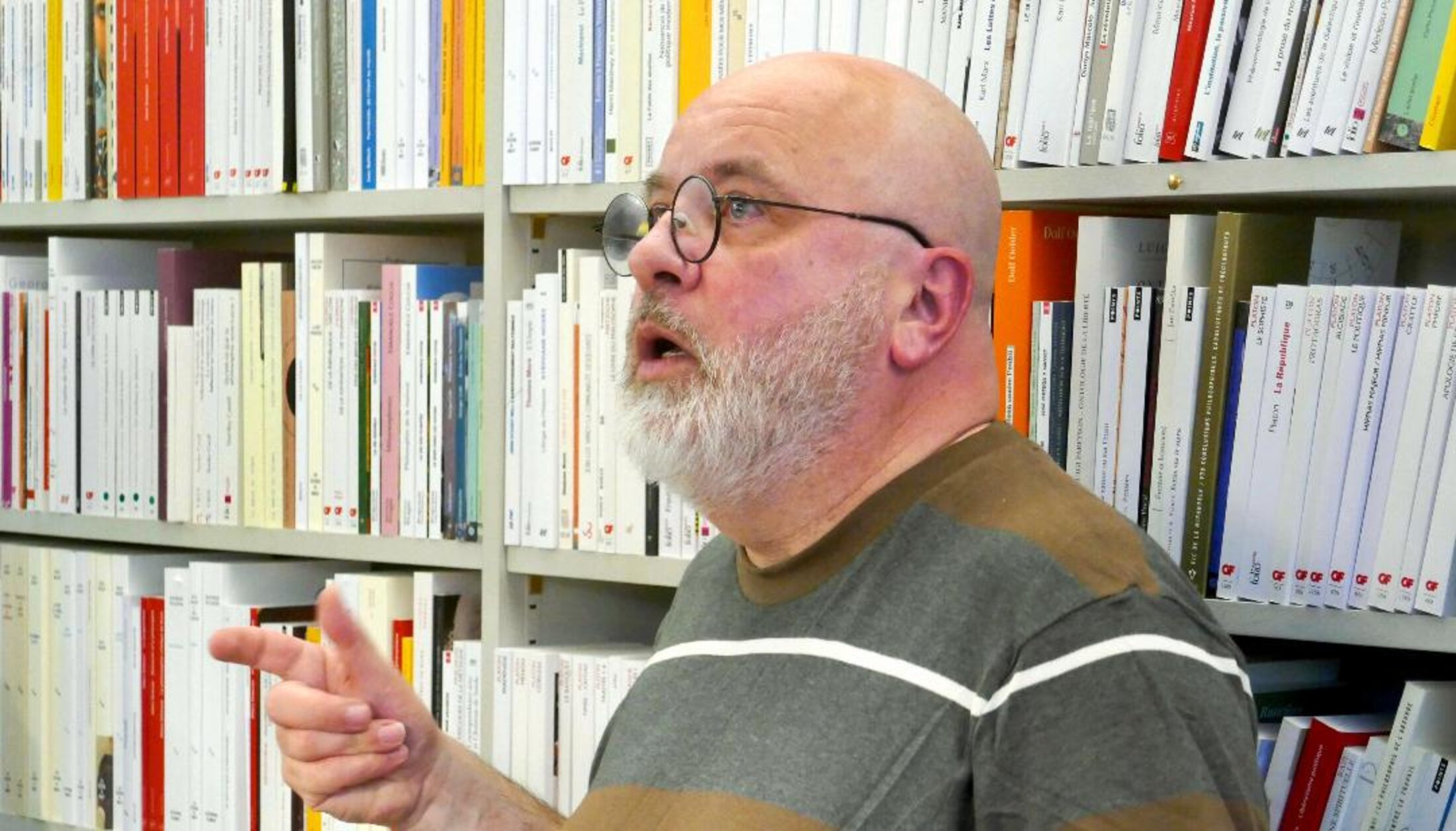
Cédric Lépine : Après le cinéma et le théâtre, quelle passion vous anime dans l'écriture ?
Noël Herpe : Le cinéma et le théâtre ont été mes passions d’enfant, d’adolescent, de jeune homme. Elles restent pour moi de l’ordre du fantasme, ou du fantôme (j’ai réalisé un film sous ce double signe). C’est-à-dire qu’elles ressortissent à la fois au passé, à un prestige qui ne reviendra jamais, et à un certain érotisme, lié à des corps d’acteurs ou d’actrices, ou à des situations. C’est pourquoi, quand je me suis confronté à la mise en scène (de théâtre ou de cinéma), çà a toujours été dans l’intention de répéter un rituel, ou de ranimer une épiphanie. C’est l’homme, par exemple, sous couvert de convoquer des problématiques contemporaines, était pour moi une grand messe, une célébration des forces obscures qui s’agitent au fond de mon inconscient (de ma mémoire). On pourrait résumer tout cela, mais ce serait peut-être trop simple, en parlant d’un rapport religieux à la représentation.
L’écriture est intervenue plus tard, comme un moyen de tenir à distance ces mirages : à travers, notamment, la critique de cinéma. Je ne crois pas avoir été un critique très professionnel, car ce que je cherchais, à travers les images, c’était surtout une affirmation fragile de ma subjectivité. Je ne cessais, en écrivant un article, de me dire qu’il y avait un autre chemin à trouver, moins tortueux, pour arriver à dire “je” sans masque. Sans le prétexte d’une fiction inventée et médiatisée par les autres.
Aujourd’hui, je ne sais pas encore tout à fait si j’ai trouvé ce chemin. Je déménage me montre déchiré, entre cette utopie de me ressaisir en tant que sujet et les “lieux communs” (décors de théâtre, scènes de cinéma), qui ne cessent de se reconstituer à chaque rencontre. Je lutte pour ne pas être pris au piège de mon personnage, et des répliques qu’il est censé dire : celles d’un homme d’une soixantaine d’années qui recherche un appartement à Paris, avec tous les pré-requis que cela comporte. L’écriture est une clé maladroite, tâtonnante, pour me réinventer.
C. L. : Quelle est la part autobiographique de ce récit ?
N. H. : J’aime que vous employiez ce mot d’autobiographie, car il n’est plus très à la mode (il renvoie aux projets scrupuleux d’un André Gide ou d’un Julien Green, qui ont été les auteurs de chevet de mes vingt ans). On préfère à présent mettre en avant l’autofiction, terme qui ne me convient guère. J’aurais le sentiment de rompre un contrat, avec le lecteur et moi-même (le fameux ”pacte autobiographique“), si je mêlais des éléments fictionnels à mes confessions. D’autant que Je déménage (comme Souvenirs/Écran) est en fait un journal qui prend la forme d’une chronique, articulée autour des visites d’appartement comme naguère des conférences en province.
Si la fiction s’invite, c’est dans les plis du quotidien. Je pars d’une déambulation très concrète, voire triviale. Je m’enfonce dans un monde dénué de toute poésie, le plus réfractaire qui soit à l’inspiration littéraire : celui des agents immobiliers ou des notaires n’a rien à envier, de ce point de vue, à celui des intermédiaires culturels engoncés dans leur rhétorique. J’épie, dans ce no man’s land, de minuscules revanches de l’imaginaire.
C. L. : En tant que spécialiste de la réflexion sur le travestissement dans les arts, pouvez-vous concevoir également un appartement comme un travestissement ?
N. H. : Je suis, plus modestement, intéressé par le thème du travestissement dans le cinéma (auquel j’ai consacré récemment un petit essai). Et je ne fais pas mystère de mon goût pour cette pratique au sens le plus large du terme : déguisements, postiches, apparitions dans des identités doubles ou multiples. J’accompagne la sortie de Je déménage d’une série de vidéos où je me mets en scène, dans des rôles que m’inspire chacun des lieux visités - de Phèdre à Paul Verlaine, en passant par Casque d’Or, etc.
C’est dire que ces appartements sont autant de décors, dans lesquels j’aimerais bien m’évanouir. N’être plus qu’un autre. N’être qu’un acteur, dans une pièce dont je ne serais pas responsable. Être débarrassé de cette intériorité qui m’encombre, pour n’exister que dans le regard d’autrui. L’acteur, chez moi, finit toujours par être rattrapé par l’auteur. Le propriétaire d’un logement a vu mon film C’est l’homme, où je me déguise en femme légère, mais c’est à Noël Herpe en chair et en os qu’il se confronte. Ce va-et-vient entre la scène et la ville est à la fois ma malédiction et mon moteur.
C. L. : Les lieux de vie sont-ils sociologiquement les décors de nos fictions ?
N. H. : Je viens d’essayer, je crois, de donner quelques éléments de réponse à ce sujet. En m’efforçant de ne pas bousculer la frontière, qui est ténue, entre ces différents registres. Le fait de m’imaginer paradant sur une scène (jouant, par delà le baratin d’un agent immobilier, la partition d’une pièce de Jules Renard) est un moyen de me mettre en mouvement, de me voiler en me dévoilant. L’imaginaire se présente sous la forme de cristaux de temps, qu’il s’agit d’arracher à leur fixité. Je suis habité par une phrase de Sacha Guitry : “La réalité, quelle qu’elle soit, est bien plus belle que l’illusion.” Cette découverte a d’autant plus de prix qu’elle est faite par un illusionniste.
C. L. : Comme votre histoire, pensez-vous que le déménagement participe à une histoire de deuil, notamment dans une histoire d'amour ?
N. H. : Mon déménagement s’inscrit clairement sous le signe du deuil, puisque je décide de quitter le rez-de-chaussée de la rue Saint-Ambroise pour m’éloigner d’une histoire d’amour terminée. En même temps, je ne cesse de revenir au passé par le rêve ; je fais durer, plus que de raison, le temps des cartons et de la contemplation des archives (qui occupe le dernier mouvement du livre), comme pour éprouver la force de liens qui n’en finissent pas de mourir. Cela va au-delà du rituel de deuil. Je trouve un certain sublime, inépuisable et sans doute mélancolique, dans la répétition de l’adieu. C’est comme si je ne pouvais éprouver mon être qu’à travers ce qu’il laisse derrière lui.
C. L. : Quelle a été votre méthode d'écriture sur ce livre : avez-vous pris beaucoup de temps pour l'écriture ? Aviez-vous l'ensemble de l'architecture de l'intrigue avant de commencer à écrire ?
N. H. : L’écriture proprement dite a dû s’égrener au long de quatre mois, à raison de trois ou quatre pages par jour. Après quoi j’ai relu, resserré, retranché des longueurs ou des répétitions. Comme je l’ai dit, j’ai conçu ce livre comme une nouvelle déclinaison thématique de mon journal : c’est-à-dire que j’ai fait le choix de vendre mon appartement, et à partir de là, de chroniquer quotidiennement les aventures dans lesquelles ce choix m’entraînait. Il n’était pas question d’une architecture d’ensemble, et j’ai veillé autant que j’ai pu, en écrivant, à ne pas fabriquer un récit a priori. Si des mouvements se dessinent, j’entends qu’ils naissent simultanément de l’expérience et du texte.
C. L. : Avez-vous eu besoin de revisiter des lieux pour écrire certains passages ?
N. H. : Non, pour les raisons que je viens de préciser. S’il y a eu revisite des lieux, c’est dans le cas où un appartement m’intéressait particulièrement. La revisite (ou “contre-visite”, comme disent les agents immobiliers) entre alors dans le livre, au même titre que n’importe quoi d’autre. Encore qu’elle soit susceptible, parfois, de produire des effets cocasses ou catastrophiques ; ainsi le retour à la rue du Puits-de-l’Ermite, qui s’achève en apothéose de mes névroses.
C. L. : Teniez-vous à réaliser un portrait de Paris à travers ce roman ?
N. H. : Ce n’est surtout pas un roman. Ou si ça l’est, je prends ça comme un compliment paradoxal.
Quant au portrait de Paris, il me semble qu’il relève plutôt de l’autoportrait. Les quartiers que j’arpente, les immeubles que je visite, me renvoient à un labyrinthe intérieur où je ne cesse de me perdre, de me poursuivre. Je m’égare dans des rues que je connais pourtant par cœur. Je me retrouve otage d’un GPS qui finit par se substituer à la réalité la plus basique.
Si je (re)découvre Paris, c’est dans les ruines d’une foule d’espaces mentaux effondrés. Je me promène avec des cartes postales intérieures, avec les projections d’une ville rêvée, qui n’existe plus que dans les pages des livres. Le choc du réel, la banalité du moment redonnent, étrangement, de la fraîcheur à ce lien. J’arrive dans un endroit que j’ai paré, par avance, de tous les clichés poétiques issus des auteurs lus ou des films vus. La démystification fatale qui s’ensuit produit une autre sorte de poésie - qui, elle, m’appartient.

Je déménage
de Noël Herpe
Nombre de pages : 160
Format : 14,10 x 20,10 x 1,30 cm
Date de sortie (France) : 4 avril 2025
Éditeur : Seuil
Collection : Nouvel Attila



