
Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Que symbolisait pour vous Godard au sein de la Nouvelle Vague avant de vous lancer dans cette recherche ?
Iris Mommeransy : J’avais découvert les films de François Truffaut avant ceux de Godard. J’aimais l’idée qu’il y avait eu, à la fin des années 1950 en France, cette jeunesse critique qui avait voulu se lancer dans la réalisation de longs-métrages et qui avaient cru à un renouveau du cinéma. J’ai mis plus de temps à découvrir Godard car c’était celui dont j’avais le plus entendu parler. Son nom évoque immédiatement une certaine idée du cinéma, du montage et de la composition de l’image. Paradoxalement, j’avais envie de garder ces visionnages pour plus tard car je savais que ça allait être une découverte immense. J’avais l’impression qu’il fallait avoir un certain bagage cinématographique pour comprendre ce que signifiait son cinéma.
Pour moi, il était le plus révolutionnaire de la Nouvelle Vague. Je pensais, à tort, qu’il en était le chef de file et qu’il était le cinéaste le plus radical du groupe. Truffaut, comme critique, a pourtant été bien plus polémique et a théorisé les principales idées du groupe notamment la politique des auteurs. En réalité, il n’y a pas de mouvement unifié dans la Nouvelle Vague. La question même d’une Nouvelle Vague comme école artistique est un débat qui a été travaillé par Michel Marie. Les idées de collectif, d’un membre fondateur, d’un membre théoricien ne sont pas tout à fait valables quand on s’intéresse à ce cinéma. On peut donc plutôt dire que Godard est monté dans le train de la Nouvelle Vague au bon moment et en a été une des figures les plus fortes notamment par une posture médiatique très travaillée.
C. L. : Quels ont été vos outils d'analyse pour développer votre thèse ? Avez-vous réalisé des entretiens avec des proche de Godard ?
I. M. : Lorsque j’écrivais mon mémoire de recherche, retranscrit dans l’ouvrage Jean-Luc Godard, cinéaste de la Guerre froide (1965-1967), je n’avais que deux ans pour réaliser mes travaux et j’avais conscience que je ne pourrai pas avoir accès à toutes les données sur le sujet. J’ai donc croisé l’étude esthétique des longs-métrages, avec le film comme première source, à une étude génétique dans les archives pour comprendre l’origine de la création godardienne. S’il n’existe pas de fonds d’archives du cinéaste, il y a une quantité de documents concernant ses films. À la Cinémathèque française, j’ai trouvé des scénarios, des feuilles de service, des photographies de plateau qui m’ont permis d’observer les films en train de se faire. Il y a aussi eu la découverte des archives du CNC, notamment le fonds d’archives de la Commission de contrôle des films cinématographiques, joli nom pour la censure, qui est une mine d’or pour comprendre la réception gouvernementale des films du cinéaste.
Dans le cadre de ma thèse, j’ai désormais plus de temps. J’ai pu aller à l’Institut Lumière à Lyon mais aussi à la Cinémathèque de Lausanne. L’enjeu est de croiser les différents regards, retrouver les documents des collaborateurs de Godard pour combler l’absence de ses documents personnels.
Rencontrer ses proches a été une idée à laquelle j’ai progressivement renoncé. Le choix de la période des années 1960 complique déjà l’accès à cette parole. J’ai aussi débuté mes recherches de doctorat au moment de la mort du cinéaste et la tentative de contacter ses proches s’est révélée difficile dans ce cadre-là. J’ai eu par exemple l’espoir d’accéder à des archives sous scellé du cinéaste, localisées dans un hangar niché dans le Cantal. Malgré des appels avec Jean-Paul Battaggia, son ami et dernier producteur, et des échanges de mails réguliers avec Wild Bunch, la société de production qui en avait les droits, le projet n’a pas pu aboutir.
Heureusement, les témoignages de ses proches ont été multiples depuis les années 1960 et demeurent une source précieuse. Les universitaires qui ont beaucoup travaillé sur Godard ont aussi pu me conseiller dans ma démarche, notamment Antoine de Baecque, qui en a été le biographe et qui a été en contact avec ses proches. J’arrive donc après beaucoup de travaux et toute une nébuleuse de personnalités qui ont entouré Godard. Il faut se faire sa place petit à petit et garder une rigueur scientifique en sachant ce qu’on mobilise comme sources, sans paraphraser ce qui a déjà été écrit.
C. L. : En quoi le parti pris politique de Godard peut-il être le reflet d'autres cinéastes à la même époque ?
I. M. : Si on s’intéresse aux années 1960, et plus particulièrement à cette courte période allant de 1965 à 1967, Godard dénote par la récurrence de certains de ses sujets. Le Vietnam, l’impérialisme américain, la jeunesse militante sont des thèmes qu’il ne cesse de travailler.
Il me fait penser à Chris Marker qui, dès 1962 dans Le Joli Mai, tentait de comprendre cette jeunesse française après la guerre d’Algérie. En 1967, Chris Marker dirige le film collectif Loin du Vietnam dans lequel Godard réalise le court-métrage Caméra-Œil. Ils se retrouvent sur ces questions d’engagement et vont par la suite réaliser des ciné-tracts pendant mai 68. Pourtant, le parcours de Chris Marker, ancien Résistant et documentariste, est plus clair que Godard. Godard surprend par la manière dont il évolue rapidement sur ces questions dans la décennie alors qu’il n’était absolument pas politisé à la fin des années 1950.
En 1969, un cinéaste comme Costa-Gavras propose avec Z un film qui est aussi éminemment politique. Pourtant, dans la forme, il est aux antipodes des idées de Godard. Costa-Gavras choisit la clarté, le respect d’une narration classique là où Godard entend repenser un cinéma politique par des formes nouvelles.
C. L. : Cette transition du cinéaste vers un autre cinéma notamment avec le groupe Dziga Vertov vient-elle seulement de sa rencontre avec Anne Wiazemsky ?
I. M. : La transition de Godard ne saurait se résumer à sa rencontre avec Anne Wiazemsky. Son goût pour tout ce qui se transforme, tout ce qui constitue une actualité le mène inlassablement à changer de milieu et à découvrir de nouveaux groupes dans les années 1960. Chaque mutation sociale correspond à une petite révolution personnelle chez le cinéaste. Anne Wiazemsky a plutôt été un vecteur de ce cheminement car elle lui a permis d’avoir accès à certains milieux qu’il méconnaissait. En étant étudiante à Nanterre, elle a pu lui présenter le groupe des anarchistes. La Chinoise aurait d’ailleurs dû porter sur eux mais il a finalement choisi de montrer les jeunes maoïstes. D’ailleurs, ses obsessions politiques vont rendre le quotidien du couple plutôt difficile et Anne Wiazemsky l’a très bien raconté. Pour ceux qui, comme Godard, voulaient être parfaitement contemporains des événements à la fin des années 1960, la politisation et le militantisme étaient en quelque sorte inévitables.
Dans le collectif Dziga Vertov, il collabore étroitement avec Jean-Pierre Gorin. Il sera son duo dans le groupe. Godard a besoin de ces associations intellectuelles pour nourrir sa création tout en restant profondément personnel dans sa manière de penser le film. Anna Karina avait été plus tôt dans la décennie une de ces figures.
C. L. : Comment en êtes-vous venue à vous intéresser au sujet développé dans ce livre ?
I. M. : Des trois films traités dans l’ouvrage, c’est Masculin Féminin que j’ai vu en premier. Le carton inséré dans le film « Les enfants de Marx et de Coca-Cola » m’est resté en tête et j’étais habitée par cette idée d’une jeunesse divisée par les idéologies de Guerre froide. Historiquement, cette période me fascine par l’ambiguïté qu’elle souligne. Le milieu des années 1960 correspond à une période de Détente du conflit, tel qu’il a été délimité par les historiens, mais la société reste structurée par les influences contradictoires de la pensée américaine (un capitalisme alléchant qui use de la société de loisirs pour attirer la jeunesse) et de la pensée de l’Est (l’idéologie communiste qui devient un terrain d’engagement pour beaucoup).
Je voulais comprendre comment Godard, Franco-Suisse de 35 ans au moment de la sortie de Pierrot le fou, se situait par rapport à ce conflit. Ce n’était pas seulement ce qu’il en disait et montrait à l’image mais ce que lui, en tant que citoyen et artiste, signifiait pour une telle période.
Le choix d’une étude très resserrée, en trois films et trois ans, reposait sur l’idée de faire un gros plan sur ce temps court, ce temps de fluctuation. Je suis très intéressée par les travaux de micro-histoire qui vont se centrer sur des vies anonymes et des parcours individuels à très grosse échelle (dans le sens géographique, donc un point de vue très réduit). Ici, ce n’est pas de la micro-histoire et Godard est loin d’être un inconnu mais je voulais réintroduire de l’infime, ou au moins du plus petit, dans une œuvre gigantesque.
C. L. : Quel est le sujet de votre thèse à l'heure actuelle ?
I. M. : Je travaille maintenant sur l’ensemble de la décennie en commençant par À bout de souffle (1960) et en terminant avec Week-end (1967). Je m’intéresse toujours à l’actualité politique présente dans les films mais je me concentre sur l’approche esthétique qui en est faite. Le contexte historique est donc toujours fondamental mais je laisse plus de place à l’étude de la mise en scène. Godard détourne les événements politiques et tâche de les réécrire dans ses films par le prisme du jeu. Il y a une dimension ludique très forte dans son œuvre avec des personnages qui s’amusent mais aussi qui jouent comme au théâtre. Il s’agit donc de replacer Godard dans une histoire de l’art plus large en observant la manière dont l’espace du jeu et le rire revisitent l’actualité.
Je travaille beaucoup sur la dimension burlesque de ses films qui a été encore peu étudiée concernant les années 1960. Godard aime Brecht et les burlesques américains. Il mêle donc l’esprit du gag à la distanciation et c’est ce qui fait la richesse comique et réflexive de ses longs-métrages.
C. L. : Que pensez-vous de l'héritage qu'a permis ces trois films ?
I. M. : La question de l’héritage est toujours difficile dans le cas de Godard. Les propositions formelles des trois films sont très prononcées. Dans Pierrot le fou, la couleur explose et les collages s’enchaînent. Dans Masculin Féminin, au contraire, il y a cette distance des entretiens face caméra, ce noir et blanc grisâtre qui constituent aussi une certaine radicalité artistique. Dans La Chinoise, cette fois-ci c’est le rouge qui submerge le film et toutes ces saynètes théâtrales qui déconstruisent l’idée d’une narration classique possible au cinéma. Il serait risqué de vouloir simplement reprendre ces différents procédés sans tomber dans la caricature.
Leos Carax est pour moi un des héritiers actuels les plus illustres de Godard, d’autant plus qu’il l’a connu. Il ose aller du tragique au comique comme dans Annette et le résultat est merveilleux. Il s’autorise aussi à aller dans le burlesque voire même le farcesque. Son dernier film, C’est pas moi, est un immense hommage au travail de montage et de collage de Godard.
Plus largement, je pense que les trois films ont concrétisé l’idée de ce qu’était un auteur de cinéma en France, quelqu’un qui entend modifier les formes et la grammaire du cinéma en lien avec ses engagements. Trouver une mise en scène qui corresponde à un idéal politique, telle a été la recherche de Godard et je crois que c’est une question qui demeure profondément actuelle.
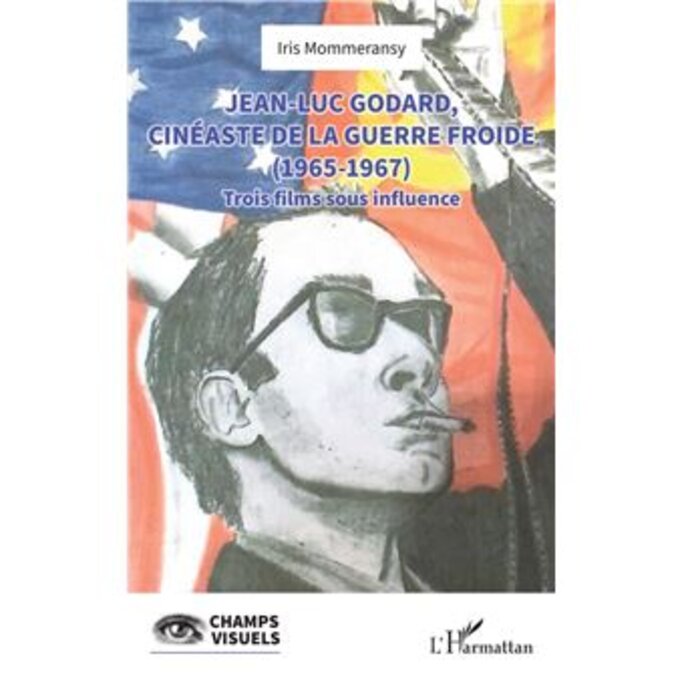
Jean-Luc Godard, cinéaste de la Guerre Froide (1965-1967). Trois films sous influence
d'Iris Mommeransy
Nombre de pages : 144
Format : 135 x 215 mm
Date de sortie (France) : 11 juillet 2024
Éditeur : L'Harmattan
Collection : Champs visuels



