
Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Pouvez-vous préciser l’importance de l'écriture dans votre vie ?
Caroline Hoctan : Comment dire l’importance de l’écriture, c’est-à-dire au fond de la littérature, dans ma vie autrement que ce que Kafka déclarait lui-même : «Je haïs tout ce qui n’est pas littérature»? Depuis longtemps, je ne vis donc que pour «ça». Cette obsession remonte à l’âge de 15 ans lorsque j’ai lu le Journal de cet écrivain alors même que je n’avais jamais rien «lu» auparavant, puisque, ce que je pouvais étudier au collège - le plus souvent des œuvres académiques, aussi poussiéreuses que désincarnées au regard du «réel» d’une jeunesse perdue en grande banlieue - me tombaient des mains et ne me parlaient absolument pas : ni du monde, ni de la vie, ni de l’essentiel, ni même de la « langue » qu’il m’aurait fallu alors appréhender autrement pour en saisir toute la dimension et l’importance absolue dans l’accomplissement d’un être.
C’est lorsque j’ai arrêté ma scolarité - après le collège - poursuivant un apprentissage en librairie (donc bien avant de poursuivre un doctorat à la Sorbonne) - que j’ai découvert la littérature, et tout d’abord cette littérature française que le système éducatif se garde bien d’enseigner et dont il nous détourne sournoisement, à savoir ces œuvres « coup de poing » qui m’ont marquée au fer rouge durablement et m’ont formée au-delà de ce que toute éducation scolaire du « système » aurait pu faire - je le sais aujourd’hui ô combien.
Ces lectures déterminantes m’ont apportée des outils de conscience et de critique incomparables et irremplaçables pour la jeune personne que j’étais alors. Pour donner des exemples de ces œuvres françaises significatives d’un point de vue psychologique et cognitif, de ces œuvres émancipatrices, fondatrices et structurantes au regard du néant duquel je sortais - je citerai : Ma mère et Le Bleu du ciel de Georges Bataille, Les Corps étrangers de Jean Cayrol, Les Cavaliers de Joseph Kessel, Thomas l’obscur de Maurice Blanchot, L’Apprenti sorcier de François Augiéras, La Fosse de Babel de Raymond Abellio, Le Mont analogue de René Daumal, Alexis ou le Traité du vain combat de Marguerite Yourcenar, Vivre à Madère de Jacques Chardonne, L’Ombilic des limbes d’Antonin Artaud, Le Ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras, Tombeau pour cinq cent mille soldats de Pierre Guyotat, Moravagine de Blaise Cendrars, Le Visage émerveillé d’Anna de Noailles, Paludes d’André Gide, Les Pétroleuses d’Edith Thomas, Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq, La Guérison sévère de Jean Paulhan, mais aussi des œuvres plus contemporaines comme Les Aventures singulières de Hervé Guibert, L'Opoponax de Monique Wittig, Les Corps conducteurs de Claude Simon, Sur la terre comme au ciel de René Belletto, Lisbonne, dernière marge d’Antoine Volodine, Selva Oscura de Jack-Alain Léger, L'Équipée malaise de Jean Echenoz, L’Ange des profondeurs de Serge Lehman, L'Invention du monde d’Olivier Rolin, Les Racines du mal de Maurice G. Dantec, Garichankar de Michel Jeury, L'Occupation américaine de Pascal Quignard, Le Livre des ciels de Leslie Kaplan, L'Histoire du futur proche de Roland C. Wagner…
Je pourrais vous citer tout autant d’œuvres anglo-saxonnes, russes, allemandes, portugaises, italiennes, hispaniques, asiatiques et belges… Mais il est vrai que ce sont ces œuvres d’auteurs français qui m’ont indiquée, au départ, une voie à suivre, voie que je vous avouerai avoir suivie pourtant en véritable aveugle, en quasi analphabète, puisque comme l’a souligné avec justesse Maurice Blanchot – et je m’en rends compte chaque jour qui passe - nous ne savons toujours pas lire ! Alors quant à savoir écrire… c’est le problème auquel je me confronte et tente de résoudre depuis, sans savoir, d’ailleurs, si je parviens à quelque chose…
C. L. : Comment se place ce troisième roman par rapport à vos deux précédents ?
C. H. : La Fabrication du Réel n’aurait pas dû être mon troisième roman. Après le deuxième, Dans l’existence de cette vie-là, j’étais partie dans l’écriture d’une fiction que j’avais intitulée Mondialistan et qui - pour aller vite - était une sorte de déambulation quasi névrotique ;-) au cœur de la pensée même du système concentrationnaire et mondialisé du « capitalisme tardif », et qui avait pour objectif de relater fictionnellement les conséquences extraordinairement destructrices des opérations d’une sorte de génie mi-angélique mi-démoniaque que j’avais rencontré dans le milieu de la haute-finance à New York entre 2004 et 2006, lors de la crise des subprimes qui allait engendrer le krach économique mondial de 2008. Mais, pour des raisons liées à des événements personnels survenus tout au long de l’écriture de mon deuxième roman dont la rédaction a duré 7 ans – donc, après le décès de mon père, la découverte de son passé comme officier traitant dans l’Alliance atlantique, mon départ précipité et définitif de Paris, mais aussi le suicide, traumatisant à mes yeux, de Jack-Alain Léger, écrivain que j’admirais beaucoup, etc. – il s’est passé une sorte de retour de boomerang de toutes ces années sur ma psyché, une fois la publication de Dans l’existence de cette vie-là (2016) survenue.
Ayant refoulé ces événements en grande partie pour tenir le coup et aller au bout de ce deuxième roman tentaculaire, ceux-ci ont fini par me rattraper et ont eu l’effet d’une cocotte-minute qui m’a sautée en pleine figure, particulièrement les événements liés au passé de mon père qui n’ont trouvé à se résoudre que plus d’un an après la publication de ce deuxième roman, c’est-à-dire en 2017 alors que j’entamais précisément l’écriture de Mondialistan… Et sans que je ne puisse l’expliquer davantage, la résolution de ces événements m’a poussée à réfléchir à la « nature » même de ces derniers et m’a poussée à écrire - envers et contre tout - La Fabrication du Réel comme pour mieux me purger de ces années d’angoisse que ceux-ci avaient pu générer.
C’est ainsi que je suis parvenue, d’abord à les dépasser, puis à les regarder en face, et enfin – le plus difficile par rapport à la situation qui était la mienne - à les accepter. Pour le dire autrement - et malgré les nombreuses difficultés que cela a posé – il a fallu que j’accepte ce passé, que j’accepte ma situation résultant de ce passé, que j’accepte que ces années aient été celles-là et non d’autres, que j’accepte les choix de mon père une fois pour toutes, que j’accepte, j’accepte, j’accepte ce qui était, et non pas ce qui relevait de la légende et de l’hypocrisie sociales…
Il m’a fallu accepter non pas seulement pour sauver ma peau, mais pour accepter tout simplement de continuer à vivre... Ainsi, il m’a fallu réussir cette délicate opération de « rompre » avec moi-même, c’est-à-dire avec ce petit ego qui vous pourrit la vie, et qui, si vous ne vous en débarrassez pas en tranchant dans le vif, vous confortera en tant que victime, puis victimo-frustré, sinon hystérico-victimaire, ou alors vous transformera en un véritable body snatcher de la Matrice... Je n’ai pu parvenir à m’extraire du conditionnement socio-culturel qui était le mien que par une sorte d’abnégation, mais aussi parce qu’un ancien collègue de mon père dans le Renseignement, m’y a aidée, sans doute par fidélité pour mon père aux côtés de qui il avait lui-même traversé tant d’épreuves lors de leurs missions communes en Europe (entre 1970 et 1989), mais sans doute aussi par compassion pour moi. Cet homme m’a ainsi proposé une issue pour sortir du blocage existentiel dans lequel je me trouvais. Certes, une issue difficile et risquée, mais qui s’est avérée la seule possible pour me libérer du passé, pour vivre ma propre vie, et non pas une de ces vies par procuration qui aurait inévitablement débouché dans un vide existentiel encore plus grand et intenable, au point de me pousser à suivre le chemin de Jack-Alain Léger...
Il y avait dans le suicide de cet écrivain quelque chose qui résonnait en moi du fait que sa « chute » me ramenait alors à celle de « L'homme qui tombe » des tours jumelles du World Trade Center, à la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001, et dont l’image m’obsédait alors littéralement comme parabole du vide existentiel dans lequel je me sentais dégringoler moi-même sans cesse. J’aurais donc mal fini, c’est évident.
Pour revenir à votre question, si La Fabrication du Réel occupe la place de troisième roman aujourd’hui dans mes publications, il me semble toutefois être plutôt une sorte d’addenda à mon deuxième pour la simple et bonne raison qu’il en est son « arrière-cuisine », à savoir la face B de cette vie de « façade » que je relate tout au long de Dans l’existence de cette vie-là, non pas que cette vie ait été une sinécure, mais disons qu’elle ne dit rien de la réalité que je vivais alors. Ainsi, lorsque j’évoque le roman intitulé L’Exviela dans La Fabrication du Réel, ce n’est qu’en référence à Dans l’existence de cette vie-là. Voilà pourquoi - dans mon esprit – ce troisième roman est davantage mon deuxième roman et demi ! Enfin, pour conclure sur sa place, somme toute arbitraire au sein de mes rares publications, je dirais que mon premier, mon deuxième et ce deuxième et demi reposent sur des réflexions (l’identité et le Neutre, le mensonge familial et la vérité littéraire, la problématique de l’écriture et de la subsistance, la figure du père et le nœud œdipien à ma langue paternelle, le destin et la perte, la « vraie vie » et la servitude volontaire, etc.) qui forment un tout où ces romans se répondent pour tisser la somme d’une quête sans fin - du moins qui m’a occupée quasi trois décennies durant - et qui, avec La Fabrication du Réel, s’est refermée, d’autant que le manuscrit a été achevé il y a déjà six ans…
C. L. : Est-ce que l'élaboration d'un « squelette » sur lequel reposent les muscles de votre pensée a été le préalable à la naissance de La Fabrication du Réel et vous a-t-il fallu longtemps pour en aboutir l’écriture comme pour faire publier le livre ?
C. H. : Non, ce roman est advenu d’un seul jet, sans plan ni recherche - à la grande différence du deuxième. Il a été rédigé dans une certaine fièvre d’écriture et de libération, entre l’été 2017 et l’hiver 2018. Je l’ai remis début 2019 à mon éditrice de l’époque, dès son achèvement et la première mise au propre du tapuscrit. Mais il ne s’est rien passé : en fait, l’éditrice en question ne m’a rien dit de plus que « nous allons droit dans le mur » avec un tel projet - sous-entendant même presque que c’était… peut-être pas un navet, mais un poireau !
Puis, elle a disparu d’une manière assez pathétique, bien que rétrospectivement, il me semble que ça en est presque drôle, non pas que ça puisse faire rire quiconque - justement c’est vraiment pathétique humainement parlant - mais ça en est presque drôle par rapport à l’éthique même de la littérature, à son intuition profonde, à ses valeurs intrinsèques, à son éternité, qui n’ont rien à voir, mais alors rien à voir avec cet étrange décalage, ce malaise diffus, cette hypocrisie manipulatoire, ces échanges superficiels et toujours courtermistes que j’ai pu vivre avec elle, et cela au fond dès notre rencontre au moment de la publication de ce deuxième roman. Certes, la situation - vu ce que j’avais pu traverser de mon côté - me faisait sourire, et je jouais le jeu bien évidemment, comme je l’aurais fait avec n’importe quel agent Smith du market qui ne connaît que deux réalités, celle de ses présupposés et celle qu’affiche son tableur Excel, mais qui - du fait que j’imaginais la relation avec un éditeur comme quelque chose d’un peu plus « sérieux », à savoir même un peu plus « sacré » - me laissait, chaque fois que j’avais à faire à elle, un goût assez amer. Et je ne l’ai vue que cinq ou six fois tout au plus, c’est dire !
À ce moment-là - c’était presque l’été 2019 - je me suis décidée d’envoyer le manuscrit à d’autres éditeurs, notamment sous le titre de L’Invention de Melmoth, pour éviter d’ébruiter trop son véritable titre auquel je tenais. Le squelette de ce manuscrit était alors constitué de 23 chapitres d’un seul tenant. Comme mes démarches n’aboutissaient pas et que nous avons bientôt été confinés pour cause de pandémie, le manuscrit est resté en rade pendant trois ans – 2020, 21, 22 – sous cette forme avant que, sur les conseils d’un ami, je ne redécoupe ce squelette de 23 chapitres in extenso en 23 paragraphes chacun (ce nombre participant de « l’intrigue »).
C’est là que, en juin 2022, un agent littéraire - Olivier Rubinstein - enthousiasmé par sa lecture, m’a proposé ses services pour le faire publier et pouvoir me représenter par la suite. Pour lui, il n’y avait pas l’ombre d’un doute que ce manuscrit allait passionner les éditeurs qu’il visait. Mais l’année 2022 et 2023 se sont écoulées sans qu’il ne parvienne à le placer nulle part ! C’est dire encore, non seulement l’état de déliquescence de l’édition actuelle, mais surtout le niveau de désenchantement et de mocheté de la grande majorité des éditeurs, plus préoccupés à forer dans le cul du superficiel qu’à servir la littérature coûte que coûte, et dont on ne saurait trop recommander de prendre le contre-pied du « système » en cherchant notamment à réinventer le métier, ou bien alors simplement à changer d’activité.
C’est finalement à la faveur d’une rencontre inattendue à l’automne 2023 avec les éditions Tinbad que La Fabrication du Réel a trouvé le bon éditeur. Le manuscrit a été accepté en dix jours à peine, et a été publié ce printemps 2025 tel quel - évidemment sans les fautes et inévitables lourdeurs qui le parsemaient encore, mais il n’a subi aucun remaniement dans sa forme ni dans son fond. Et alors que je vous écris aujourd’hui, je reçois le message d’une grande éditrice comme il n’en existe que peu dans ce pays - Colette Lambrichs – qui m’écrit : « Je viens de terminer ton livre et je suis impressionnée. Tu abordes des questions fondamentales si difficiles à rendre perceptibles et qui sont pourtant l'arrière-plan de moins en moins masqué des sociétés dans lesquelles nous vivons. C'est un grand et magnifique bouquin qui restera en dépit de l'occultation dont il est l'objet ». Elle vient d’ailleurs de me racheter les droits de mon premier roman, Le Dernier Degré de l’attachement ainsi que de mon deuxième - droits que j’avais réussi à récupérer… très discrètement, comme on dit - et elle s’apprête à les rééditer prochainement, le premier préfacé par Éric Marty et le deuxième par Cécile Guilbert.
C. L. : Quels ont été les univers de fiction que vous avez aimé convoquer et questionner dans ce roman ?
C. H. : Je ne saurais vous répondre, sinon que mon projet d’écriture en général ne s’inscrit ni dans l’Autofiction ni dans le Testimonial, mais dans ce que Serge Lehman a eu la pertinence de nommer l’Ontofiction. À la manière d’un Michel de Montaigne, d’un Marcel Proust, d’un Michel Leiris, d’un Louis-Ferdinand Céline ou d’un Robert Musil, mes œuvres procèdent donc de ma propre praxis existentielle, de mes propres expériences, que je fictionnalise au sein de récits toujours intriqués à la littérature elle-même, que ce soit à son histoire, sa critique, ses différents courants, ses techniques narratives, ses jeux de langage, sa langue même, celle évidemment qui découle du « Verbe » et non d’un quelconque storytelling ou SVC (Sujet, Verbe, Complément) formaté au présent de l’indicatif.
Ainsi, mes romans tentent à se fondre dans la Parole même de la littérature qui n’est autre que la Voie/Voix de tous les auteurs qui m’ont précédée et dont les œuvres sont souvent indépassables, dans tous les cas, si essentielles qu’il ne peut y avoir d’autres modèles à mes yeux. Un véritable roman – depuis les bons soins de Miguel de Cervantes et de Laurence Sterne, ou encore de nos jours, de Shozu Numa ou d’Alasdair Gray - ne peut s’inscrire que dans les pas de ses prédécesseurs, c’est-à-dire dans la littérature elle-même, à savoir être la résonance des œuvres, des auteurs, des courants et des formes qui la constituent. Voilà pourquoi un « univers de fiction » ne veut rien dire pour moi qui écris toujours depuis un « ailleurs » que celui de mon pays : soit il s’agit d’une œuvre de littérature, soit il s’agit d’une marchandise. Penser en termes « d’univers de fiction » prouve seulement notre conditionnement à la sectarisation et à la qualification établies par le système marchand qui étiquette les œuvres selon des critères arbitraires qui ne correspondent qu’au besoin du marché, sinon aux velléités du marchandising.
Autant me confesser donc : je ne pense jamais « genres » - quels qu’ils soient, et dans tous le sens du terme ! D’ailleurs, pour moi, si des genres comptent, ce sont essentiellement ceux du narratif, du poétique, du théâtral, de l’épistolaire et de l’argumentatif. Ainsi parler de nos jours de « littératures de l'imaginaire » ou de « genres » - voire de sous-genres qualifiés de « mauvais genres » parfois - comme l’Anticipation, le Noir, l’Espionnage, etc., me semble être, à la fois, une tautologie et un oxymore. En effet, aucune œuvre littéraire digne de ce nom ne peut être exempte d’imagination ni déployer un certain imaginaire, tout comme aucune œuvre faisant preuve d’une telle qualité d’imagination et proposant un monde singulier et original ne peut se limiter à l’étiquette du genre par laquelle on le définit, à moins précisément de l’essentialiser pour en faire une marchandise formatée à un segment de marché, à la manière dont on parle de « romances », de « polars », de « feel good », de « fantasy », de « chick lit », de « romans de gare », de « techno-thriller », mais on voit bien là qu’on ne parle alors plus du tout de littérature…
Ainsi, les œuvres de Jean-Patrick Manchette, de David Peace ou de Chester Himes sont bien plus que du Noir, celles de Graham Greene, de Julian Semenov ou de William Somerset Maugham plus que de l’Espionnage, celles de Patricia Highsmith ou de Michael Connelly plus que du Thriller, celles de George Orwell, d’Aldous Huxley, d’Ursula Le Guin ou de Christopher Priest bien plus que de la SF, celles d’Edgar A. Poe, de Shirley Jackson ou de Howard P. Lovecraft bien plus que du Fantastique. Il me paraît évident que les œuvres de tous ces auteurs doivent se lire avec le même intérêt et le même émerveillement que celles appartenant à la si mal nommée littérature « Blanche » (dont le qualificatif en dit long d’ailleurs...) produites par - au hasard des noms – Germaine de Staël, Gustave Flaubert, Herman Melville, Stendhal, Fiodor Dostoïevski, Franz Kafka, Natsume Sōseki, Louis-Ferdinand Céline, Milan Kundera, Don de Lillo, Claude Simon, Hermann Broch, Ralph Ellison, Vladimir Nabokov, Thomas Bernhard, Pascal Quignard, Tony Morrison…
Me concernant, c’est à partir des œuvres de tous ces auteurs - peu importe leur genre ou leur couleur - que je fais des passerelles avec mes propres idées et réflexions pour, au fil du temps, établir une « structure essentielle des choses » - comme dirait Musil – à travers laquelle se définit une combinatoire déployant mes projets selon les thématiques que je souhaite traiter. À défaut donc d’avoir convoqué et questionné des « univers de fiction » pour écrire La Fabrication du Réel, il est certain que celle-ci doit autant à Lautréamont, à Edgar Allan Poe, à Hermann Hesse, à Jorge Luis Borges, à Robert Musil, à Louis-Ferdinand Céline qu’à Hubert Selby Jr, à Howard Fast, à Jack-Alain Léger, à Monique Wittig, à Serge Lehman, à Paul Smaïl, à Donna Tartt, ou encore - plus improbable à vos yeux sans doute - à Carlos Castaneda dont les œuvres, pendant cette période éprouvante pour moi, ont été d’un très grand soutien moral.
C. L. : En quoi le contexte de votre quotidien inspire-t-il votre écriture qui aurait pourtant tendance à transcender votre réalité biographique documentée ?
C. H. : Je ne sais pas bien ce que vous appelez ma « réalité biographique documentée ». Il me semble que Wikipédia dit l’essentiel de cette biographie, et que le reste - qui n’est pas dit donc - n’a pas à l’être, puisque étant d’ordre privé ou bien complètement anecdotique. Ainsi j’écris, voilà tout ! Le plus important étant de parler de mes œuvres, et non de ma personne qui n’a aucune espèce d’importance. Disons seulement que j’ai fait le choix, il y a une quinzaine d’années, de consacrer mon existence à la littérature suivant ce principe édicté par Robert Musil que « écrire n’est pas une activité, mais un état. C’est pourquoi l’écrivain qui travaille à mi-temps est incapable, au sortir de son travail, de se remettre à écrire » : à écrire en vue de ne répondre qu’à la littérature elle-même, faudrait-il préciser...
Que dire de plus de cet état chez moi, sinon que je poursuis plusieurs projets en même temps, parfois même sous d’autres identités. L’un de ces projets est d’ailleurs l’objet d’un « Contrat Salinger » - différent quand même de celui révélé dans le roman de ce cher Adam Lager ! - me liant à une espèce « d’amphitryon » de la littérature qui met sa fortune au service de la conception d’une « bibliothèque de l’avenir » assez singulière pour laquelle il lève des options d’achat sur des projets romanesque exigeants, voire impossibles (dans le sens dont l’entendait Georges Bataille) rejouant, en quelque sorte, l’ambition de L’Homme sans qualités, mais au XXIe siècle.
En revanche, pour vous en dire davantage sur mon quotidien, celui-ci est aussi tranquille qu’absorbé par mon travail : je vis au bord de l’océan Atlantique dans une petite station balnéaire très agréable où, ma foi, il ne se passe rien d’autre que la vie elle-même. Je suis une lève-tard car je me couche à pas d’heure, étant plongée dans les affres de l’écriture ou dans de multiples lectures exigeantes, quand ce ne sont pas des relectures à approfondir comme, par exemple, L’Éthique de Spinoza, ou encore dans des découvertes volumineuses telle que l’œuvre ultra passionnante de Julian Semenov que tout le monde - en ces temps de Guerre froide 2.0 - se devraient de lire fissa vu ce qu’on y apprend ! Mes journées sont donc à la fois pratico-pratiques et studieuses, week-end compris bien souvent. Je suis également en correspondance - en France et aux États-Unis - avec un certain nombre de personnes auxquelles je suis liée, ou avec qui je mène des projets au long cours, notamment des scénarios, mais aussi dans le cadre de la plateforme D-Fiction que je coanime.
En bref, je suis donc vissée à l’écriture ou à la lecture, sauf pour aller faire mon jogging ou pourvoir à des obligations d’ordre domestique. Si le contexte de mon quotidien inspire ou nourrit mon écriture, c’est sans doute parce que je vis dans le plus grand des silences, ce « silence de la mer » très particulier, épais, enveloppant, et d’une teneur à ce point cosmique que tout le reste semble lointain, très lointain, sinon ne pas même exister, notamment en ce qui concerne cette fameuse Société du Spectacle qui me semble n’être qu’une mauvaise série télévisée qui se rappelle à moi que parce que j’en entends parler dans les médias, ou lors de soirées, de rencontres, ou bien encore parce que, lorsque je me rends parfois dans ce que l'on nomme des « débits de boissons », j’en vois passer les images muettes sur les écrans fixés aux murs.
Alors, j’ai toujours cette étrange impression, soit de vivre sur une autre planète - à moins d’être directement tombée dans une quelconque Twilight Zone - soit d’être complètement à la ramasse et hors du temps au point de ne plus être totalement sociabilisée. Mais je vous rassure, vu les gens que je fréquente, ici, à Washington, à New York, ou encore à Paris où je me rends de temps à autre, il semble que je sois encore agréable à fréquenter ;-)
C. L. : Quels sont vos interlocuteurs rêvés quand vous écrivez ?
C. H. : Mes interlocuteurs favoris sont toujours mes personnages romanesques qui - généralement inspirés de personnes qui existent - me permettent de continuer des discussions et des échanges de manière plus approfondie et plus poussée que dans la réalité. Par exemple, le personnage de « l’Écrivain » (Bret Easton Ellis) qui, Dans l’existence de cette vie-là, nourrit les réflexions littéraires sur l’époque ou sur cette problématique paternelle qui nous est commune, ou encore celui de « Rambo » - le dealer américain d’origine hispanique - avec qui j’ai partagé moultes expériences dans le New Jersey, notamment en termes de « botanique » et de maraîchage, puisqu’il a initié la production d’une marijuana « organic » (bio) qui a fait sa célébrité. J’ai pu, grâce à lui, voyager à travers les États-Unis comme peu l’ont fait, sinon sans doute Neal Cassady et Jack Kerouac eux-mêmes.
Dans La Fabrication du Réel, plusieurs personnages m’ont occupée l’esprit pendant des mois. L’un d’eux, « Armoring Flexy », est d’ailleurs toujours présent parce qu’il se trouve que - dans la « vraie » vie - nous nous parlons souvent et que ça ne cesse de relancer les échanges de son personnage avec le personnage-narrateur du roman, échanges qui ont pu être très tendus, bien que dans une certaine mesure, j’ai la sensation qu’ils étaient plus désagréables et sévères dans la « vraie » vie qu’ils ne le sont dans leur transposition romanesque. Mais je dois dire que si un interlocuteur m’occupe depuis longtemps, c’est la « Substance ». Non pas la « Substance-Rêve » de Philip K. Dick, quoique… mais celle définie par Spinoza, et qui vient de plus en plus souvent - avec les années - s’immiscer dans mes réflexions, questionnements, songes, etc. Cela peut parfois être lassant parce que, avec elle, ce ne sont pas des échanges factuels, simples et qui s’estompent une fois la nuit tombée. Non, ce sont de véritables tractations sinueuses où la pensée prend la forme d’un Rubik's Cube diabolique qui peut m’occuper des heures, des jours, voire des années. Il m’arrive de m’en sentir lasse au point de ne plus rien vouloir. Mais même à ce moment-là, la « Substance » se fait un malin plaisir de ressurgir pour me signifier qu’il vaudrait mieux pour moi de vouloir le Rien que de ne rien vouloir, et hop, ça repart de plus belle !
C. L. : Entre imaginaire et réflexion, comment votre perception du monde se construit-elle dans votre écriture ?
C. H. : Précisément, elle se construit entre imaginaire et vécu, c’est-à-dire entre fiction et réalité dans des allers-retours constants que j’intrique à travers un flux de conscience et dans une dynamique propre à l’application des concepts de Neutre et de Fictionnalisme qui sont à mon process d’écriture ce qu’est le piston à la mécanique, lui permettant la conversion d'une pression en un « travail » (d’une force, d’une énergie) - ou réciproquement. Ensuite, de façon plus prosaïque, ma perception du monde – que j’écrive ou fasse autre chose – est soumise au contexte politico-social de l’époque, et malgré le fait de m’en extraire un maximum, je dois dire qu’elle y est encore « trop » soumise. Voilà pourquoi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux et ne me sers du seul réseau où j’ai un profil (Facebook) que pour accompagner l’actualité de mes publications, sinon y publier - bien que rarement - des citations d’écrivains que je lis.
Je tente donc le plus possible de percevoir le monde en dehors du « vacarme » par lequel on nous le fait entendre. Voilà pourquoi aussi, je n’ai pas la TV, et tout comme Jean Baudrillard, je prends le plus souvent connaissance des actualités en différé – sauf motivation contraire - ce qui permet d’écumer 90% de ces « informations » qui n’en sont pas, mais qui nous font perdre moral et temps. Jusqu’à cet hiver, je n’avais qu’un dumbphone avec lequel je communiquais par appel téléphonique et SMS. Maintenant que j’ai un smartphone, je n’ai installé que des applications « utiles », à savoir le GPS, une ou deux messageries pour communiquer, ma boîte mail, une plateforme de vente pour la recherche de livres anciens et d’occasion et la météo. Ma perception du monde est donc essentiellement nourrie par les expériences que j’en aie à travers mon travail, mes séjours outre-Atlantique, mes relations, et évidemment et en priorité, par la raison, la beauté et la clairvoyance qu’offrent la littérature, le cinéma, l’art, la science, la philosophie, mais surtout et avant tout, la nature. Pour le dire d’une autre manière encore, ma perception du monde est induite par son propre « chant » qui est celui du vent, de l’océan, des oiseaux, et de la pensée humaine…
C. L. : Dans la continuité de l'exploration de l'Histoire de la littérature que permet votre roman, que développez-vous en contribuant à la plateforme collaborative D-Fiction ?
C. H. : D-Fiction est pour moi un espace de liberté créative et critique, un laboratoire décalé qui échappe aux normes, aux obligations et aux cadres institutionnels. C’est un lieu d’expérimentation libre, presque une forme de design thinking appliqué à la littérature : une approche qui mêle pensée analytique et pensée intuitive, dans un esprit collaboratif et vivant.
Créée par des auteurs pour des auteurs, D-Fiction privilégie la qualité des démarches et des œuvres plutôt que les noms ou la notoriété médiatique - ce qui compte, c’est ce que les contenus exposent et questionnent. En contribuant à D-Fiction, j’aide à la visibilité de publications où critique et création se nourrissent mutuellement, dans une optique de défense du contemporain. Chaque texte, chaque projet y est pensé comme une réponse, une proposition adressée à celles et ceux qui s’interrogent encore, qui cherchent au-delà des discours convenus. C’est un terrain d’échanges fécond, où l’on tente de faire émerger ce qui est encore inclassable, fragile, audacieux. Tout cela ne peut se réaliser que grâce à l’outil numérique qui ouvre à des rencontres, à des perspectives, à des possibilités ainsi qu’à une souplesse ergonomique et économique inégalable comparée, par exemple, à celle d’une revue papier, bien plus lourde à gérer et à rentabiliser. Et puis, la diffusion des contenus est bien plus large et impactante que s’ils étaient publiés sous format papier. Certains de nos contenus ont été consultés plus de cent mille fois !
En effet, ce type de contenus n’a rien à voir avec une œuvre, ce sont des contenus qui ont besoin d’être lus immédiatement et rapidement, même s’ils peuvent être encore appréciés plus tard dans le temps. Il n’en reste pas moins qu’ils ne se dégustent pas comme l’œuvre d’un auteur, mais comme un avant-goût à celle-ci. Enfin, je conclurai que l’existence d’une telle plateforme n’est possible que parce que la team que nous formons avec mes cinq acolytes est particulièrement fiable, résolue et d’une rare et impeccable amitié.
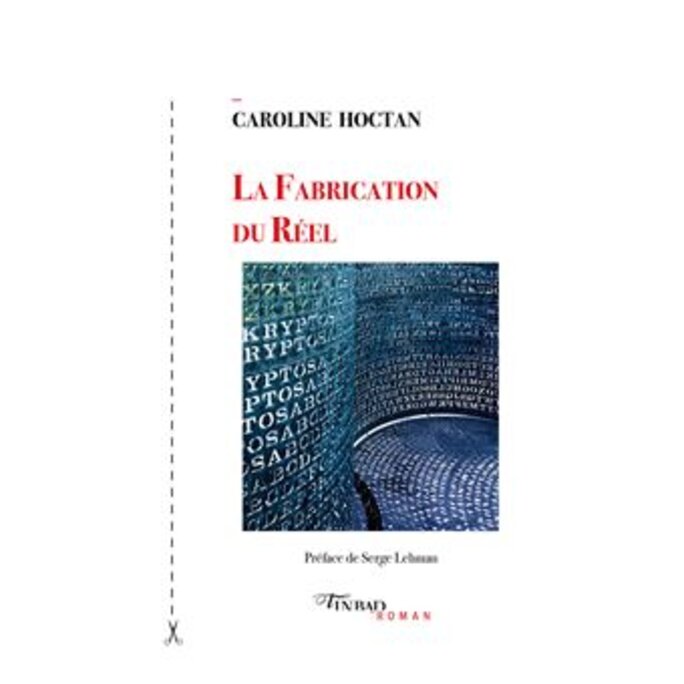
La Fabrication du Réel
de Caroline Hoctan
Nombre de pages : 266
Format : 14,00 x 20,50 x 2,30 cm
Date de sortie (France) : 11 mars 2025
Éditeur : Tinbad
Collection : Tinbad Roman



