
Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Peut-on considérer Journal intime du Liban comme une suite directe de ton film précédent Trève (2016) ?
Myriam El Hajj : Après Trêve, j'avais encore envie de parler de la période de la guerre civile, en étant moi-même enfant de cette guerre. Dans toute ma jeunesse, j'ai souffert de ce fantôme du passé encore très présent qui ne nous laissait pas d'espace, ni pour rêver le pays, ni pour le prendre en main, ni pour nous-mêmes. En outre, tous les seigneurs de la guerre étaient encore au pouvoir et j'avais encore envie de parler du passé du Liban.
C'est ainsi qu'est apparu le personnage de Georges, que j'ai rencontré en 2017 avec un ami à moi, Marwan Chahine, qui a écrit un livre sur le début de la guerre civile. Celui-ci cherchait à comprendre qui a commencé la guerre civile. Je l'ai aidé un peu dans ses recherches parce qu'il s'intéressait à un quartier que je connais très bien parce que mes parents y ont en outre grandi. Je pouvais ainsi ouvrir des portes. Je pense que notre arrivée s'est faite au bon moment dans la vie de Georges, alors qu'il avait envie de discuter avec d'autres. Mon ami a pu ainsi discuter avec lui puis il est parti.
Quant à moi, j'ai fait de Georges un personnage cinématographique et attachant, malgré toutes les ambiguïtés autour de cet homme. En effet, il y a une zone très sombre chez Georges et je lui fais porter une très grande responsabilité quand même mais il y avait quelque chose aussi que je trouvais attachant. Peut-être aussi que ça vient du fait que moi, ces hommes-là, je les connais. C'est-à-dire que je vois la misère derrière une apparence sociale, je vois comment ils ont été abandonnés après la guerre civile en n'allant pas au pouvoir.
Georges vit sans sa jambe depuis 48 ans. Il se rend tous les jours chez le coiffeur et prend ainsi soin des apparences, avant de revenir chez lui se mettre en robe de chambre, s'asseoir devant la télé et fumer des cigarettes. Il y avait donc ce côté très attachant chez lui et en même temps, je résistais car je ne voulais pas refaire avec lui un Trêve deux. Je ne voulais pas refaire encore un film que sur le passé.
Dans Journal Intime du Liban je suis plutôt dans l’envie de faire un film sur le changement, sur nos désirs à nous, Libanais et Libanaises, sur le ras-le-bol que nous avons aujourd'hui, alors que nous avons grandi dans un pays sans droits, où nous avons vu nos parents galérer, où l'on passe d'une guerre à la présence du régime syrien au Liban, des attentats politiques, des invasions israéliennes. On en avait marre.
Je pense que c'est là qu'en 2018, quand il y a eu les élections, s'est affirmé un peu d'espoir. Pour la première fois, il y avait des gens de la société civile qui se présentaient aux élections. C'est là où j'ai commencé à les suivre mais je ne savais pas encore qui allait devenir personnage. Je pensais au début suivre un groupe de gens de cette société civile qui se présente aux élections.
Très vite, Joumana m'est apparue. Elle portait beaucoup de mes revendications et de mes convictions. Quand Joumana a gagné, puis qu'on lui a retiré cette victoire le lendemain, elle est devenue un personnage pour moi.
Le lien avec Trêve, c'est avec le passé et Georges. Ensuite, la révolution a commencé en 2019 et j'avais déjà filmé avec Perla que j'avais rencontrée avec Joumana.
Je vois à quel point toute la société, la jeunesse, est aussi imprégnée par ce passé. Il y avait un slogan qui revenait tout le temps : « Vous êtes la guerre civile, nous sommes la Révolution populaire. »
C'est là où mon désir a rejoint le désir de toute une société pour en finir avec le passé, avec la guerre civile et de nous laisser prendre en main notre destin.

Agrandissement : Illustration 2

Cédric Lépine : Dans Journal intime du Liban tu es davantage actrice de ton époque en partageant tes convictions dans une époque en plein bouleversement sociale, tu n'es plus seulement une observatrice attentive du passé comme dans Trêve.
Myriam El Hajj : C'est vrai que j'assumais une naïveté encore politique dans Trêve alors que je posais des questions et que je voulais comprendre. J'acceptais le rôle de la petite fille dans laquelle mes oncles me mettaient parce qu'ils avaient besoin de me mettre à cette place. Je devais accepter cette position d'observatrice pour laisser la parole venir à moi. Et j'ai joué ça.
C'est vrai que dans Journal intime du Liban, c'était un moment dans ma vie où j'étais plus dans l'action, où je voulais moi-même changer, que ce soit ma vie intime ou notre vie politique. En plus, c'est filmé différemment. Journal intime du Liban m'a obligée de prendre moi-même la caméra alors que sur Trêve, j'avais un chef opérateur.
En effet, on ne fait pas de répétitions pour filmer une révolution. Je ne me voyais pas du tout avec quelqu'un d'autre pour filmer alors que je cherchais une proximité avec mes personnages. Ce n'était pas le cinéma que je pensais faire alors que je voulais poser ma caméra, travailler un cadre comme dans Trêve. Tandis que je me voyais là dans une nécessité de raconter ce qui m'impose aussi un nouveau dispositif. Jusqu'à ce que mes personnages, après l'Explosion, se posent. Dès lors, ma caméra aussi se pose et mon dispositif change à nouveau.
Durant la Révolution et de 2018 à 2022, je tenais un carnet et j'écrivais beaucoup. Jamais je n'avais pensé que ce carnet allait faire partie de quelque chose.
J'ai commencé à monter en octobre 2020 avec Anita Perez, la même monteuse que Trêve, trois mois après l'Explosion. Je tournais, je montais, je tournais, je montais encore parce que j'ai continué à tourner jusqu'en 2022. J'ai attendu les élections de 2022 pour finir le film en me disant que peut-être Joumana se présentera aux élections. On est arrivé avec Anita à un montage de trois heures. Sauf qu'il y avait encore quelque chose qui me manquait. C'est-à-dire que j'ai senti que je n'avais pas envie de faire un film uniquement sur les actualités et de rester juste dans l'intime. Il y avait donc un point de vue et un recul que je ne pouvais pas encore avoir. C'est là où j'ai eu l'idée de mon personnage.
Depuis le début, je cherchais quelque chose de plus poétique qui contraste ou qui apaise. On est dans un film avec énormément de choses qui se passent, avec des événements dramatiques, tristes et parfois très heureux, comme le début de la Révolution. C'est assez chargé et j'avais envie de faire entrer un peu plus de douceur et de poésie depuis le début.
Cédric Lépine : Cette voix porte un regard assumé sur la réalité politique du pays.
Myriam El Hajj : C'est vrai que cette voix n'est plus celle de Trêve. Je pense que c'est un film aussi sur comment grandir, sur la manière aussi de faire un deuil, d'une histoire d'amour, d'une époque, et on sentait tout le temps que l'avant-révolution n'est pas comme l'après-révolution, l'avant-explosion n'est pas comme l'après-explosion. Aujourd'hui, on dit que l'avant-guerre n'est pas comme l'après-guerre, ne sera pas comme l'après-guerre, et en un mois on sent qu'on a vieilli de dix ans. L'Explosion, la révolution et la crise économique qu'on a vécue de 2018-19 à 2022, ça a fait le même effet aussi, et c'est pour ça que la temporalité du film devait en rendre compte. C'est un film d'apprentissage où j'ai grandi avec.
Cédric Lépine : En quoi aussi le film est un regard rétrospectif de 2022, la fin du tournage, sur ton expérience de vie entre 2018 et 2022 ?
Myriam El Hajj : J'avais envie en incluant mon personnage d'apporter de la poésie, des réflexions, de parler de mon père qui me disait « si tu n'es pas morte d'une guerre, ni d'une révolution, ni d'une explosion, tu ne vas pas mourir d'une histoire d'amour ». J'avais ainsi des désirs comme ça, d'intime, mais en même temps, il fallait que mon regard apporte autre chose. J'ai construit mon récit en me disant qu'il y avait deux Myriam : une qui vit les événements tout comme les autres personnages, qui ne sait pas plus ce qu'elle vit, qui n'est pas dans le futur et qui va donc entrer dans la révolution en la filmant.
Je suis ainsi avec Perla qui va me dire « c'est bien que tu sois là , tu me sauves la vie ». Je vais filmer avec Joumana et nous sommes toutes les deux très contentes de la révolution, mais on ne sait pas ce qui nous attend.
Il y a aussi la Myriam qui parle de la révolution qui sait qu'elle va finir. Avec Perla, nous allons comprendre que chacune était en train de lutter pour se libérer de soi-même. Je suis à ce moment dans le futur. Jouer sur les temps, c'est magnifique.
Quand Joumana dit qu'après tout ce qu'elle a vécu, l'explosion est encore une couche différente de désastre plus grand que tout ce qu'elle a déjà vécu, elle ne savait pas encore qu'elle allait vivre la guerre israélienne aux conséquences plus effroyables encore.

Agrandissement : Illustration 3

Cédric Lépine : Peux-tu expliquer la décision de ton approche intime des événements plutôt qu'une succession chronologique de l'histoire politique du pays ces dernières années ?
Myriam El Hajj : Déjà, je pense que la plus grande difficulté de ce film consiste à filmer des événements mais en même temps de ne pas être en train de filmer l'événement. Ça c'était ma difficulté. Par exemple, au début de la Révolution, il y avait énormément de médias qui venaient de l'étranger, du Liban, de partout, où Perla, à un moment donné, est devenue une figure principale dans cette Révolution, une leader. Il y avait donc énormément de presse autour d'elle. C'est là où je commençais à me poser la question de ce que je pouvais apporter de plus par mon film. Ce que j'ai compris avec mon instinct en filmant, c'est que ce qu'on apporte de plus, c'est le long terme. C'est le fait de rester plus longtemps. Nous on n'arrive pas aux événements seulement. Nous, on est là avant l'événement, après l'événement.
Par exemple, l'homme qu'on voit dans le film après l'explosion, bien après l'explosion, un an après l'explosion, il est là avec un micro, et fait toute une tirade ou fait un monologue. Cet homme-là, personne ne l'a filmé à la télévision. Tu vois, ce jour-là, quand on l'a filmé, je suis rentrée chez mes parents et je leur ai posé la question s'ils ont vu ça à la télé, personne ne l'avait vu.
Pourquoi ? Parce que les médias étaient venus pour filmer le rassemblement, ce jour-là, devant le port, et ils ont filmé un homme qui a lu un communiqué, et ils sont partis. Et nous on est restés avant et après. Je pense donc que c'est ça aussi, un cinéaste : être au bon moment, au bon endroit, c'est-à-dire rester longtemps. Cela nécessite énormément de patience, en fait. Parfois on sous-estime le documentaire, mais c'est très injuste parce qu'on fait un travail de longue haleine.
La patience aussi, c'est de rester avec Georges un an sans filmer. La patience, c'est apprivoiser Perla, qui est super difficile à apprivoiser, parce qu'elle a une force, une énergie, c'est Joumana, qui au début s'adressait à moi comme si j'étais une journaliste, elle portait donc un masque, et petit à petit elle a accepté de faire tomber ce masque, parce qu'elle a compris que je cherchais l'humain. Ensuite, nous avons commencé à faire le film ensemble sur plusieurs années.
Je pense, en même temps que je filmais pour lutter contre l'effet de sidération. La sidération, c'est qu'il y a une explosion que tu filmes sans comprendre ce qui se passe. Là, il y a une accélération de l'Histoire. Une autre question est venue à moi très vite, c'est comment filmer la violence, comment filmer des événements qu'on est en train déjà de voir à la télévision comme l'image de l'explosion qu'on a vue et revue, qui était un peu partout, cette image de l'explosion, même si les futures générations n'auront pas vu cette image. Est-ce qu'on a vraiment besoin de montrer cette image ? Qu'est-ce que c'est la violence ? Par le passé, j'avais fait un mémoire dans mes études de théâtre sur la violence, et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
Je ne suis pas journaliste, je suis une réalisatrice qui vit dans ce pays et donc j'ai besoin aussi d'assumer comment je vis à l'intérieur. Je n'ai pas le recul pour montrer un événement dur et violent comme un journaliste peut le faire, parce que lui n'est pas concerné directement, parce que ce n'est pas son pays, qu'il n'y vit pas et qu'il n'y a pas sa famille.

Agrandissement : Illustration 4

Cédric Lépine : Ainsi, les quartiers que tu filmes sont ceux qui font partie de ton quotidien ?
Myriam El Hajj : Oui, bien sûr, et au final, le Liban est petit, et en fait, on apprivoise à la fois tous ces endroits-là. Même durant la Révolution, je me demandais si je voulais filmer la violence. J'avais des images de la violence que je n'ai pas utilisées. Par exemple, pour l'Explosion, je me suis dit que c'est une image qu'on a vue et revue, donc qu'est-ce qui fait violence pour moi ? Ce qui fait violence, ce sont des gens qui n'ont pas su qui a tué leurs enfants, des gens qui vont aller au port tous les 4 de chaque mois demander justice. Petit à petit, ces groupes deviennent de plus en plus petits.
Pour moi la violence, ce n'est pas l'événement de l'Explosion en soi, mais ce que cette explosion a fait sur les êtres humains, qui ont perdu des personnes chères. C'est donc le deuil d'une ville. C'est comme ça, par exemple, que j'ai envisagé toute la deuxième partie du film après l'Explosion.
Cédric Lépine : Avais-tu en tête cette idée que tes trois personnages représentent plus qu'eux-mêmes, autour de l'ancienne génération, le milieu artistique, la voix politique ?
Myriam El Hajj : Je n'avais pas encore ce recul. Pour Georges, je ne le filme pas comme un politicien parce que je ne peux pas le rendre responsable. En même temps, il a sa part de responsabilité. Je ne sais pas si c'est lui qui était au tout début de cet attentat du bus qui a déclenché la guerre civile. Il y a des points d'interrogation. Beaucoup de personnes de sa génération s'approprient l'histoire parce qu'elle n'a pas été bien racontée. En même temps, comme tu dis, il représente toute une génération de personnes, soit qui ont suivi des partis politiques, soit qui se sont engagés corps et âme dans la guerre civile sans quitter les armes. Ils sont donc surtout responsables de bloquer tout changement.
Quand on le voit, Georges, il veut que tout change, mais que rien ne change. En fait, il veut que tout change, mais avec ses règles à lui. Même chez le coiffeur, il va dire que « les jeunes ne savent pas faire la révolution. Si je n'avais pas perdu ma jambe, j'aurais montré à ces jeunes comment faire la révolution. » Il veut la faire avec ses règles à lui. Tandis que Perla ne propose pas la violence : elle propose autre chose, en allant chanter dans la rue et fédérer du monde autour d'elle. Ainsi, plus que lui-même, Georges représente le fantôme du passé.
Joumana représente un changement démocratique parce qu'elle y croyait et y travaillait chaque jour en ce sens, en réunissant les jeunes. Elle pensait ainsi réveiller la conscience politique des jeunes à travers les discussions, les écrits.
Perla représente une génération qui n'a pas connu la guerre et qui a donc compris la guerre dans la Révolution. En effet, la Révolution a réuni des personnes de confessions différentes, ainsi que de lieux éloignés du Liban. Nous sentions alors que nous mettions fin à la guerre civile qui s'est officiellement finie en 1990. Même si cette génération n'a pas connu la guerre, elle souffrait de quelque chose de très organique à travers la corruption qui ne te permet pas d'avoir une vie saine et juste, et de l'injustice. De mon côté, je me trouve entre la génération de Perla et de Joumana.
Cédric Lépine : Avec ces trois personnages avais-tu l'envie de réunir des personnes qui ne se croisent pas dans la société en un même film ?
Myriam El Hajj : En effet, c'était un vrai défi de réunir par la narration des personnages qui ne se croisent pas mais qui en fait se répondent. J'ai tenté de faire se croiser réellement Joumana et Georges mais ce n'était pas intéressant. J'ai senti que je n'en avais même pas besoin puisque le dialogue entre eux se faisait au montage. Ce que je raconte aussi à travers ce dispositif, c'est qu'il s'agit de générations qui n'arrivent pas à se croiser au Liban. Je me souviens lorsque j'ai projeté Trêve au Liban, qu'une jeune est venue me remercier de créer un espace où les générations puissent se rencontrer et se répondre. En effet, même dans les foyers cette jeunesse n'arrive pas à parler de la guerre avec leurs parents en raison d'énormes tabous.
Perla et Joumana appartiennent à des générations qui se sont croisées durant la Révolution dans la rue mais ce n'est pas possible avec Georges qui méprise la nouvelle génération.
Je ne sais pas qui a lancé l'idée que le Libanais est un être résilient. Je n'aime pas ce mot car le Libanais est avant tout quelqu'un qui doit sans cesse se réinventer après avoir reçu des coups. Moi aussi j'ai toujours été dans le faire et l'action. Il y a de l'espoir dans la dernière scène avec Perla parce qu'elle est dans l'action. Tant qu'il y a de la rage, il y a de l'espoir pour que cela change. J'ai compris en fin de compte que je faisais une histoire de la ville et sur le pays avec des personnages qui racontaient leurs histoires d'amour et de rage. En effet, le dénominateur commun de ces trois personnages qui ne se croisent pas c'est la ville et le pays, dans leur attachement et leur rejet où domine l'amour.
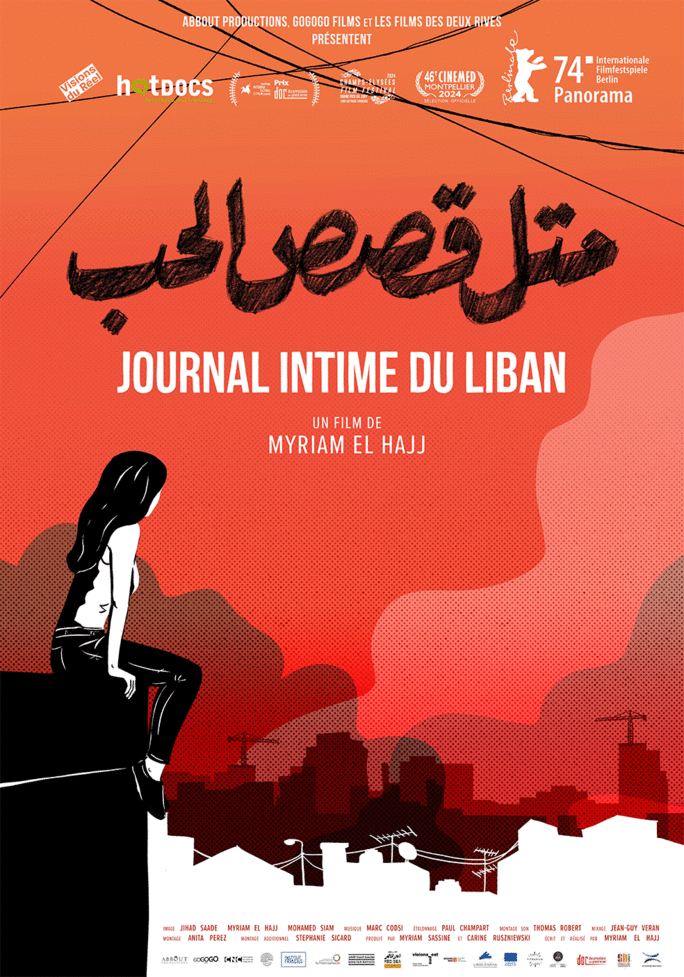
Agrandissement : Illustration 5
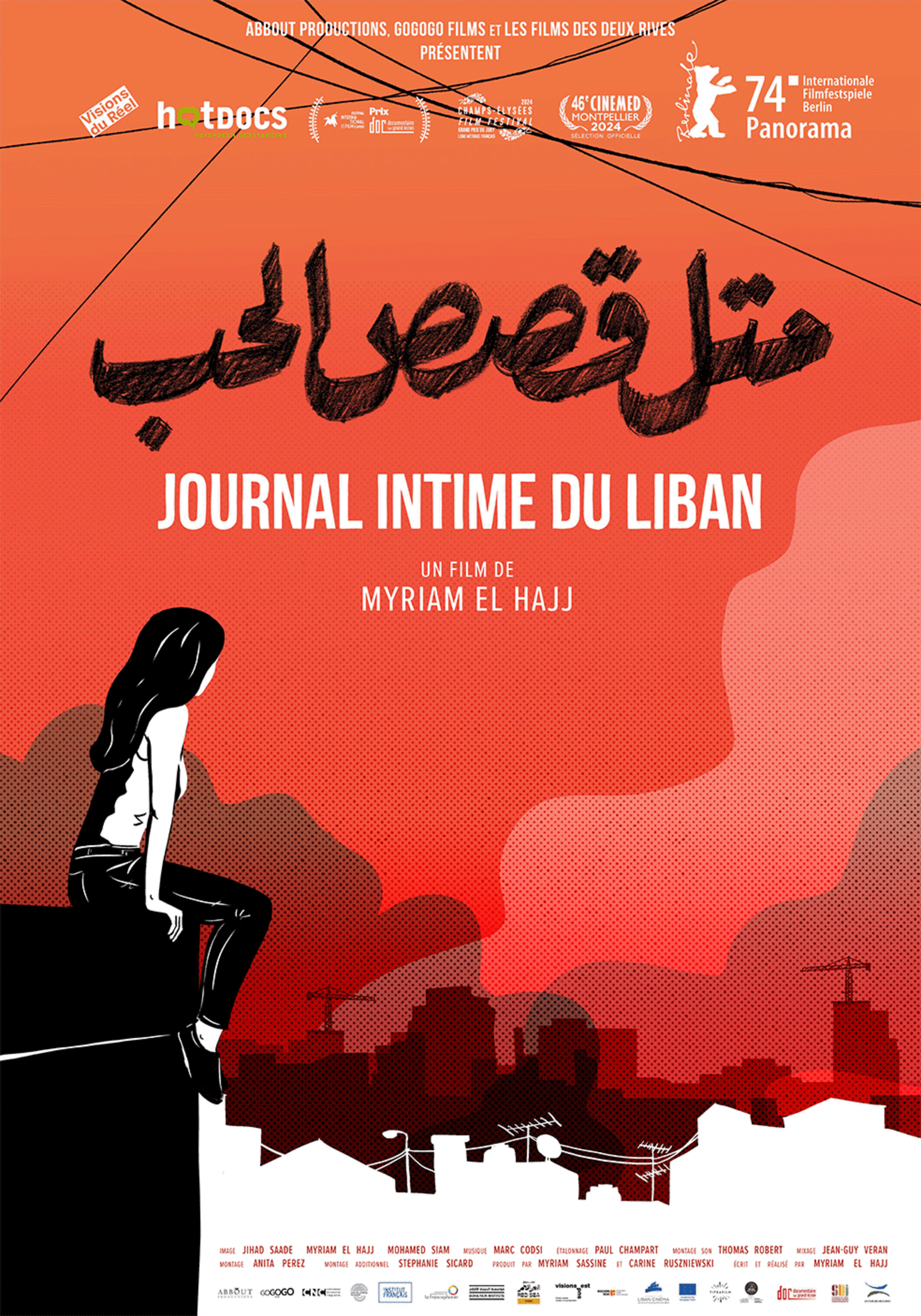
Journal intime du Liban
Diaries from Lebanon
de Myriam El Hajj
Documentaire
110 minutes. Liban, France, Qatar, Arabie Saoudite, 2024.
Couleur
Langue originale : arabe
Avec : Joumana Haddad, Perla Joe Maalouli, Georges Moufarrej
Scénario : Myriam El Hajj
Images : Jihad Saadé, Myriam El Hajj, Mohamed Siam
Montage : Anita Perez, Stéphanie Sicard
Musique : Marc Codsi
Son : Thomas Robert, Jean-Guy Véran
Production : Myriam Sassine (Abbout Production) et Carine Ruszniewski
Distribution : Les Films des Deux Rives



