
Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cette réalité sociale méconnue en Algérie, faisant le lien entre l'exploitation nucléaire par la colonisation française et l'exploitation contemporaine chinoise dont les ouvriers sont les victimes ?
Marcel Mrejen : J’ai d’abord commencé à m’intéresser à la présence ouvrière chinoise en Algérie comme un point d’entrée vers un questionnement plus large sur la mémoire collective. Franco-algérien ayant grandi à Paris, je suis allé en Algérie pour la première fois en 2014, à l’occasion du rapatriement du corps de ma grand-mère décédée en France, où elle vivait depuis son exil en 1994. En sortant de l’aéroport, j’ai été frappé par la vision de milliers d’ouvriers chinois travaillant sur les chantiers environnants.
Depuis 2006, des ouvriers chinois arrivent par milliers pour travailler sur les chantiers algériens. La crise démographique et les accords commerciaux sino-algériens ont permis aux entreprises de construction chinoises d’occuper une place considérable sur le marché local mais ces travailleurs vivent dans des bases de vie isolées, coupés de la société, dans un entre-deux où se mêlent solitude et aliénation. Cette marginalisation a nourri de nombreuses rumeurs, histoires et légendes, qui relèvent à la fois de l’imaginaire populaire et d’événements bien réels.
Certaines histoires de fantômes d’ouvriers disparus s’appuient sur le fait tragique que leurs morts ne sont pas toujours rapatriées. Le coût exorbitant du transport des corps, combiné à l’absence de cimetières non-musulmans en Algérie, a conduit certaines entreprises à faire disparaître les corps d’ouvriers morts sur les chantiers. C’est cette question de la mémoire collective autour de cette main-d’œuvre exilée qui a constitué le point de départ du film, avant qu’il ne s’ouvre sur une réflexion plus large autour du continuum colonial, des essais nucléaires français jusqu’à des formes d’exploitations spéculées.
C. L. : En quoi consiste pour vous l'écriture de ce film ?
M. M. : L’écriture de ce projet n’a pas pris la forme classique d’un scénario détaillé. J’ai beaucoup lu, accumulé des notes, des articles, des témoignages, mais l’ensemble ressemblait davantage à une centaine d’onglets ouverts dans mon navigateur qu’à un récit structuré. L’idée du film était là, assez claire dans mon esprit, mais sans passer par la forme linéaire d’un script. J’ai préféré laisser une part d’improvisation guider le tournage, en m’appuyant sur des intuitions et des images précises qui sont venues se développer dans le processus.
Finalement, c’est surtout au montage que le film s’est véritablement écrit. Le tournage a produit une matière riche mais éclatée, sans structure narrative évidente. Le montage a permis de rassembler ces fragments et de donner au film son rythme, sa respiration, sa logique propre. On peut dire que le film s’est composé dans un va-et-vient constant entre l’accumulation de matériaux et la nécessité de trouver une cohérence formelle et poétique.
C. L. : Quelles ont été vos demandes spécifiques auprès du chef opérateur Nader Chalhoub et de l'ingénieur du son M'Hand Abadou Djezairi pour réaliser ce film ?
M. M. : Nous avons tourné dans des conditions très réduites, avec une petite équipe composée de Nader Chalhoub à l’image, M’hand Abadou Djezairi au son, Amine Salem Castaing à la production en Algérie, Yves Yan devant la caméra, et moi-même. Je savais dès le départ que nous n’aurions ni le temps ni les moyens de mettre en place des dispositifs trop complexes. J’avais en revanche une vision claire de la mise en scène : utiliser la lumière naturelle, privilégier des plans longs, fixes, très larges, et recourir au steadycam uniquement quand le mouvement était nécessaire. Ces contraintes sont devenues des choix esthétiques qui ont façonné l’identité visuelle du film.
Pour le son, l’approche de M’hand a été d’accumuler un maximum de prises annexes. Les prises directes n’étaient pas toujours possibles, ni même souhaitables, alors il a beaucoup travaillé à enregistrer des ambiances et des sons spécifiques, en expérimentant notamment avec des micros particuliers comme le Geofon. En post-production, nous avons passé énormément de temps à recréer un espace sonore qui soit à la fois réaliste et spectral, presque hanté. Je crois que l’image et le son se sont construits dans une complicité étroite, et le travail de Nader et de M’hand a été déterminant pour donner corps au film.

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : L'étape du montage est-elle centrale pour vous ? Comment se déroule-t-elle en associant de multiples régimes d'images et de son ?
M. M. : Le montage a été, sans doute, l’étape la plus longue et la plus décisive du film. J’y ai passé près d’un an, à réécrire et recomposer sans cesse la structure. Certaines séquences étaient pensées dès le départ et se sont insérées naturellement, mais la majorité des images provenaient d’un tournage très libre, presque intuitif. Le dispositif léger nous avait permis de tourner énormément en deux semaines, mais sans hiérarchie claire entre les plans. C’est au montage que j’ai trouvé la manière de relier ces fragments.
Cette étape a aussi été celle où les voix du film se sont mises en dialogue : les témoignages des ouvriers chinois, les archives des essais nucléaires français, les poèmes de Hawad. Le son a joué un rôle crucial dans cette écriture : avec M’hand, nous avons beaucoup travaillé la dimension sonore, au point que parfois c’est le son qui a dicté la construction de la séquence. En ce sens, on peut dire que le film s’est monté comme une composition musicale autant que comme une narration visuelle.
C. L. : La polyphonie linguistique et idéologique du film – entre la propagande militaire française, la voix d’un ouvrier chinois et celle d’un poète touareg – était-elle présente dès l'origine du projet ?
M. M. : L’idée de faire dialoguer des voix différentes était présente dès le début, oui. J’avais le désir de penser le film en contre-forme, c’est-à-dire à rebours d’un récit linéaire et homogène autour d’un territoire. L’Algérie, pour moi, est un espace de strates historiques et mémorielles qui s’entrecroisent. Il me semblait important que cette multiplicité se reflète dans le film, à travers la langue, les registres et les temporalités.
La polyphonie permet de rendre compte de cette complexité, mais aussi de créer des frictions, des dissonances, des échos inattendus. Entre la propagande française, les paroles d’un ouvrier et les poèmes de Hawad, on entend des visions du monde différentes, parfois contradictoires, mais qui cohabitent. C’est dans cette tension que le film prend sa force.
C. L. : Que souhaitez-vous partager avec le public du film ?
M. M. : Ce qui m’importe, c’est que chacun puisse y trouver un espace de réflexion personnelle. Le film n’apporte pas de réponses, il ouvre des pistes, des images, des sensations. J’ai essayé de représenter le continuum colonial non pas comme une donnée abstraite, mais comme une réalité sensible qui traverse le temps et les corps. J’aimerais que ce film suscite des questions, qu’il laisse des traces, qu’il habite la mémoire de ceux qui le voient.
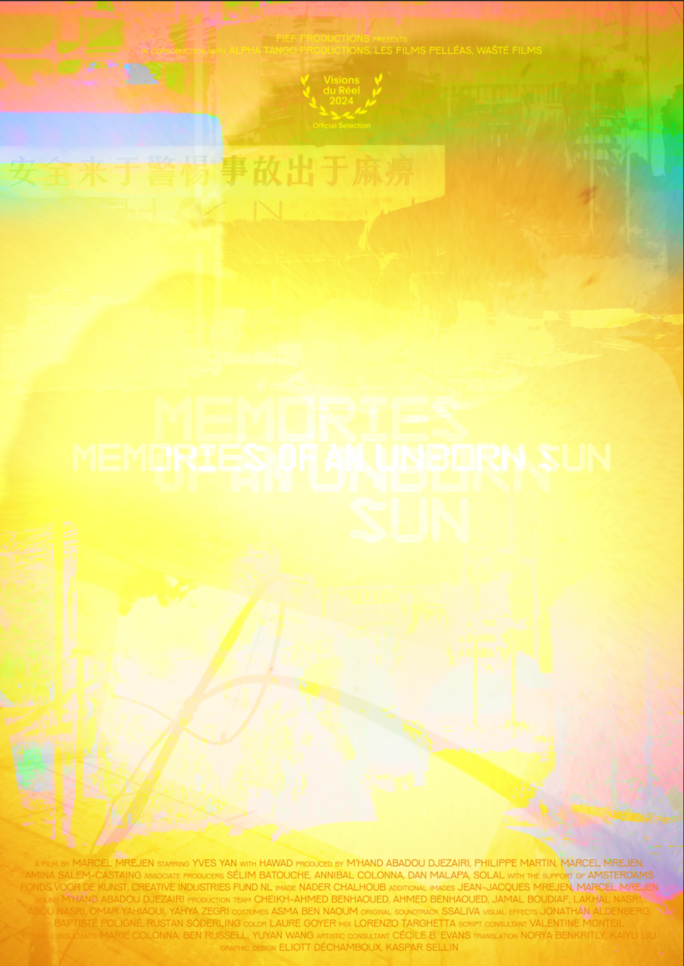
Agrandissement : Illustration 3
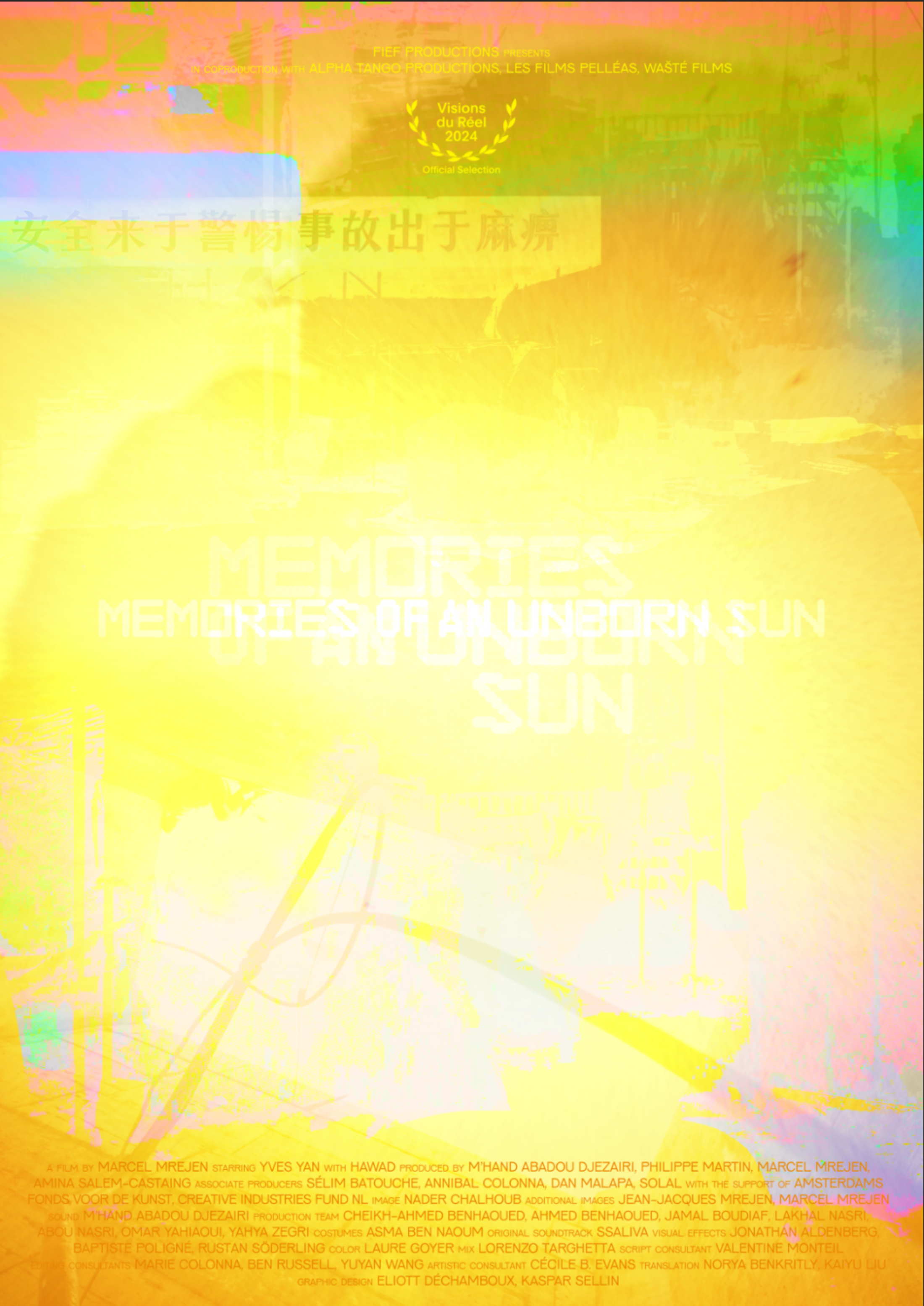
Memories of an Unborn Sun
de Marcel Mrejen
22 minutes. Algérie, France, Pays-Bas, 2024.
Couleur
Langues originales : chinois, tamasheq, français
Scénario : Marcel Mrejen
Images : Nader Chalhoub
Montage : Marcel Mrejen
Musique : Ssaliva
Son : M'Hand Abadou Djezairi
Production : M'Hand Abadou Djezairi (FIEF Productions), Philippe Martin (Les Films Pelléas), Amina Salem Castaing (Alpha Tango Productions)



