Le goût du travail bien fait, et la fierté d'exercer un métier au plein sens du terme, sont fondamentaux dans une vie. Mais trop souvent négligés. Ils sont au coeur d'une journée organisé à l’initiative de l’Appel des appels (ADA) en partenariat avec des organisations syndicales nationales.
La CFDT, la CGT, la FSU, Solidaires et le Syndicat de la Magistrature se sont associé à l'Appel des appels le 17 novembre à la Bourse de travail de Paris pour travailler sur ce thème " L'amour du métier". Des actes seront publiés.
Voici le texte ouvrant la réflexion collective:
Il s’agit de continuer à mettre en discussions nos expériences et nos analyses entre syndicalistes des grandes organisations syndicales et participants de l’Appel des appels à propos des professions du bien et du lien publics. Au moment où l’ensemble « du » travail semble migrer vers une société dite de la « connaissance », de l’ « information » avec ses technologies numériques confrontant à des réalités virtuelles, comment les transformations des organisations et des conditions de travail nt-elles remodelé les métiers, le travail, les « travailleurs », et bousculer les mots pour désigner une activité, un métier ? Il est des appellations dont on n’ose plus user comme celles d’ouvrier ou d’intellectuel. Pourquoi ?

Certes, ces mots font référence à une autre époque et à des milieux où l’on ne craignait pas de promettre, pour tous, l’émancipation, la promotion sociale par l’éducation, la culture, l’école. Epoque et milieux où l’on était aussi fier d’être ouvrier, que technicien ou travailleur intellectuel. La fierté de faire un métier et d’ « habiter » des formes collectives précises, où ces conditions sociales d’exercice s’exprimaient, n’était pas un vain mot. Or, même entravé, l'intérêt pour le travail bien fait constitue toujours le socle sur lequel tentent de se reformer sans cesse des collectifs de travail. Bien qu’ « interdits », certes de façon masquée, amour du travail et construction de collectifs de travail n'en demeurent pas moins — mais à quel prix ? — les moteurs d'un engagement fécond dans l'activité professionnelle.
La volonté de faire son métier s’exerce parfois aux dépens sa sérénité psychique et/ou de son intégrité physique du fait des conditions sociales et d’organisation du travail où l’on est plongé. Par les nouveaux modèles d’évaluation du travail et le management au chiffre, qui ignorent le travail réel et les spécificités des missions et métiers de bien public, ces formes s’infiltrent partout tant dans les structures sociales que dans la subjectivité. Attaquant les liens, elles installent une emprise qui réduit l’individu au rôle d’instrument d’exécution. Le coeur de métier des professions du bien et du lien social, des services à la personne, notamment des services publics, sont à leur tour atteints, harcelés par les techniques de cette maladie des temps actuels qu’est l’obsession évaluative.
Cette journée commune ambitionne de dresser un diagnostic plus ou moins "partagé" des questions posées et de commencer à renouveler la formulation de celles-ci. On ne parle que de souffrance au travail, d’évaluation, de conflits. Alors qu’il s’agit plutôt d’impossibilité de "conflictualiser" vraiment des contradictions dans une organisation donnée. Alors que l’on risque sans cesse d'être submergé par une vision « doloriste » du travail, la victimisation et la médicalisation du travailleur en acceptant de devenir la "chose" plus ou moins passive des
experts, des ex-pairs, de la (des)organisation du travail et des métiers, de la fin d'un droit du travail. Aujourd’hui, qu’en est-il vraiment ?
— De l’Évaluation généralisée focalisée sur les personnes ? Elle renvoie exclusivement à la responsabilité individuelle pour mieux dissimuler l’importance des formes d’organisation du travail et des modes de management sur la productivité de chacun et d’un ensemble social. Ainsi les décideurs de ces formes, et leurs instances, sont-ils exonérées des échecs ou de dysfonctionnements observés.
—Du Conflit ? Il y a impossibilité de promouvoir des dynamiques conflictuelles, des disputes professionnelles dans les organisations, tant le conflit est désigné aujourd’hui comme d’essence destructrice ; tant il est en même temps dépouillé de ses dimensions potentiellement créatrices de nouvelles formes sociales pour oeuvrer ensemble et de façon féconde. Du coup, ne se présentent pas les conditions propices à une mise en jeu articulée de rapports de forces symboliques et de conflits constructifs rendant possible un dépassement créatif et par le haut des situations.
— Souffrance. Chacun est renvoyé à la solitude, à des tensions et des conflits intérieurs, où s’opposent notamment — du moins , nous le croyons ou l’espérons — un reste irréductible de valeurs humanistes et la conviction, qui progressivement prend ses quartiers, que la guerre de tous contre tous est un fait nécessaire de nature et non de culture, et que la solidarité comme valeur et comme ensemble de pratiques concrètes sont des leurres.
Que pouvons-nous faire, c'est-à-dire que pouvons-nous dire et avec qui ?
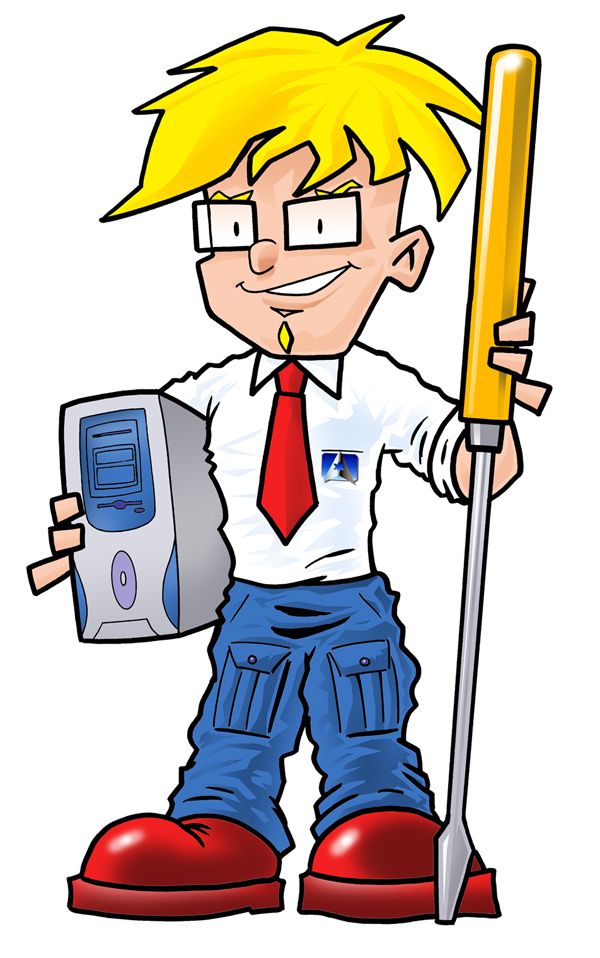
qui puisse endiguer l’actuelle marée idéologique, et bien plus, impulser un autre courant donnant à chacun le courage de penser, le courage de dire, de vivre ses engagements pour des luttes solidaires à construire, de façon transversale et non corporatiste ou conservatrice ? Pour créer de la pensée mais aussi des mots pour la dire afin que nous puissions participer davantage à la bataille pour agir sur les mécanismes de formation de « l’Opinion publique » et des rapports de force, il y a justement celui de la valeur. Valeur que le mot évaluation ou les procédures l’évaluation prétendent représenter ou mesurer.
La valeur attribuée à un « objet », une action, un travail est le résultat d’une convention, c’est-à-dire d’une délibération entre les individus. Il n’y a pas de valeur en soi. Lorsqu’elle est imposée sans avoir été mise en délibération, son autorité n’est qu’indexée sur une vérité « naturelle » ou sur une utilisation frauduleuse de la science, pour mieux passer sous silence, la catégorie de l’idéologique ou de l’imaginaire à laquelle elle appartient. Une évaluation isolant des indices quantitatifs de leur environnement reste ignorante des conditions de fabrication de ces indices et des réalités dont ils prétendent rendre compte. Elle ne peut conduire qu’à des conclusions et des décisions aberrantes Comment se représenter et dire les choses pour que la contribution apportée par le travail soit évaluée autrement ? Et que le mérite d’une activité productive, d'une création, revienne davantage à ceux qui travaillent qu’à ceux qui mobilisent des capitaux ? Il faut inverser les modes de pensée. Si nous y parvenions. Ne fermons pas les yeux : l’aboutissement logique de l’évaluation généralisée, fondée par construction sur un principe de dévaluation, et focalisée sur l’individu et ses actes regardés, est la disqualification, puis l’épuration.
Que faut-il pour que l'évaluation ne soit pas celle de l’individu, mais celle des formes d’organisation du travail, de leurs modes de mise en oeuvre, de leurs finalités ? Un travail sur ce plan suppose de revisiter régulièrement la question de savoir si les formes d’organisation adoptées ou pratiquées sont réellement adéquates aux coopérations nécessaires et à ce qu’elles sont censées produire, ce qui implique que des liens
d’appartenance puisse se tisser. Ou, ont-elle seulement pour fonction — derrière un alibi mensonger de productivité — de dissimuler d’autres motifs relevant d'autres enjeux dont aussi des enjeux narcissiques pour une part inconscients, sans rapport avec la fécondité d’une organisation et de ses membres.
« Quid » de la valorisation extrémiste actuelle de la mobilité ou de la flexibilité, autrement dit de l’absence de conditions pour un investissement durable et nécessaire du sujet, pour lui, comme pour la collectivité ? C’est pourquoi, la valorisation d’un supposé travail et d’une société possibles "sans les autres", comme dans la formule de l’auto-entrepreneur, si ce n’est contre les autres, doit certainement trouver face à elle une "insurrection" mieux armée des "consciences".
L’utopie d’une telle rencontre ? Le pourquoi d’une telle rencontre ?
Tout le monde dit, qu’il faut penser, se remettre à penser, pour construire de nouvelles analyses, de nouvelles catégories d’analyse. Pour cela il faut inventer de nouveaux lieux, de nouveaux espaces de discussion et de mise en relation. Nous devons nous équiper mutuellement de nos connaissances et de nos métiers, souvent masqués et fragmentés. Nous avons à trouver en nous de nouvelles ressources pour inventer. Parler ensemble dans cet espace inédit et penser à haute voix de nos différents lieux, sans vouloir avoir raison sur les autres, c’est ce qui peut nous pousser en avant dans cette voie.
Les "Actes" d'une telle rencontre, jusqu'ici inédite dans l'histoire du mouvement social et intellectuel français, d'un tel travail sur le travail et sur nous mêmes seraient le trésor partageable, transmissible, de cette rencontre.



