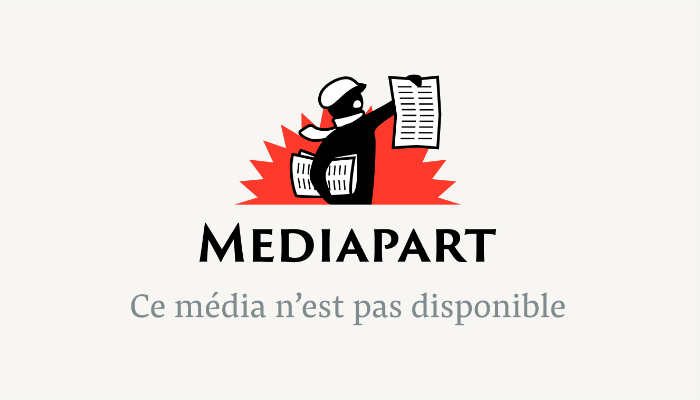
Chef d'œuvre mozartien bien trop rare sur nos scènes hexagonales, L'Enlèvement au Sérail nous est présenté à l'Opéra National du Rhin, dans une nouvelle production dirigée par Rinaldo Alessandrini, avec une distribution exemplaire.
L'Enlèvement au Sérail est sans aucun doute l'un des sommets, sinon le sommet, des turqueries de ce XVIIIème siècle, et à plus forte raison des turqueries mozartiennes. Fruit de la fascination des sociétés occidentales pour les senteurs et les couleurs venues d'orient, ces œuvres délicieuses — qui n'ont bien sûr de « turc » que le nom et quelques modes musicaux singuliers qu'on imaginait alors être l'essence de la musique orientale — véhiculaient l'imagerie savoureuse d'une société ottomane fantasmée. Après les quelques frayeurs des siècles passées (les ottomans ont fait par deux fois le siège de Vienne, en 1529 et 1683, avant d'être repoussés !), l'orient a perdu une partie de ses allures menaçantes et ces turqueries sont l'occasion de renouveler la Commedia Dell'arte, en remplaçant les vieux grippe-sous libidineux par des pachas et des eunuques, et la cage dorée des jeunes Colombines par des harems, tout en empruntant au grand opéra lyrique les thèmes de la tragédie antique — comme la noblesse des sentiments, la clémence des hommes de pouvoir, etc.
Bien connu des aficionados de la musique ancienne, et doué d'un talent remarquable pour remonter aux sources du discours musical et « recréer » les œuvres, Rinaldo Alessandrini est fort bien placé pour comprendre et dépoussiérer ce que cette musique légère et pétillante recèle de richesses orchestrales et d'exaltation lyrique. Son travail à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg est à ce titre exemplaire. Du moins en ce qui concerne les couleurs savoureuses (superbement rendues) et les dynamiques (les nuances, dont les contrastes font l'effet d'un feu d'artifice rutilant). Seule la souplesse agogique laisse un brin à désirer : l'orchestre paraît en effet bien rigide et peu enclin à suivre les variations de tempo, pourtant on ne peu plus pertinentes et musicales, que voudrait lui imposer son chef.
Cette petite lacune est particulièrement sensible dans l'accompagnement des arias — ces arias emblématiques de la verve opératique mozartienne merveilleusement lumineuse dans ce Singspiel (opéra en allemand rythmé par des scènes parlées) tout entier tourné vers la comédie sentimentale. Cette raideur (toute relative) réduit d'autant la liberté des chanteurs à prendre leur temps dans une vocalise, à s'appesantir sur une cadence pour mieux s'épanouir. Elle est d'autant plus regrettable que ma distribution est un sans faute, ou presque. Parfaitement équilibré, uni par une complicité musicale palpable, ce plateau est un mariage idéal entre les cinq voix en présence.

Mêlant avec tact ombre et lumière, la voix charnue de la soprano américaine Laura Aikin en font une Constance agréable, aux accents plaisants, malgré un manque d'équilibre entre les registres et notamment des aigus un peu forcés. Le ténor hongrois Szabolcs Brickner lui donne la réplique avec aisance, en la personne de Belmonte, son fiancé. Il se distingue aussi dans ses duos avec Pedrillo, son servant, incarné avec malice par le ténor allemand Markus Brutscher — qui, n'était sa tessiture, ferait par sa prestance un excellent Figaro ou Leporello.
Comme souvent en effet chez Mozart, ce ne sont pas les maître qui importent, mais bien leurs serviteurs (tout droits sortis d'une Commedia Dell'arte revue et corrigée par le siècle des lumières) qui emportent l'adhésion du public en même temps qu'ils mènent l'action tambour battant. Les uns sont de gros balourds : c'est certainement le cas d'Osmine, le gardien du harem, truculent Reinhard Dorn (admirable basse d'outre-Rhin, même si on l'aimerait parfois plus puissant dans les graves et plus menaçant dans ses airs). Les autres roulent tout le monde dans la farine : Blonde, la suivante de Constance, est indéniablement de celle-là — et son discours résolument féministe est à tous égards excessivement moderne en ces temps d'affaire DSK. Blonde emporte aussi la palme dans cette nouvelle production de l'Opéra National du Rhin : dotée d'une jolie voix, cristalline et tendre, affirmée et maitrisée, la soprano autrichienne Daniela Fally est d'une justesse absolue en tout, et d'une souplesse rare.
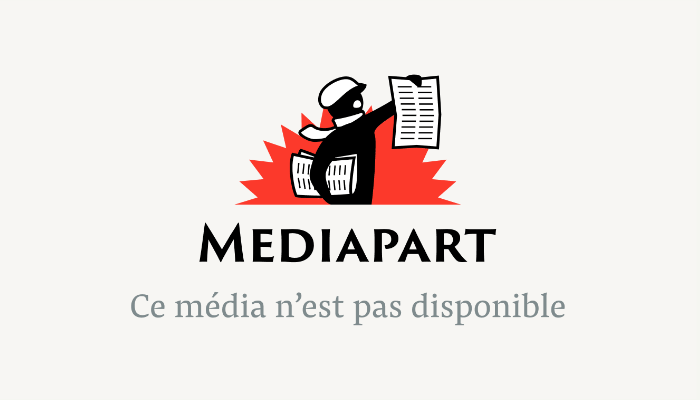
Seule véritable ombre à ce tableau qui s'annonce idyllique : la mise en scène de Waut Koeken. Ce dernier non seulement ne sait pas tirer parti de l'habile scénographie de Yannick Larrivée (constituée de cadres en boiserie ouvragée, tour à tour miroir du harem, barreau de prison et fenêtre sur la liberté), mais il se contente, pour toute direction d'acteur, d'un jeu digne des mélodrames télévisés américains. Première et principale victime : le comédien Christoph Quest, qui incarne Pacha Selim le seul rôle non chanté du Singspiel.
Heureusement, la musique est là. Et c'est Mozart lui-même (grâce à l'entremise inspirée de Rinaldo Alessandrini et de ses chanteurs) qui nous enlève du sérail de notre quotidien.
Théâtre la Sinne, Mulhouse, le 31 mai 2011



