Christophe Nick, l'auteur du documentaire Le jeu de la mort, qui pointait les dérives de la télé-réalité, revient sur cette expérience extrême qui a montré à plus de trois millions de téléspectateurs que la télévision exerce un réel pouvoir sur eux.
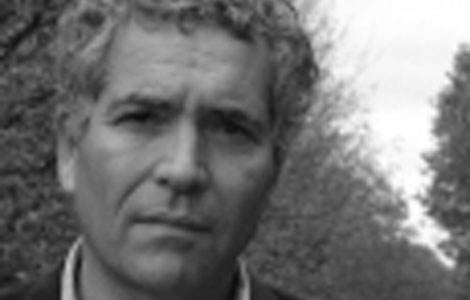
D'où vous est venue l'idée de réitérer l'expérience de Milgram pour tester l'autorité de la télévision?
Ça remonte au début des années 2000. Je travaillais sur une série documentaire, « chroniques de la violence ordinaire ». Je suis tombé par hasard dans une brocante sur l’édition originale du livre de Milgram. Je l’ai acheté, pensant que ça allait m’aider dans mes recherches. Ça ne l’a pas fait du tout, mais cette lecture est… fortement marquante ! Or quelques semaines plus tard, je suis, encore un hasard, tombé sur un jeu de TF1 : « Le maillon faible », qui m’a horrifié. L’animatrice, Laurence Boccolini, sadisait tellement ses candidats et ceux-ci semblaient si dociles que je me suis aussitôt dit qu’aujourd’hui, c’est plus à une animatrice de télé qu’à un scientifique que les gens se soumettraient. Cela m'a longtemps trotté dans la tête. En 2005, j’ai cherché quel disciple de Milgram pouvait m’en parler. J’ai lu plusieurs travaux, dont ceux de Jean Léon Beauvois qui m’ont beaucoup impressionné. Je l’ai contacté, lui ai parlé de l’idée. Il l’a, à son tour, ruminée pendant deux ans. Finalement, en mai 2007, il m’a rappelé pour me dire qu’il était d’accord pour tenter la transposition de l’expérience. J’en ai aussitôt parlé à Patricia Boutinard Rouelle et Fabrice Puchault, à la direction des documentaires de France 2. Ça n’a duré que deux minutes, ils ont dit oui tout de suite.
Qu'est-ce qui peut expliquer que 81% des candidats ont infligé jusqu'au bout le "châtiment électrique" alors qu'ils n'étaient que 62% dans les années 1960?
Les travaux de psychologie sociale, depuis Milgram, insistent sur un point très important, théorisé par J.L. Beauvois dans plusieurs de ses ouvrages : on se soumet à une autorité parce que celle-ci nous semble légitime à donner des ordres, même s’ils nous paraissent invraisemblables ou odieux. Si vous voyez un blessé au bord de la route et que vous voulez le secourir, mais qu’un type en blouse blanche vous dit : « je suis scientifique, laissez-moi faire » vous reculez aussitôt et le laissez faire. A vos yeux, il est légitime et vous lui obéissez. Parce que vous avez appris depuis que vous êtes toute petite à obéir à toute autorité légitime : vos parents, votre instituteur, votre médecin, votre patron, etc.
La grande question posée par J.L. Beauvois dès nos premiers contacts était la suivante : une animatrice télé n’a pas la légitimité à donner un ordre cruel. Elle a une autorité, c’est évident. Mais à l’extrême ? Intuitivement, je pensais que l’autorité télé était écrasante, lui pensait qu’elle n’était pas suffisante…
Et puis les résultats sont là… Or ce n’est pas tant les 81% d’obéissance qui constituent la plus grande surprise –on explique tout ça dans le livre. L’expérience que vous avez vu dans le film s’accompagne de plusieurs variantes. L’une d’elle est sensée faire désobéir tout le monde. En tout cas ça se passe comme ça chez Milgram : une deuxième autorité est aux côtés de la première quand, à 180 volts, après que le premier dit « continuez », le deuxième dit : « non, il faut arrêter, ça devient dangereux ». « Non, continuez, l’expérience exige que vous alliez au bout », « non non non, arrêtez tout de suite… » Bref : conflit entre deux autorités : TOUS les questionneurs désobéissent aussitôt. Ou plutôt : obéissent à l’ordre d’arrêter, parce qu’il s’accorde à leurs valeurs. Notion très importante, qui prouve, contrairement à e que Wolton affirmait, que l’homme n’est pas un loup pour l’homme mais bien un être social. Donc nous avons reproduit cette variante : une assistante de production intervient à 180 volts selon le même scénario. Or stupeur, ça n’a rien changé au résultat : nous trouvons dans cette variante plus de 75% d’obéissance. C’est ça qui est très différent de la situation chez Milgram. Alors pourquoi ? Nous ne faisons qu’ouvrir des pistes, et d’autres travaux devront y répondre. Mais pour nous, il ne fait aucun doute que nous sommes face à autre chose qu’une simple autorité qui abuse de son pouvoir. Jean Léon Beauvois et Dominique Oberlé ont emprunté à Pagès et De Gaulejac le concept de « système d’emprise » qu’ils avaient développé dans les années 70 pour décrire le système de pouvoir au sein d’une multinationale. Comme dans une multinationale, à la télé, le pouvoir n’est pas incarné, il est totalement dilué. Par contre, tout crée l’emprise : les caméras, le public, la mise en scène, le cérémonial, et bien sûr l’animatrice. Or cette emprise ne fonctionne que parce que les valeurs du système sont depuis longtemps diluées dans l’ensemble de la société. Chacun sait comment se comporter quand on passe à la télé parce que depuis que nous sommes nés nous voyons comment se comportent les gens sur un plateau, et donc dans « La zone extrême », face à une situation absolument inconnue, sans repère et totalement seul, la plupart des individus adoptent l’attitude qu’on leur commande en agissant comme ils ont l’habitude de le voir : en souriant… Bon, c’est un peu court, dit comme ça, et ça va encore faire hurler, mais il faudrait y passer des heures…
Nous pensons tous être libres, pourtant cette expérience prouve que ce n'est pas le cas. L'évolution du divertissement télévisé est-elle responsable de la passivité voire de la soumission des individus devant la télé?
Se croire libre alors que nous ne le sommes pas est un fait indépendant de la télé. Croire que nous disposons en permanence de notre libre arbitre, et donc que nous sommes seul totalement responsable de nos actes est une vision très idéologique. Nous sommes aussi en permanence confrontés à des situations de pouvoir, à des rapports à des groupes, à des contraintes de tout ordre. Nous ne sommes pas armés pour décrypter toutes ces situations. Le conformisme est aussi un puissant facteur qui détermine nombre de nos comportements. Que ne fait-on pas parce que nous sommes « aimables »… Qu’on ne veut pas déranger… Les techniques de communication, de persuasion nous font faire faire des choses absolument inouïes sans que nous nous en rendions compte. Changer de voiture tous les trois ans ! Acheter les deux paquets de chewing gum qui dépassent à la caisse du supermarché alors qu’on a trop de problèmes de dents pour mâcher ces trucs là ! Ne plus parler à Brigitte qui est devenue une emmerdeuse patentée comme le dit si bien la chef de service alors qu’elle est victime d’un harcèlement collectif, voici quelques exemples qui prouvent qu’on croit agir librement alors qu’on est sous influence… Le propre du libéralisme est de nous faire croire que nous sommes responsables de tout ce que nous faisons, pensons, disons. La réalité que démontre depuis des décennies la psychologie sociale, c’est que plus nous nous sentons libre et plus nous sommes obéissants. Il suffit de dire à quelqu’un « vous avez le choix » pour augmenter les chances d’obéissance.
Je crois que la nature des divertissements télé s’appuie depuis les années 80 sur la mise en scène de l’intimité, que cette mise en scène pousse ceux qui y passent à l’exhibition et donc ceux qui regardent au voyeurisme. La télé arrive à capter l’attention en jouant sur les pulsions. Le problème du voyeurisme, c’est qu’il n’entraîne que la frustration. Il faut donc régulièrement pimenter l’offre pour continuer à capter. Là, j’emprunte fortement au philosophe Bernard Stiegler. Voilà comment sont apparus les programmes humiliants, puis violents. Mais comme tout ceci est enveloppé dans des tonnes de rires, d’artifices de montage à la limite de l’hypnotique, nous nous retrouvons à regarder littéralement « scotché » en se disant « mais c’et pas possible » et on regarde quand même. Dix ans de télé-réalité nous ont fait admettre qu’il est parfaitement normal de s’éliminer les uns les autres, de souffrir pour gagner, et même d’être une ordure pour y arriver ! Ce qui était choquant il y a dix ans est devenu d’une banalité affligeante. Sauf que ces valeurs-là sont passées. Le patron d’Endémol expliquait récemment dans Le Point que « c’est normal parce que la vie est comme ça ». SA vie à lui, patron soumis aux pressions des marchés financiers : oui. Mais LA vie est tout autant faite de solidarités, de compassion et d’altruisme. Mais ce n’est ni hypnotique ni pulsionnel. Valeurs dominantes et techniques de captation finissent en système hégémonique, comme aurait dit Gramsci…
Est-ce que le simple fait de passer de téléspectateur passif à actif peut inverser cette tendance au renoncement à ses convictions face à la télévision?
Je ne sais pas si un téléspectateur peut être actif : par définition il assiste à quelque chose qui existe en dehors de lui. Il peut zapper s’il n’est pas happé, mais le problème n’est pas tant lui que les diffuseurs. Ce sont eux qui assument leurs programmes, le font en toute connaissance, parce qu’ils ont des impératifs. Ce n’est donc pas tant le « téléspectateur » qui peut agir sur le diffuseur que le citoyen par rapport à une logique d’ensemble. Vous me direz, c’est la même personne… Oui ! Juste, ce n’est pas en tant que téléspectateur qu’il faut se positionner mais en tant qu’individu autonome qui a le droit de se battre, d’émettre des opinions et d’agir avec les autres. Bref, en faisant de la politique. Mon dieu, qu’aurait dit Gramsci à ça ?
Les émissions de télé réalité vont de plus en plus loin dans la trashitude. Votre expérience prouve que les téléspectateurs obéissent à l'autorité télévisuelle. A terme, est-ce que la télé peut nous rendre sadique, voyeuriste et régenter notre vie?
Pas plus tard qu’hier, le CSA a « mis en demeure » la chaîne W9, propriété de M6 « de respecter à l’avenir le principe de respect de la dignité de la personne humaine ». Le nouveau jeu « Dilemme » montrait une candidate obligée de se comporter en chien pendant une journée pour gagner 6000 euros. Elle avait un collier autour du cou, tiré par une laisse par une autre candidate, marchant à quatre pattes et aboyant pour parler. Elle mangeait dans une écuelle, etc. Bon ! Je ne sais pas si ce spectacle nous rend sadiques. Je pense qu’il met en scène l’avilissement en toute impunité. Il est juste absolument incroyable que des équipes aient pu s’assoire autour d’une table et aient pu imaginer de telles scènes sans se demander s’ils n’étaient pas devenus dingues ! Il est encore plus incroyable que des diffuseurs trouvent ça… marrant ! Je sais que quand nos films sont sortis, beaucoup ont dit qu’on exagérait, que la loi interdisait ce genre de chose… Et quand la terre entière a découvert ce que le soldat 2e classe Lyndie England avait été capable de faire à des prisonniers irakiens à la prison d’Abu Ghraib, tout le monde s’est horrifié. Elle s’était contentée de mettre un collier de chien à un individu, et de le traîner par sa laisse. Trois ans de prison, quand même… Il faut croire que quand c’est à la télé, ça ne mérite qu’une « mise en demeure »…
Les candidats déboussolés ont été suivis psychologiquement après l'expérience. Pensez-vous ou savez-vous s'ils ont modifié leurs habitudes télévisuelles depuis?
Ils n’ont pas été « suivis » au sens où il leur aurait fallu une thérapie pour s’en sortir ! Ils ont vu des psychologues, ont répondu à de nombreux questionnaires, et ont eu la possibilité de consulter des spécialistes s’ils le souhaitaient. Nous sommes en contact encore aujourd’hui avec quasiment tous les candidats puisque nous préparons un documentaire pour France 5 sur eux. Je peux vous dire que pour beaucoup, c’et une expérience qui les a marqué, à modifié de nombreuses choses dans leur vie, et pour certains, a entraîné un changement radical de consommation de télévision.
Qu'espériez-vous en réalisant votre documentaire et le livre qui a suivi, une prise de conscience, un changement, un abandon de la télévision, qui comme internet est presque une drogue pour certains individus?
Allons-bon : qu’est-ce qu’on espère quand on fait nos métiers –travailleurs en média… Plus sérieusement : je trouvais très important d’alerter sur les dérives de la télé. Certainement pas de pousser à la casser : c’est AUSSI un instrument de diffusion des savoirs, et le genre « documentaire » en est la noblesse. Regarder la télé est aujourd’hui la deuxième activité de tous les êtres humains, après le sommeil, avant le travail. Penser que cela ne change rien à ce que nous sommes est au mieux de l’inconscience, au pire de la propagande. Mais ce n’est pas l’outil télé le problème, pas plus que le livre ou l’ordinateur, ou tout objet de l’industrie de la culture : c’est ce qu’on y regarde et ce qu’on diffuse. L’éditeur d’Apolinaire est formidable. Celui d’Hitler est une ordure. On ne va pas interdire les livres sous prétexte qu’Hitler a écrit Mein Kampf… Il y a des combats à mener au sein de la télévision et celui contre l’humiliation, le sadisme et la dégradation me paraît fondamental. Parce que ce sont des normes et des valeurs qui nous distinguent de la barbarie. Or ces valeurs sont devenues proprement banales ! Et là, c’est intéressant, mais il faut bien constater qu’il y a une rupture fondamentale entre la télévision de service public et les chaînes commerciales gratuites depuis dix ans… Il se trouve que pour faire cette démonstration, j’ai utilisé les principes de soumission de Milgram. J’ai parfaitement conscience que la démonstration de ces mécanismes a pris le pas dans les films sur la critique du contenu des programmes. C’est comme ça : on part d’un point et on arrive à un autre sans s’en rendre compte… Maintenant, sur la télé et Internet comme drogue, vous n’avez pas tord. Bernard Stiegler m’a appris qu’il travaillait avec une équipe de Marmotan sur les nouvelles addictions, et notamment la télé. Mais aussi la consommation… Ils considèrent cela comme des drogues dures…



