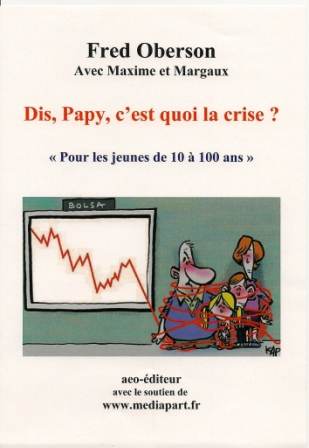
Avant-propos 9
I. La banque et la bourse 13
II. La bulle éclate 41
III. La crise 61
IV. Petite histoire des crises
18ème siècle 87
19ème siècle 93
2Oème siècle 105
V. Revue de presse 147
Extrait de l'Avant-propos :
Maxime et Margaux, mes petits-enfants, séjournent chez leur « Papy ». Il me faut bien accepter qu’ils m’appellent ainsi, même si ça fait vieillot ! En les côtoyant, il me semble redevenir un enfant. Du moins, ai-je conservé cet état d’esprit. En tout cas celui d’un ado. Seul, mon corps me rappelle les années qui se sont accumulées derrière moi. Il y a un siècle, à cet âge-là, je n’aurais certainement pas la joie de vivre, de jouer, de discourir avec eux. Ces membres qui manquent de souplesse, engourdis, parfois douloureux sont des signes qui ne trompent pas. Impossible de les courser à travers le verger. Impossible de les battre au baby-foot ou au ping-pong. Impossible parfois de leur répondre à brûle pourpoint à telle ou telle question. Leur esprit est vif, agile, curieux, impatient. Ils veulent tout comprendre, tout savoir, même des événements qui ne sont pas vraiment de leur âge. Je n’ai pas le droit de biaiser, d’éluder, de tourner autour du pot. À peine, acceptent-ils que je prenne mon temps, que je fasse une périphrase avant de répondre de manière claire et précise. Ils ont sans doute établi un parallèle entre le temps de réaction, la lenteur de mon esprit et celui de mes membres rhumatisants. Je suis stupéfait par tant de précocité. A leur âge, je devais être un attardé mental ! Ce qui me sauve dans cet échange, dans ce combat inégal, c’est la connaissance générale, l’expérience, le vécu, une vue d’ensemble.
(à suivre)
Début du Chapitre I. La banque et la bourse
- Papy, je ne comprends pas très bien tout ce qui se passe actuellement. À la télévision, on parle de crise, de faillite des banques, de récession, de chômage, questionne Maxime. Mon copain Julien me dit que son père est ruiné, il doit vendre sa maison.
- Mon grand, c’est un vaste sujet, à la fois simple et compliqué. Une soirée entière n’y suffirait pas pour t’expliquer la situation actuelle où même les puissants perdent la boule. D’abord, un petit historique sur les responsables du krach et de la crise : la banque et les banquiers. L’origine de la banque date de l’Antiquité, environ 3000 ans avant J.-C, en Mésopotamie. On les appelle des « changeurs », et l’on a recours à eux pour échanger les « écus », les pièces d’or car la monnaie diffère d’un roi, d’un seigneur ou d’un pays à l’autre. Auparavant, on échange les objets, les céréales, le produit de la chasse sans l’intermédiaire de la monnaie puisqu’elle n’existe pas. Cela s’appelle le troc dont l’origine se confond avec celle de l’homme. Il commence dès qu'un être suffisamment intelligent comprend qu'il peut échanger un silex contre une peau de bison sans devoir aller le chasser lui-même... Cependant l’échange n’est pas toujours de même valeur, et c’est ainsi que naît la monnaie, aux temps préhistoriques, sous diverses formes : coquillages, minéraux, petits lingots de métal. Le sel aussi sert à payer les légionnaires romains et a donné naissance au mot « salaire ». En France, le terme "banque" est employé depuis le XVe siècle. Il dérive de l'italien "banca" qui désigne un banc en bois sur lequel les changeurs de l'époque exerçaient leur activité.
(à suivre)
Début du Chapitre II. La bulle éclate
- Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi et comment les banques sont en crise et perdent des milliards en ce moment. Je vous ai raconté la fuite en avant des banques alors que personne ne tirait la sonnette d’alarme. Votre Papy était perplexe face à cette escalade. Par prudence ou par prémonition, il ne plaça pas ses quelques sous à la bourse. Dans le courant de l’année 2006, le prix de l’immobilier s’effondre aux Etats-Unis. La valeur des biens hypothéqués ne garantit plus les crédits octroyés aux petits propriétaires. Parallèlement, ceux-ci voient augmenter les intérêts, ils ne peuvent plus honorer les mensualités, près de 2 millions de ménages se font saisir leurs maisons et se retrouvent à la rue. Il faudra attendre février 2007 pour que la banque HSBC, l’une des plus grandes au monde, annonce d’importantes provisions pour amortir ses pertes supposées. À partir de l’été, c’est au tour des banques mondiales d’enregistrer des dépréciations d’actifs liées aux subprimes et aux produits titrisés. La perte, de l’ordre de 500 milliards de dollars, est couverte par les banques centrales et des augmentations de capital. En réalité, les pertes prévues sont bien plus importantes mais les banquiers sont des cachotiers qui arrangent leurs bilans en misant sur le remontée des cours.
(à suivre)
Début du Chapitre III. La crise
- Papy, la crise, on ne parle que de ça, mais pour nous rien n’a changé, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête, ni à toi, ni à Margaux ou à moi.
- Ne vous inquiétez pas, cela n’a rien à voir avec une crise d’asthme ou d’appendicite ! C’est en quelque sorte une hémorragie de liquidité comme si une artère avait éclaté et que le sang coulait à flots. Cela provoque une baisse de pression et le monde financier tombe dans les pommes. Mais cela ne se voit pas tout de suite, ce sont des pertes virtuelles, immatérielles… si l’on peut dire.
- Sauf pour ceux qui ont vraiment perdu leur bon argent ou leur maison.
- Je vois que tu comprends de mieux en mieux, Maxime. Le monde souffre de diverses crises cycliques qui n’ont rien à voir avec celle créée par l’effondrement mondial de la bourse et des produits dérivés. D’habitude, la bourse joue au yoyo, puis repart de plus belle. Cette fois-ci, c’est le krach. La valeur des actions de la quasi-totalité des entreprises industrielles, commerciales et de services a baissé en moyenne de 50%, pour atteindre 70, 80, voire 90% pour certaines. C’est une banqueroute sans précédent depuis la fin de la guerre de 1939/45 où l’Europe est ruinée et en partie détruite. On la compare à celle de 1929, le triste « jeudi noir » à Wall Street où la bourse perdit 27% en quatre jours.
- La fortune du monde est donc réduite de moitié ?
- Oui, d’une certaine manière, Maxime. Avant le krach, il s’agissait d’une fortune artificielle, irréelle, estimée sur le cours des actions dû à une expansion démesurée, aux placements à risque sur les produits dérivés. La valse des milliards et des billions, la spéculation ne produisent rien de tangible, de concret, contrairement à l’agriculture, à l’industrie, à l’extraction de matières premières, de pétrole ou aux services. Personne n’a tiré la sonnette d’alarme, personne n’a crié casse-cou. Tout le monde trouvait son compte dans cette société de consommation. Tôt ou tard, ça devait sauter. La fortune mondiale… est encore surestimée, elle pourrait encore diminuer. Personne n’est capable de dire combien de milliards sont partie en fumée. On cite des chiffres invraisemblables de l’ordre de 30.000 milliards de dollars ! Car cette soi-disant fortune, ce n’est pas de la monnaie, des espèces, de l’or, ce ne sont, pour la plupart, que des échanges d’écritures purement comptables. Et ces écritures se compensent entre ceux qui doivent et ceux qui possèdent. La fortune n’est rien si elle ne produit pas de ressources. Elle s’amenuise avec l’inflation. Vous comprenez ?
(à suivre)
Début du Chapitre : IV. Petite histoire des crises, 18ème siècle
C’est tout un programme… car au long des deux siècles passés les crises ont suscité des guerres et les conflits, les bouleversements politiques ont été le prélude à des crises !
L’histoire contée par leur Papy interpelle la curiosité de mes petits enfants. En fait de contes, ce sont plutôt les comptes et les mécomptes du temps passé que je vais leur raconter. Je change donc de registre, entremêlant les inventions, à l’origine du bien-être et de l’économie actuels, les révolutions, les guerres et les crises, bien évidemment ! À quelle époque vais-je commencer ? Aux puissants seigneurs, aux rois fainéants, à la paysannerie, à l’artisanat, aux prémices de l’industrie ? En prenant un ton académique, celle d’un vieux maître d’école bigleux :
- Il était une fois… la France, pas celle des Gaulois qui se battaient contre les Romains. Je pense qu’Astérix et Obélix n’ont plus de secrets pour vous.
- Ah oui, c’est trop fort, mais je préfère le druide Panoramix et sa potion magique dans laquelle Obélix est tombé quand il était petit.
- Astérix, il est génial avec ses grandes moustaches. Tu lui ressembles, Papy.
- Quelle comparaison, Margaux ! Je ne suis pas un Gaulois mais un Helvète. Encore que cette ressemblance me fasse réfléchir car l’origine du peuple Gaulois se situerait du côté de Neuchâtel qui, à l’époque, n’était pas encore la Suisse. Serait-il par hasard notre aïeul à nous trois ? Je fantasme, revenons aux choses sérieuses, au 18ème siècle par exemple. En ce temps-là, il y avait des rois, des seigneurs, des bourgeois, des paysans et des artisans pour construire les diligences, les charrettes et les armes des conquérants. Citez-moi des rois de cette époque.
Vers le 19ème siècle
- Papy, tu me fais rigoler avec tes histoires. Je sais aussi que Napoléon a occupé la République de Genève avant qu’elle se rallie à la Suisse.
- Tu as raison, Maxime. Il annexa Genève au Département du Léman qui comprenait le Pays de Gex et une partie de la Haute-Savoie, jusqu’à Chamonix.
- Alors, le Mont-Blanc était genevois !
- Pas du tout, c’est Genève qui appartenait à la France, de 1798 à 1814. Jusqu’au sauve-qui-peut de Napoléon. D’ailleurs, nombre d’institutions genevoises sont d’origine napoléonienne, comme la Cour d’Assise, le Tribunal d’Instance, la Taxe professionnelle. Vous savez certainement que ce cher Empereur mit l’Europe à feu et à sang. Jusqu’à la défaite de Waterloo qui marqua la fin de l’Empire et la perte des territoires conquis par le Corse. Je vous raconte un coup de bourse remarquable : Informé de la défaite napoléonienne avant les autorités, Nathan Rothschild se rend à la Bourse de Londres et met en vente tous ses titres et ceux qu’il n’avait certainement pas. Tous pensent alors que Napoléon est sorti victorieux du combat contre les Anglais. Gagné par la panique, chacun suit son exemple. Les actions chutent à une vitesse folle. Rothschild attend la dernière minute puis les rachète et assoit ainsi la fortune familiale. Depuis la chute de Napoléon, la monarchie est réintroduite en France. Trois rois se succèdent de 1814 à 1848 : Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe.
- Celui qui a fabriqué les meubles que tu vendais dans ta ferme d’antiquités, Papy ?
- Non. Laisse à Louis XVI les serrures, mais ce roi-là n’est pas ébéniste. C’est le style de ce que l’on fabrique à son époque, et bien au-delà, pour les bourgeois. Le peuple n’a pas les moyens d’acquérir des meubles en noyer ou en acajou. Plus de trois décennies royalistes n’ont pas amélioré le sort des petites gens.Depuis plusieurs années, les Français subissent une crise économique sans précédent, à laquelle se superpose une crise du crédit qui met en péril le devenir de l’industrie, de l’artisanat et du commerce. Des capitaux considérables sont bloqués à long terme pour la construction du réseau de chemin de fer et l'argent fait défaut pour financer l’économie normale. Il manque des banques de dépôts drainant des capitaux plus importants provenant de l'épargne publique. Comme un malheur n’arrive jamais seul, une crise agricole éclate à cause du froid, de la sécheresse, des orages et de la grêle. Un ouvrier doit travailler une journée entière pour s’acheter deux kilos de pain !
20ème siècle
- Le moment est venu de sauter dans le 20ème siècle, en fanfare !
- Les fanfares, comme celles qui défilent lors du cortège de la fête nationale ?
- Oui, si l’on veut, Maxime. « En fanfare » est une expression évoquant la fête, le panache pour marquer un événement, en l’occurrence le passage d’un siècle à l’autre. Mais je n’aime pas trop les fanfares qui interprètent souvent des marches militaires.
- Moi si, c’est drôle, j’ai vu à la télé la Garde Républicaine qui joue à cheval et la fanfare des Légionnaires avec leurs képis blancs.
- Votre papa joue de la clarinette ?
- Oh ! oui, il improvise sur des airs de jazz, il est très fort.
- C’est précisément au début du XXe siècle que le jazz est né dans le delta du Mississipi et à la Nouvelle-Orléans. Il provient des chants de travail dans les plantations de coton, des negro-spirituals et des gospels chantés dans les églises par les esclaves africains. Il donnera naissance au blues, au boogie-woogie, au dixieland et au swing. Des musiciens célèbres : Kid Ory, Sydney Bechet et Louis Armstrong le feront connaître dans le monde entier. Puis ce sera le tour des big bands de Duke Ellington, de Count Basie et de Glenn Miller, pour ne citer que les plus connus. Foin de parlotte, ce soir, je vous emmène à Saint-Rémy, dans les ruines romaines de Glanum, écouter un jazz -band local.
- Dommage que Papa ne soit pas là pour les accompagner.
- Cela aurait été chouette, mais après le jazz et la java… demain, nous reviendrons aux choses sérieuses, plutôt à des événements sanglants. J’ai omis de vous dire quelques mots sur la guerre expéditive franco-allemande de 1870 qui entraîne la chute de l’Empire français de Napoléon III et la création de la 3ème République. Suite à la défaite, Paris est encerclé par les troupes prussiennes. La ville est bombardée chaque jour, le blocus dure cinq mois, dans le froid et la faim. La France capitule le 28 janvier 1871. La population parisienne, qui a résisté douloureusement, perçoit cette capitulation comme une véritable trahison de la part du gouvernement. La Garde nationale et les ouvriers de Paris refusent d'accepter la défaite et prennent le contrôle de la capitale, le 18 mars, mettant en place un gouvernement insurrectionnel et populaire : la Commune de Paris. Avec l'accord tacite des Prussiens, celle-ci est combattue puis écrasée, deux mois après, lors de la « semaine sanglante », provoquant la mort et l’exécution sommaires de près de 30.000 citoyens. La France doit payer une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or à l’Allemagne. De plus, elle cède les départements de l’Alsace-Lorraine annexés par Louis XIV en 1681. Cette somme énorme manque à la France pour développer son économie et le bien-être des citoyens.
Pour commander le livre par téléchargement ou le livre papier, rendez-vous sur le site :
http://dispapy.leforum.eu/portal.php?pid=7



