Les grands média et la classe politique répètent de manière incessante que « l’Europe est notre avenir » et qu’aucun des grands problèmes contemporains ne peut être résolu à l’échelle nationale. La mondialisation conduit-elle réellement à l’effacement des États-Nations au profit de structures continentales ou mondiales ?
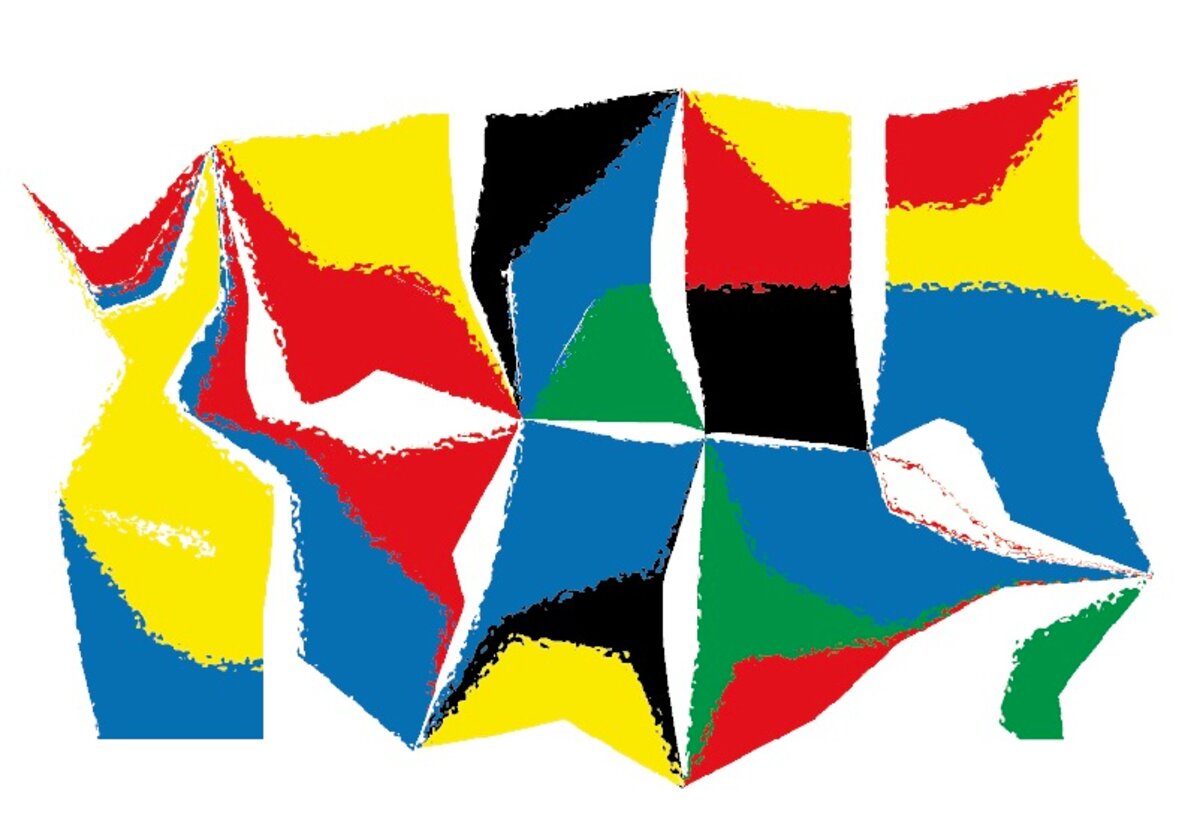
Agrandissement : Illustration 1
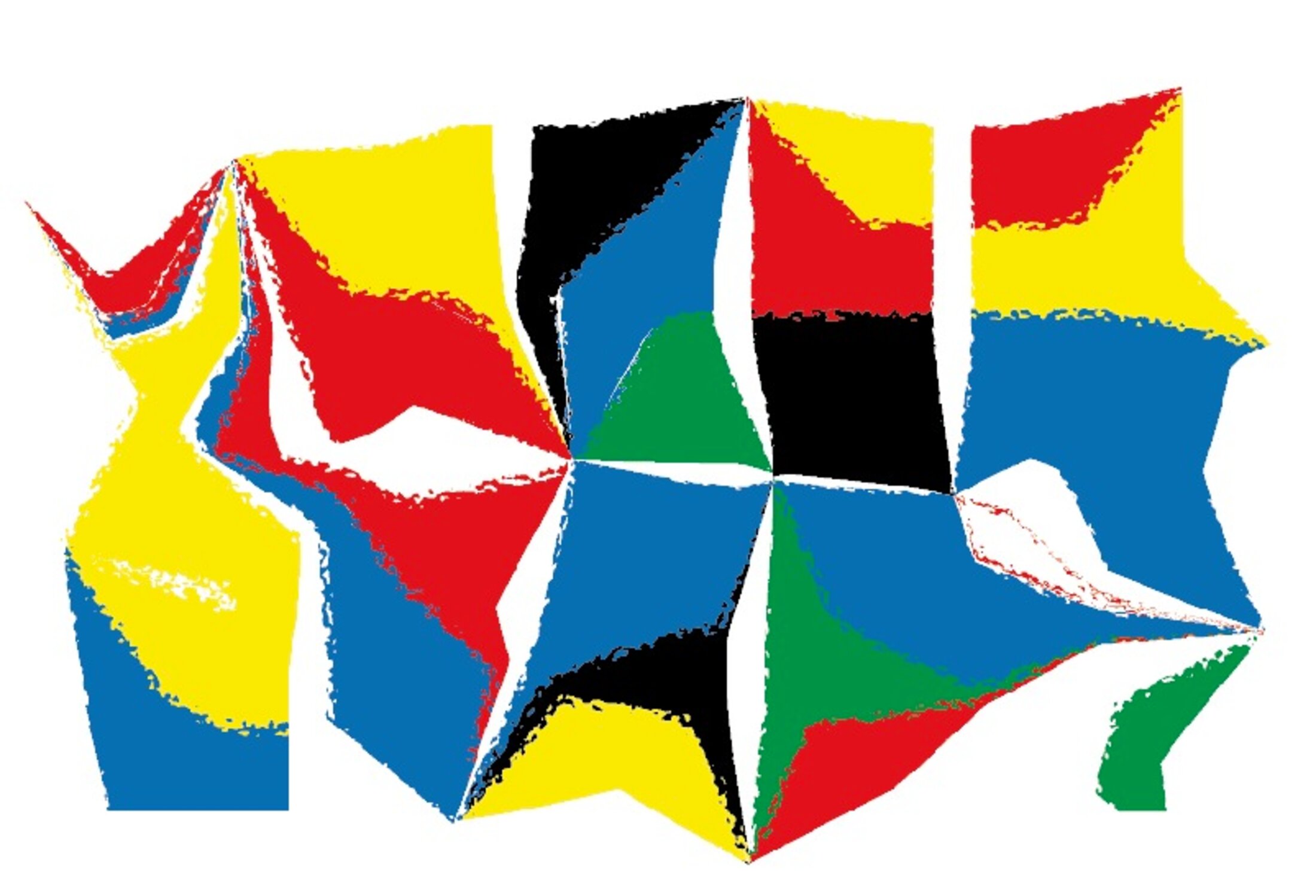
Par Gilles Ardinat*
La transnationalisation des « élites »
La classe dirigeante actuelle semble prendre ses distances avec le cadre national au profit de solutions « supranationales » (Union européenne et OTAN). Cette inflexion majeure de nos « élites » s’appuie sur une théorie abondante. Pascal Lamy, ancien directeur général de l’OMC, est le symbole de ce mouvement idéologique : il prône un gouvernement « alternational » dont l’Union européenne serait le laboratoire avancé (voir son ouvrage de 2004). Ce discours est omniprésent dans le débat public. Les nations en général et la France en particulier sont « trop petites ». Les solutions nationales sont associées à « un repli sur soi ». En somme, l’horizon national est présenté comme obsolète, voire archaïque. Cet argumentaire peut se résumer en quatre points :
• La mondialisation a internationalisé les problèmes (terrorisme, environnement, économie…).
• Les solutions doivent donc s’inscrire à une très petite échelle (l’Union européenne, le G7, l’ONU…).
• Les États-Nations sont donc totalement dépassés et impuissants. Ils doivent fusionner en de grands blocs et transférer leurs compétences à des échelles adéquates.
• Le nationalisme est une idéologie dangereuse, de tendance fasciste, qu’il faut remplacer par un idéal transnational : « le nationalisme, c’est la guerre » (Mitterrand, 1995).
Un déclin des États-nations très relatif
Dans le discours dominant, l’effacement de l’État-Nation est présenté comme un progrès inéluctable (argument du « sens de l’Histoire »). Néanmoins, cette analyse est très contestable. En dépit de leur affaiblissement relatif, les États restent les acteurs clés de la mondialisation. Rappelons que depuis ses débuts, la mondialisation s’est faite sous l’impulsion des États (Grandes découvertes, construction d’empires mondiaux…). Historiquement, la mondialisation ne correspond pas à la destruction des États, mais plutôt à leur déploiement dans l’espace mondial (via la diplomatie, les conquêtes coloniales ou des entreprises proches des gouvernements). Le néolibéralisme, initié depuis les années 1980, a certes réduit le pouvoir de régulation des États (déréglementation, privatisation, augmentation du pouvoir des firmes transnationales) mais le poids des gouvernements reste tout de même déterminant. Lors de la crise de 2008, ce sont les gouvernements nationaux qui ont pris l’initiative face à la crise. Ni le FMI, ni la Banque Mondiale, ni l’UE n’ont apporté de réponses. Ils se sont simplement associés à un concert de nations souveraines (le G20). Ainsi, un plan de relance concerté a été décidé. Rappelons également que la plupart des phénomènes présentés comme « mondiaux » restent liés aux États (exemple du terrorisme « sans-frontières » qui est la plupart du temps l’émanation d’un État). Enfin, le sentiment national, loin de disparaître face à la mondialisation, est extrêmement vivace dans la plupart des pays. Si l’identité européenne ou le « citoyen du monde » restent largement des utopies, le patriotisme se manifeste notamment comme une alternative à la mondialisation sauvage.
Démocraties nationales contre oligarchies transnationales ?
De l’aveu même d’un ancien économiste de la Banque mondiale, la mondialisation souffre d’un « déficit démocratique » (Joseph Stiglitz). Il serait plus juste de parler d’absence démocratique tant les notions de peuple et de souveraineté semblent embarrasser les technocrates du FMI et de Bruxelles. Chacun constate l’influence croissante des groupes de pression et de la finance au sein de ces cénacles de la mondialisation. L’Union européenne, cheval de Troie de l’ultralibéralisme et des intérêts américains sur le vieux continent, se construit de plus en plus contre la démocratie (viol du référendum de 2005, refus de consulter les Grecs en 2011…). Après des décennies d’intégration communautaire et de libre-échange mondialisé (GATT puis OMC), le bilan est sans appel : les institutions européennes et mondiales n’ont œuvré ni pour le progrès social, ni pour la participation citoyenne. « L’Europe qui protège » et « la mondialisation heureuse » sont des slogans vides de sens.
Or, face aux firmes transnationales, aux logiques financières et à l’impérialisme, les seules réponses cohérentes se sont faites dans des cadres nationaux. Evo Morales, président de Bolivie, a progressivement sorti son pays de la sujétion. Il a été largement réélu en octobre 2014. En 2011, l’Islande, pays très soucieux de sa souveraineté, a usé du référendum pour se sortir de la spirale du surendettement (malgré les pressions du Royaume-Uni, pays 200 fois plus peuplé et beaucoup plus influent dans la mondialisation). En janvier dernier, les Grecs ont porté au pouvoir un parti anti-austérité : une élection nationale a permis de tordre le bras de la Troïka. En somme, face à la dérive oligarchique et financière de la mondialisation, les États-Nations apparaissent comme les seules instances où la démocratie peut s’exprimer avec efficacité. En effet, des ensembles hors-sol et sans identité sont incompatibles avec l’exercice de la citoyenneté. Celle-ci nécessite un minimum de proximité, un sentiment d’appartenance, une histoire et des valeurs communes.
L’État-Nation apparaît comme la seule instance permettant une expression démocratique légitime susceptible de faire barrage aux puissances de l’argent et à l’hégémonie de l’empire américain. Par pur cynisme, les apôtres du marché tentent justement de dissimuler cette réalité (géo)politique en accusant le patriotisme de tous les maux (réaction, égoïsme, racisme…).
*Gilles Ardinat est géographe. Agrégé, il est docteur de l'université Paul-Valéry de Montpellier.
La Revue du projet n°46, avril 2015.



