Des déviances alcooliques et sublimes logorrhées égotistes d’un héros mis au ban d’une Amérique blanche et aseptisée chez Frederick Exley, aux sournoises inimitiés langagières entre collègues de bureau dans un huis-clos étouffant chez David Carkeet, les éditions Monsieur Toussaint Louverture plongent leurs lecteurs au cœur d’anomies singulières et de microcosmes en panoptique, pour le meilleur du pire !
Les femmes aussi ont faim et soif
Un fameux éditorialiste de Canal + – après avoir souligné les immenses qualités de Frederick Exley – a qualifié ses livres de « livres pour mecs ». On s’est évidemment précipitées, sait-on jamais, rien que pour la valeur informative ou explicative, cela peut valoir le coup. Enfin pas vraiment précipitées, car pour être tout à fait honnête, toutes femmes que nous sommes, nous les avions déjà en notre possession, ces fameux « livres pour mecs ».
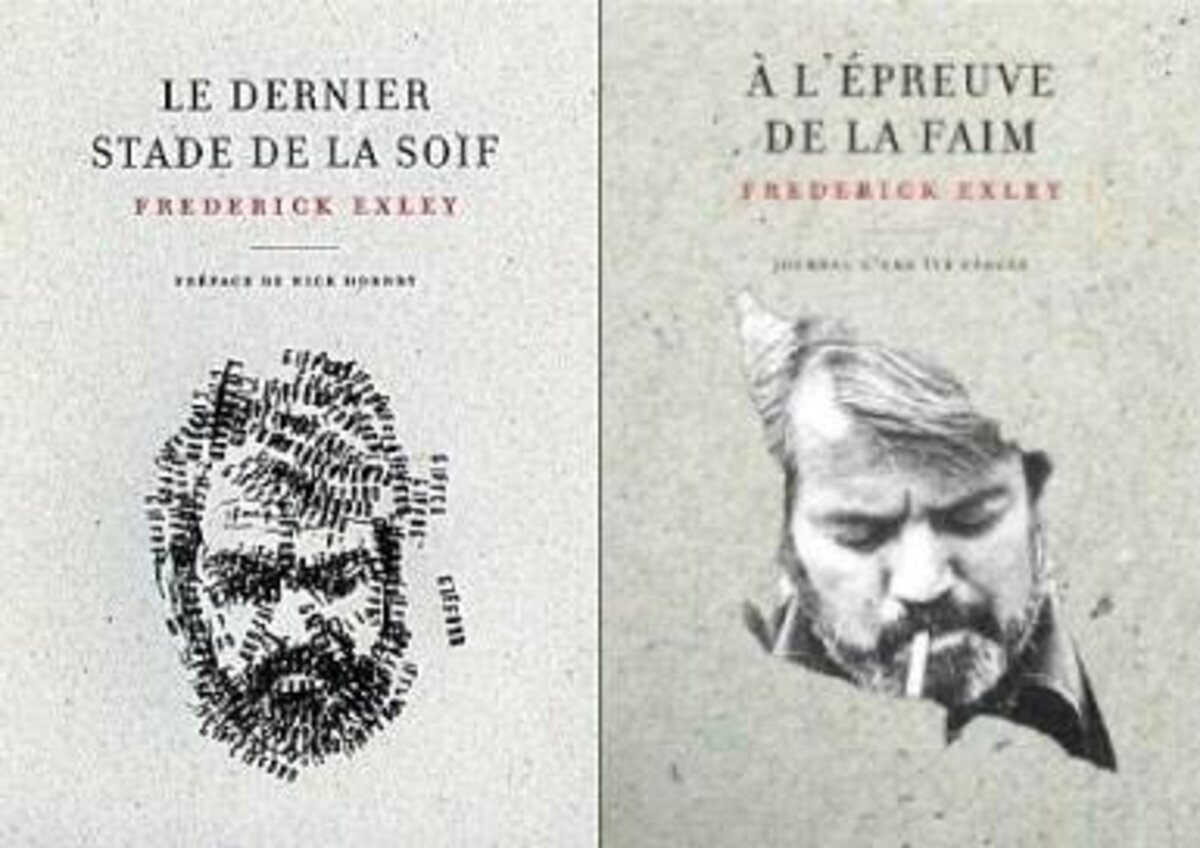
En deux mots, Frederick Exley fait partie de ces petits trésors enfouis de la littérature américaine du XXè siècle, il était injustement oublié et jusqu’en 2011 non traduit en France. Les éditions Monsieur Toussaint Louverture ont eu l’heureuse inspiration d’enfin proposer en français le titre qui lui a valu une certaine notoriété de son vivant : Le dernier stade de la soif (A fan’s notes – 1968), et publient aujourd’hui À l’épreuve de la faim (Pages from a cold island – 1975).
Avec Exley, on retrouve le pire et le meilleur de ce que l’Amérique peut offrir. La volonté, la rage de vaincre, l’engagement… mis KO par le whisky et la vodka. La recherche insatiable de la reconnaissance, du regard fier d’un père, de l’amour d’une femme aux jambes interminables et bonne cuisinière… brisée en plein élan par les lâchetés ordinaires d’un homme qui ne cherche, finalement, qu’à survivre en Amérique.
« Nous avions déçu nos familles par notre incapacité à fonctionner correctement en société (une définition de la folie qui en valait bien d’autres). Nos familles, les yeux emplis de larmes et d’auto-apitoiement, avaient prié les médecins de nous donner à nouveau l’envie de redémarrer dans la bonne direction. Ces directions – une famille et une femme, un poste de vice-président et une Cadillac – variaient selon le terne aveuglement familial. » (Le dernier stade de la soif, p 105).
Exley donne à voir la médiocrité et les faiblesses que ses contemporains triomphants veillent à évacuer sans charité. Il rencontre les tordus, les inadaptés, les incapables, les dérangés même. Mais de ceux-ci ou des « normaux » il ne sait pas lesquels l’effrayent le plus :
J’avais, de je ne sais quelle façon, atterri au beau milieu d’une famille étonnante, si incroyable que pour la première fois de ma vie j’envisageai la possibilité que Norman Rockwell ne fût pas fou à lier […] Je me sentais comme un homme qui mange trop vite, boit trop, oublie parfois de se laver les dents et de se nettoyer les ongles, s’adonne au grattage pensif de ses parties et au largage ponctuel de pets, et qui se réveille un beau matin en couverture du Saturday Evening Post, en train de découper la putain de dinde de Thanksgiving pour une famille qu’il ne connaît ni d’Ève ni d’Adam. (Le dernier stade de la soif, p 83).
Ce cher « Ex » fait complètement partie des médiocres. Il est détestable, fabuleusement égocentrique, monstrueusement irresponsable. Et très (trop) porté sur la boisson et le sexe. Bref, presque « français » d’un point de vue purement WASP des années 70. Ce qui lui vaut plusieurs séjours en hôpital psychiatrique et des traitements à base d’électrochocs et de chocs d’insuline carabinés. Mais ce ne sont pas les démons de l’alcool ou le péché de chair qui le tourmentent. Les mots d’Exley, ce sont un peu les soubresauts de rébellion nécessaire d’un nouveau Falstaff : toujours vulgaire, grossier, dépravé, il a enfin le parterre pour déblatérer tout son soûl. Et il le fait de brillante manière.
Attention donc, ces livres sont justes, fins, francs, drôles, jubilatoires même, libérateurs. Mais ce sont des livres pour mecs.
Ils sont virtuoses, pour la langue adroite et précise, pour l’imagination et l’originalité, pour l’art de la narration. Mais ce sont des livres pour mecs.
Ils sont à la fois intelligents, cyniques, sans complaisance, et profondément humains. Mais ce sont des livres pour mecs.
E.C
Le dernier stade de la soif, Frederick Exley, traduit par Philippe Aronson et Jérôme Schmidt, Monsieur Toussaint Louverture, 2011, 978-2953366433, 24 euros (également en poche, chez 10/18)
À l’épreuve de la faim, Frederick Exley, traduit par Emmanuelle et Philippe Aronson, Monsieur Toussaint Louverture, 2013, 979-1090724037, 22 euros.
Meurtre chez les linguistes
« Le nouveau là, t’en penses quoi ? » « Après je ne sais pas moi, chacun son travail » « Elle est bipolaire, c’est évident. » « T’as eu son mail collectif ? La honte. » « J’espère qu’il ne va pas penser que j’ai dit ça pour qu’il croie ça, parce qu’après il va sûrement se dire que je pense qu’il le croit et m’en vouloir de le croire capable de penser ça, alors que bien sûr ce n’est pas vrai. »
Bureau : principal lieu de développement et d’entretien d’obsessions malsaines autour de la discorde quotidienne et la haine ordinaire.
Mots : principaux facteurs de malentendus et donc sources desdites haines et discordes. Objets d’étude d’imparfaits linguistes, notamment à l’Institut Wabash.
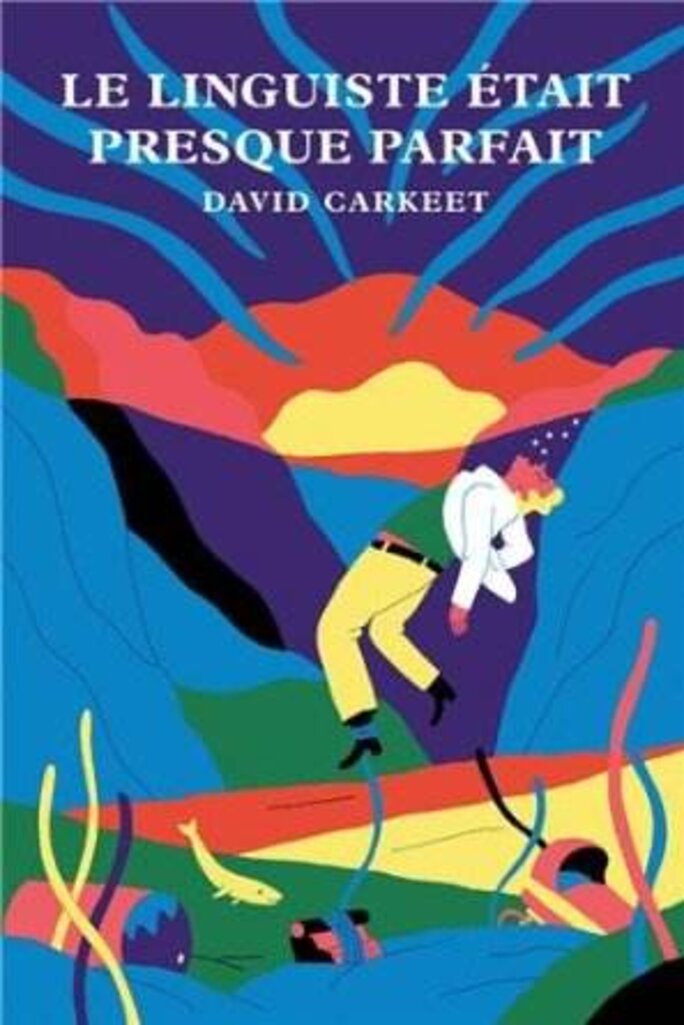
Wab…quoi ? Wabash. Dans l’Indiana sud, le comté de Kinsey. Les linguistes Cook, Milke, Stiph, Woeps, Wach et Aaskhugh (à vos souhaits). Malgré leurs noms alambiqués, leur bled paumé et leurs fonctions improbables, ils coulent des jours tranquilles, jusqu’à ce qu’Arthur Stiph soit retrouvé un matin, tranquillement installé dans le bureau de Cook… mort. Le coupable se trouve forcément parmi les linguistes.
D’où l’importance d’identifier leurs imperfections, les petits accros et flagorneries entre collègues, qu’ils dissimulent dans leurs mots, déformation professionnelle oblige.
Imparfaits, ils le sont chacun à leur manière : un imbibé macho, une commère, un maladroit chronique… Mais dans le cas de Jeremy Cook, notre héros, le « presque » du titre peut paraître euphémistique. Cook est un peu tout cela à la fois, et paranoïaque, curieux voire intrusif, alcoolique à ses heures, malhabile donc souvent déconfit… mais il a de la bonne volonté, et s’investit dans l’enquête. Qui n’avance que difficilement, malgré l’implication – certes lunatique – du lieutenant Leaf (encore un nom qui n’est pas là par hasard, c’est un policier pour le moins léger).
Nous voici donc lancés dans la traque aux inimitiés. On tourne en rond avec les personnages – littéralement – dans ces couloirs et bureaux machiavéliques disposés en cercle au 6è étage de l’Institut de linguistique. Et les secrétaires font des malaises, et les auxiliaires s’affolent, chacun s’observe en coin. Ce qui intéresse Cook, c’est ce que les gens disent et comment ils le disent, c’est là, il en est persuadé, que se trouve la clé du meurtre. Dans un âge trop bavard, on ne se fie jamais assez aux mots et à leur vérité, à la langue et à ce qu’elle dit des relations entre les gens. Qui sait, la preuve par la linguistique est peut-être une solution pour atteindre enfin l’harmonie entre les peuples ? Ou entre collègues, pour commencer.
Soyez rassurés, le méchant est puni et l’amour triomphe. Seulement, tout est encore une fois une affaire de noms n’est-ce pas ? Vous les voulez ? Il faudra le lire…
E.C
Le linguiste était presque parfait, David Carkeet, traduit de l’anglais par Nicolas Richard, Monsieur Toussaint Louverture, 2013, 979-1090724044, 19 euros.
Retrouvez les chroniques d'Emeline Colpart sur Libfly et sur son blog
L'édition La Voie des indés est une édition participative. N'hésitez pas à nous soumettre vos chroniques de lecture à propos des nouveautés de l'édition indépendante francophone.



