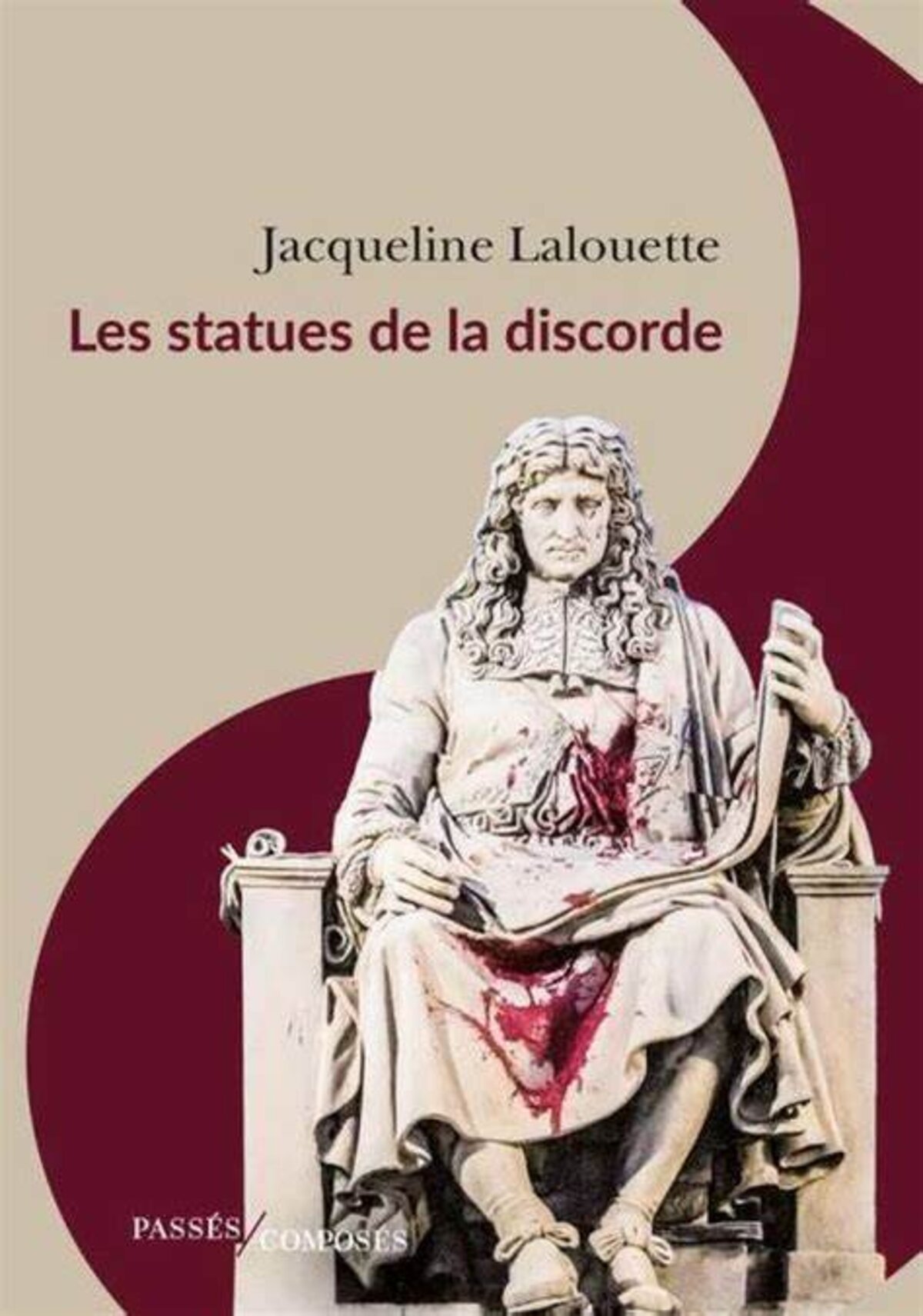
Agrandissement : Illustration 1

Une vague de contestation, mutilations et destructions de statues a touché les USA et la Grande-Bretagne ainsi que, de façon bien moindre, l’Europe de de l’Ouest, à la suite de la mort dans des conditions terribles de George Floyd. C’était le 25 mai 2020. Le mouvement Black Lives Matters, né en 2013 contre les violences policières visant les Noirs, s’investit dans ces manifestations. Jacqueline Lalouette consacre le premier chapitre de son ouvrage « Les statues de la discorde » à un tour du monde de ces statues vandalisées ou détruites. La première fut renversée le 31 mai. C’était celle érigée en Alabama à Charles Linn, un Suédois émigré aux USA et devenu officier dans la Marine confédérée (sudiste). Une foule d’autres ont suivi. Celles de souverains (Victoria, Léopold II, Baudoin…), de ministres (Bismarck, Churchill…), d’explorateurs (Christophe Colomb, James Cook…), de militaires (de nombreux généraux confédérés, Louis Botha, Louis Faidherbe…)… pour ne mentionner que les plus connus. Jacqueline Lalouette en effectue une recension précise, en présentant les biographies des personnes statufiées. Elle note que la recension méticuleuse en ligne sur Wikipédia en anglais omet deux statues : celles de Louis XIV à Louisville et de Cervantès à San Francisco.

Jacqueline Lalouette consacre deux chapitres étoffés à la France. Elle inventorie seize statues contestées ou vandalisées. Cinq de ces statues, en Guadeloupe, Martinique et Guyane, représentaient Victor Schœlcher, ce qui a suscité un certain étonnement. Ses engagements humanistes, marqués par l’époque où il vivait, mais en avance sur les opinions de son temps, sont contestés car ils minimiseraient les combats des esclaves. Dans son ouvrage de référence « Les traites négrières », Olivier Pétré-Grenouilleau a rétabli les faits : « Souvent occulté ou sous-estimé dans l’histoire du processus abolitionniste, le rôle des esclaves doit être réhabilité sans toutefois conduire à des excès inverse ».
D’autres statues représentaient des généraux colonisateurs français quelque peu oubliés : Bugeaud, Lyautey, Gallieni, Faidherbe… le gouverneur des Mascareignes (La Réunion et l’île Maurice), le vice-amiral Léon Olry, Joséphine de Beauharnais, épouse de Napoléon, et Napoléon lui-même, Christophe Colomb, Charles de Gaulle… Le cas de Colbert est détaillé sur une dizaine de pages. Il a bien impulsé la rédaction, et non rédigé et non signé, un texte qui sera publié après sa mort et auquel on donnera plus tard le nom de Code noir. Selon Robert Badinter, cette ordonnance fut « moins l’expression d’un racisme particulier à Colbert et aux juristes qui l’entouraient que d’une volonté de tout réglementer dans la monarchie absolue ». Selon d’autres commentateurs la violence extrême et généralisée (sur les gens du peuple, et pire sur les esclaves) de l’époque aurait été amoindrie si cette réglementation, scandaleuse pour les lecteurs actuels, avait été appliquée. Ce qui n’a pas été le cas.

Un débat, certes laborieux, semble s’être ouvert. Il faut d’abord rappeler que cette pratique de destruction de monuments est loin d’être nouvelle. Lorsque les chrétiens ont pris le pouvoir en Europe, de nombreux temples et lieux païens furent éradiqués. Plus tard, c’est entre chrétiens que se sont réglées, parfois par les armes, les querelles autour des icônes puis entre catholiques et protestants. Sous la Révolution française, les statues et emblèmes de la royauté ont été mis à mal. C’est à ce moment que l’abbé Grégoire crée le mot « vandalisme ». Il commente « Je créais le mot pour tuer la chose ». Récemment des groupes radicaux musulmans, Talibans, partisans de Daesh… ont détruit des monuments et des statues. Chaque poussée de vandalisme a ses caractéristiques et ses motivations. Il faut les replacer dans leurs époques respectives. Plusieurs ouvrages dénoncent ces phénomènes. Louis Réau a ainsi pu écrire en 1958 une érudite « Histoire du vandalisme. Les monuments détruits de l’art français » qui sera revue et augmentée dans la collection « Bouquins ». En 1953 un court métrage documentaire "Les statues meurent aussi" est réalisé par Chris Marker, Alain Resnais et Ghislain Cloquet pour dénoncer la dévalorisation de l'art africain.

Agrandissement : Illustration 4

Jacqueline Lalouette consacre un chapitre final à créer les conditions d’une réflexion collective rationnelle. Replacer chaque statue dans son histoire, sans anachronisme. Pourquoi s’en prendre par exemple à Cervantès qui n’eut aucun lien avec la colonisation et l’esclavage, et qui fut lui-même réduit en esclavage à Alger pendant cinq ans ? Réfléchir au sort de certaines statues: les accompagner de commentaires pédagogiques ? Les déplacer dans un musée ? Créer de nouvelles statues ? Le président de la République s’oppose à toute destruction et propose un catalogue "Portraits de France" à partir duquel il est possible d’enrichir la statuaire publique. Jacqueline Lalouette présente plusieurs de ces personnages. Parmi les commentateurs, les uns, comme Françoise Vergès, veulent aller beaucoup plus loin. Les autres, comme Boris Cyrulnik, pronostiquent un risque de victimisation excessif. Selon un arrêt du Conseil d'Etat, ce sont les municipalités qui décident : « Le maire tient de ses pouvoirs généraux de police le droit de contrôler les dénominations de toutes les voies et d’interdire celles qui seraient contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ».
Jacqueline Lalouette cite en conclusion Frantz Fanon qui, en 1952 dans « Peaux noires, masques blancs », s’interrogeait : « Vais-je demander à l’homme banc d’aujourd’hui d’être responsable des négriers du XVII° siècle ? Vais essayer par tous les moyens de faire naître la Culpabilité dans les âmes ? Je ne suis pas esclave de l’Esclavage qui déshumanisa mes pères… Le Nègre n’est pas. Pas plus que le Blanc. Tous deux ont à écarter des voix inhumaines qui furent celles de leurs ancêtres respectifs afin que naisse une authentique communication ».
Une autre édition de la Ligue de l'enseignement sur Médiapart:
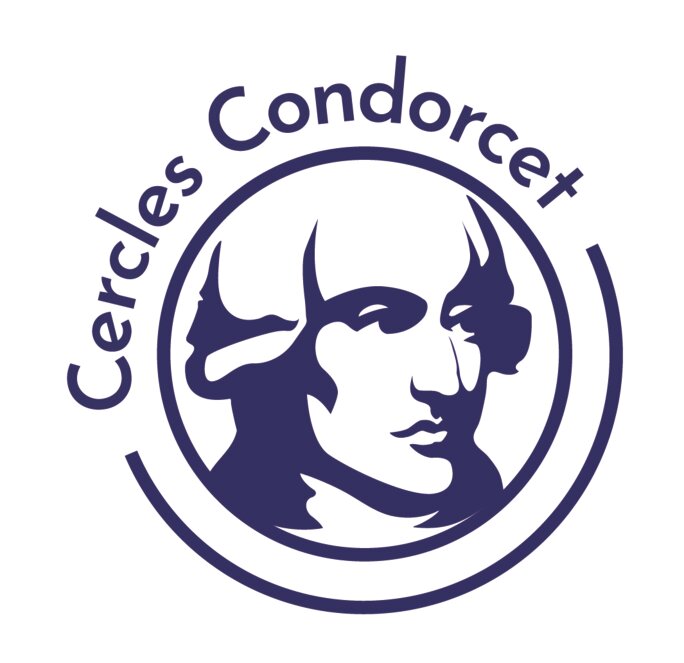
Agrandissement : Illustration 5
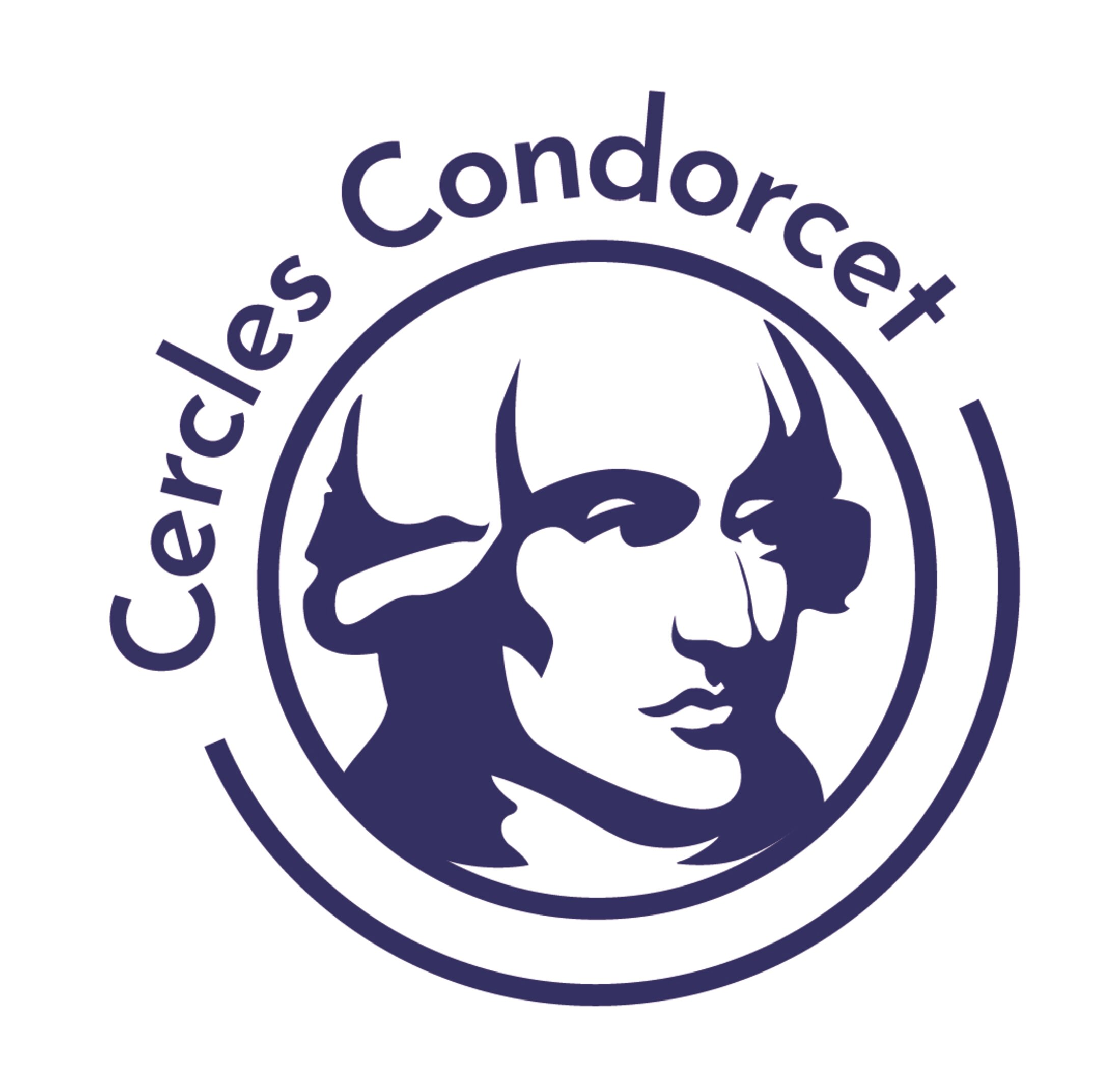
Les Cercles Condorcet accompagnent la vie intellectuelle et militante des fédérations départementales de la Ligue de l'enseignement, grand mouvement d'éducation populaire laïque. Une cinquante de Cercles rassemblent environ 2.000 personnes.
Ils animent une édition sur Médiapart Ne manquez pas de la consulter !



