La plupart des commentateurs sont au moins d’accord sur un point : nous vivons une époque de grande confusion intellectuelle et politique. Les notions de laïcité et de République, notamment, font l’objet de tirs croisés de milieux militants opposés mais d’accord pour en faire des marqueurs identitaires rigides. Les nationaux-républicains comme les postcoloniaux, pour user de termes qui ne satisfont personne mais permettent à tout le monde de savoir de qui on parle. Deux livres récents nous permettent de revisiter l’histoire et le contenu de ces deux notions.
« La laïcité » de Gwénaële Calvès Ed La Découverte.
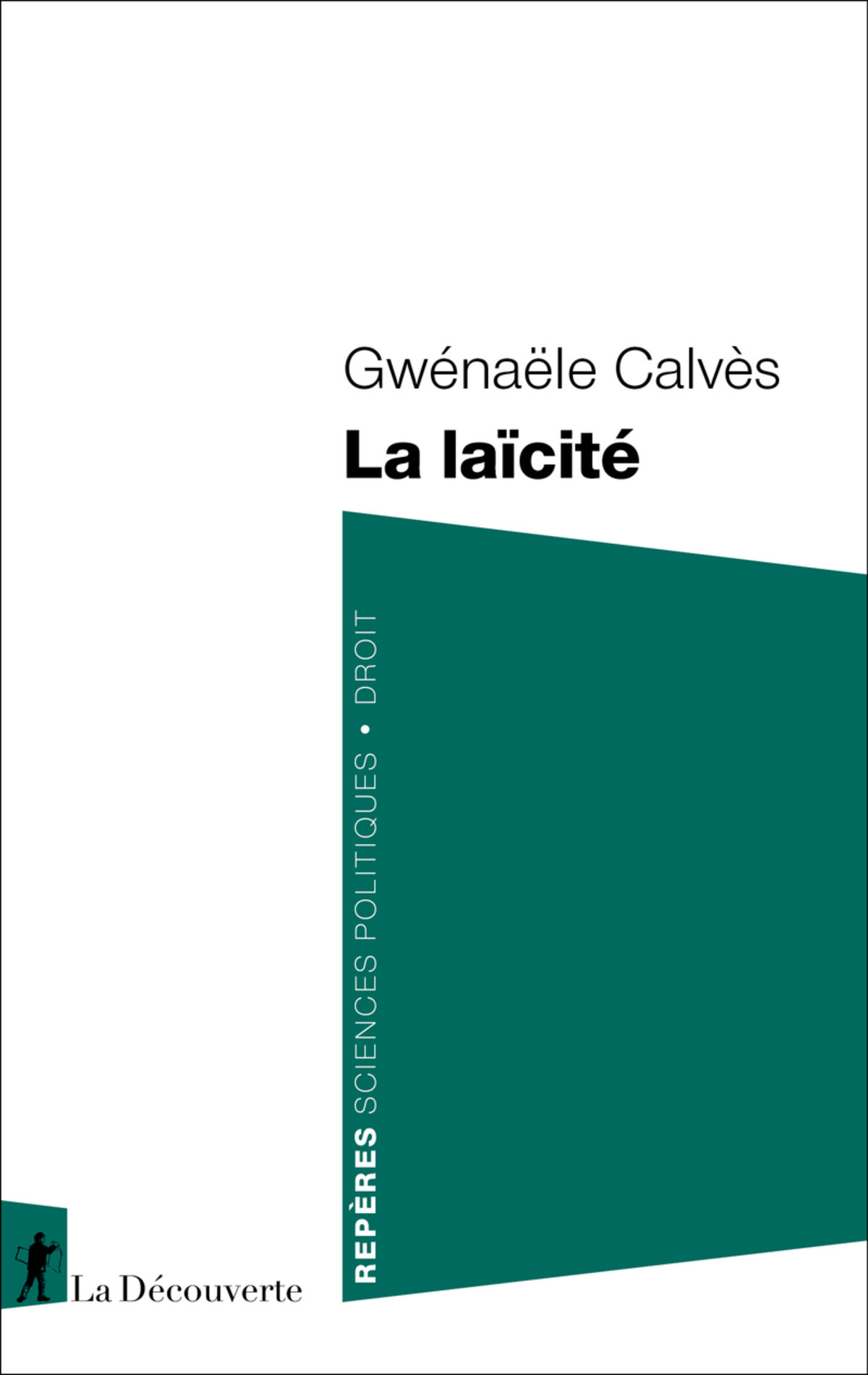
Agrandissement : Illustration 1
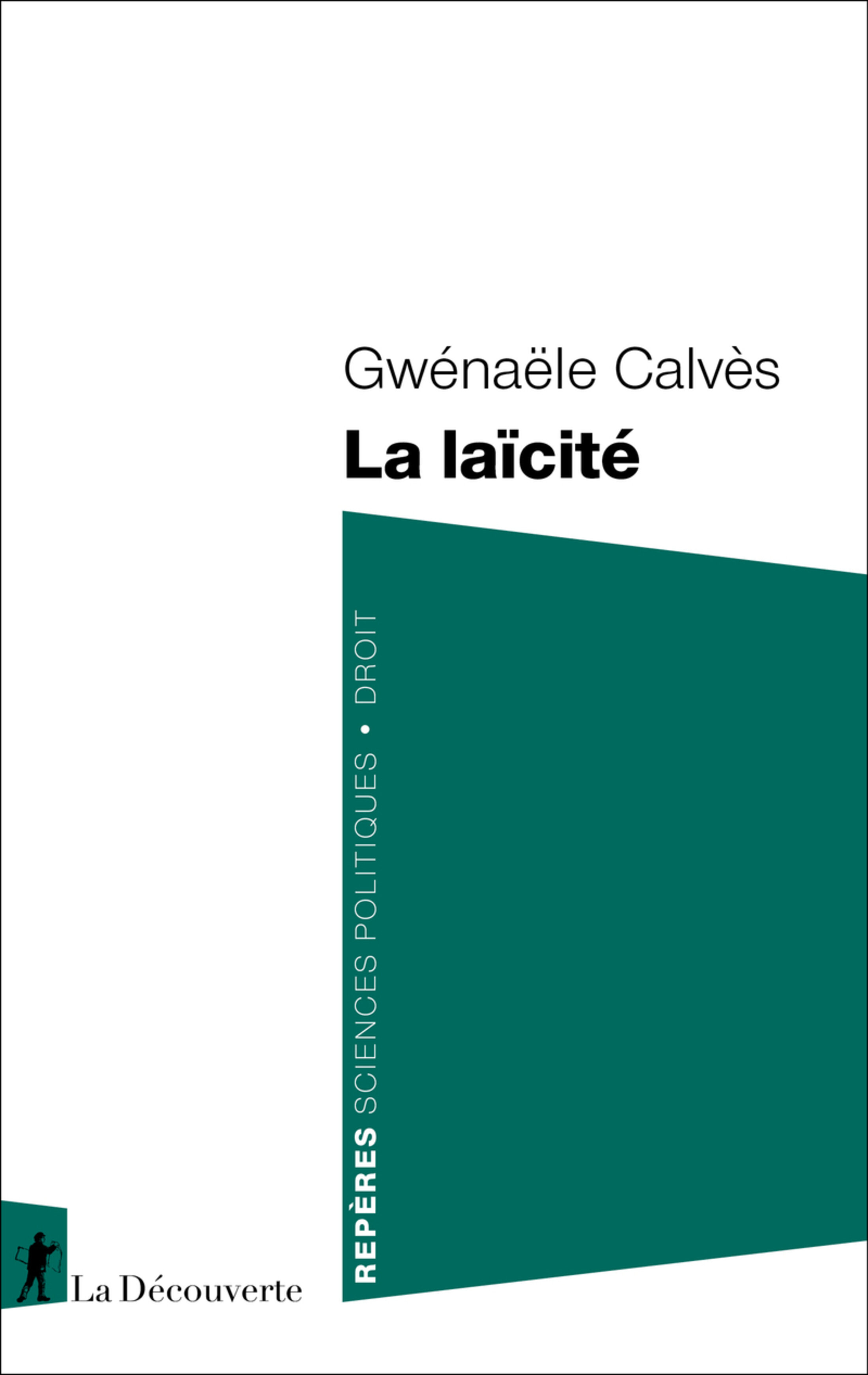
Bien que limité aux 128 pages de la collection « Repères » cet ouvrage se caractérise par son caractère complet. Ecrit par une juriste, il est précis, clair et même original. Gwénaële Calvès est professeure de droit public à l’université de Cergy-Pontoise. Spécialiste des questions liées aux politiques antidiscriminatoires, aux racismes et à la laïcité, elle est notamment l’auteure de « Territoires disputés de la laïcité » (PUF), ouvrage dans lequel elle répond à une quarantaine de questions concrètes. Dans « La laïcité » elle présente un panorama historico-juridique de tous les thèmes, du principe de liberté de conscience aux problèmes surgis dans la vie quotidienne, l’abattage rituel comme le fonctionnement des associations cultuelles, le prosélytisme, les jours fériés, les dérives sectaires…
La laïcité est un principe, une construction juridico-philosophique qui s’est concrétisée dans un corpus juridique. Le droit de la laïcité intègre des règles dont l’origine, la nature et la portée sont variables. Avec de grandes lois historiques, un énoncé constitutionnel elliptique, une jurisprudence abondante du Conseil constitutionnel et des règlements, des circulaires qualifiées de « droit mou » qu’il faut pourtant connaître. L’auteure va jusqu’à parler de « kaléidoscope de normes ». Cette histoire est marquée de grands moments de lutte, à la suite du vote de la loi Debré sur le financement public des établissements d’enseignement privés, et, depuis une trentaine d’années, avec des polémiques autour de la visibilité croissante d’une société devenue multiculturelle.
L’ouvrage de Gwénaële Calvès se caractérise également par une certaine originalité. Elle réaffirme la liberté de conscience comme clé de voûte de la laïcité. Et elle met en relief la cohérence d’ensemble d’un système juridique pourtant non dépourvu de tensions. Pour cela elle aborde les questions concrètes et les dispositifs légaux associés sous les angles de la liberté, de la séparation, de l’égalité et de la neutralité. Cette approche diversifiée permet de nuancer et de mieux comprendre les éventuelles différences de positions ou d’interprétation des textes.
Ce livre précis nous apporte une bonne connaissance de l’ensemble historico-juridique laïque. Militantes et militants de l’éducation populaire y trouveront un panorama utile et des références précises. Seule une conception claire peut générer une pédagogie pertinente. Ce travail permet de ne pas sombrer dans une tolérance naïve voire dans une mauvaise conscience culpabilisatrice. Ou de se lancer dans une « laïcisation » de l’ensemble de la société, trahissant ainsi la liberté de conscience des citoyens garantie par la laïcité des institutions républicaines.
« La République à l’épreuve des nationalismes » de Sébastien Urbanski Presses Universitaires de Rennes.

Cet ouvrage est ambitieux. Son sous-titre le démontre : « Ecole publique, valeurs communes et religions en Europe ». Son auteur, Sébastien Urbanski, est docteur en sociologie, maître de conférences en sciences de l’éducation à Nantes université. Il est impliqué dans l’éducation populaire et travaille avec la fédération de Loire-Atlantique de la Ligue de l’enseignement. Son livre est un ouvrage de philosophie politique qui mobilise les grands auteurs français et anglo-saxons pour traiter son sujet. Cette réflexion se développe sur 250 pages dont dix pages de bibliographie. Elle est précédée d’une copieuse préface de son directeur de thèse, Alban Bouvier. C’est dire si l’auteur s’adresse à un lectorat plutôt familier de la thématique. Une exigence certaine heureusement portée par un style clair.
Quel est le point de vue de Sébastien Urbanski ? C’est celui d’un « républicanisme critique opposé tout autant au républicanisme national qu’à un modèle communautarien propice aux exemptions religieuses ou culturelles qui affaiblissent l’idéal de citoyenneté commune ». L’auteur navigue avec érudition dans l’océan de la littérature politique traitant des différentes conceptions de l’universalisme, du rôle des religions, du « secularism » anglo-saxon et de la laïcité française, des communautés et des communautarismes, des nations et des nationalismes…
Sébastien Urbanski ne reste pas dans l’univers éthéré des idées. Il approfondit des sujets particuliers pour éclairer sa réflexion générale. Parmi ces sujets figurent une comparaison entre le port de hidjab à l’école et la présence de crucifix dans des salles de classe italiennes, l’exemple français de l’école privée sous contrat, les diverses formes de reconnaissance des religions, la discrimination positive en éducation… Une dizaine d’encadrés incisifs décrypte des cas précis : l’étude de l’hymne national israélien dans une classe française, l’organisation de barbecues halal pour des classes anglaises, l’interdiction des langues étrangères dans des classes multiculturelles… L’auteur consacre trois chapitres informés et étoffés à des situations spécifiques. Il s’agit du multiculturalisme scolaire en Angleterre, de l’expression publique des religions en particulier en Pologne et des réactions à la critique des religions : les « sensibilités musulmanes et catholiques blessées ».
Plusieurs analyses sont marquantes. Parmi elles, celle du libéralisme politique court tout au long de l’ouvrage. Sa relation avec la République, « pour construire un régime de non domination », est scrutée. Elle est assortie de réflexions sur les libertés protégeant des interférences arbitraires de l’Etat sans exclure les interventions pertinentes de celui-ci (éducation, politiques redistributives…). L’analyse du caractère exclusif ou inclusif des cultures nationales est bien développée. L’analyse des thèses du livre des essayistes américaines Judith Butler et Saba Mahmood « La critique est-elle laïque ? » fait apparaitre des incohérences conceptuelles et une ignorance de paramètres sociaux cruciaux. Une autre analyse porte l’intitulé explicite : « comment ne pas jeter les principes républicains avec l’eau du bain nationaliste ? ». Ce livre est une ressource intellectuelle de premier ordre pour celles et ceux qui veulent défendre et illustrer les fondamentaux laïques et républicains en assumant les réalités actuelles.
Une autre édition de la Ligue de l'enseignement sur Médiapart:
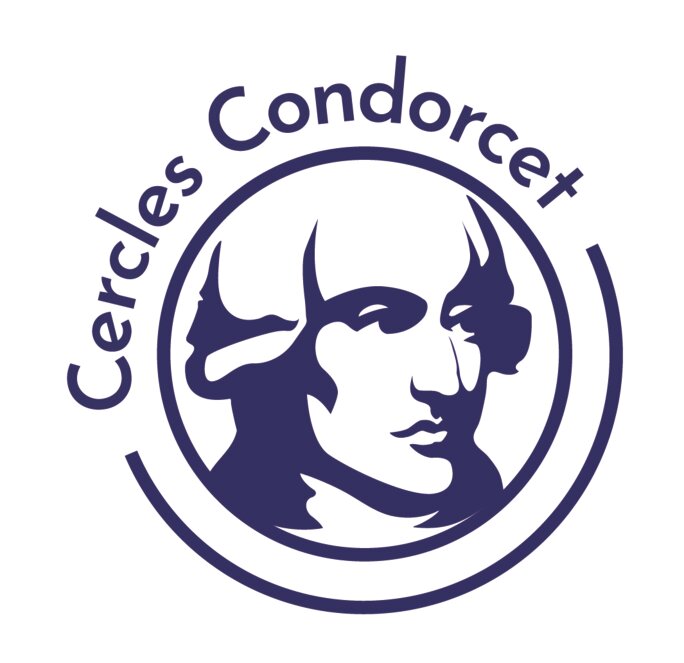
Agrandissement : Illustration 3
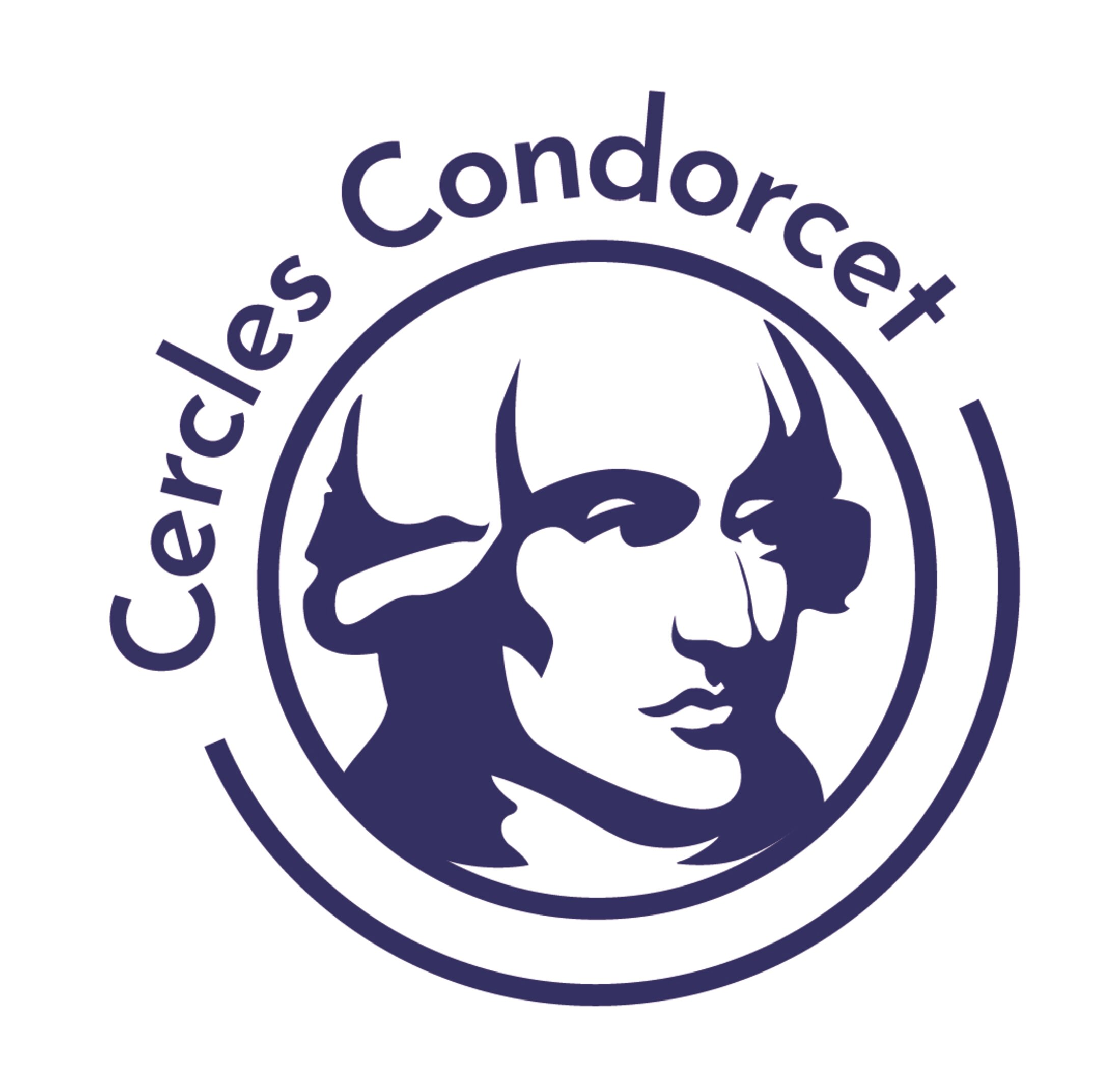
Les Cercles Condorcet accompagnent la vie intellectuelle et militante des fédérations départementales de la Ligue de l'enseignement, grand mouvement d'éducation populaire laïque. Une cinquante de Cercles rassemblent environ 2.000 personnes.
Ils animent une édition sur Médiapart Ne manquez pas de la consulter !



