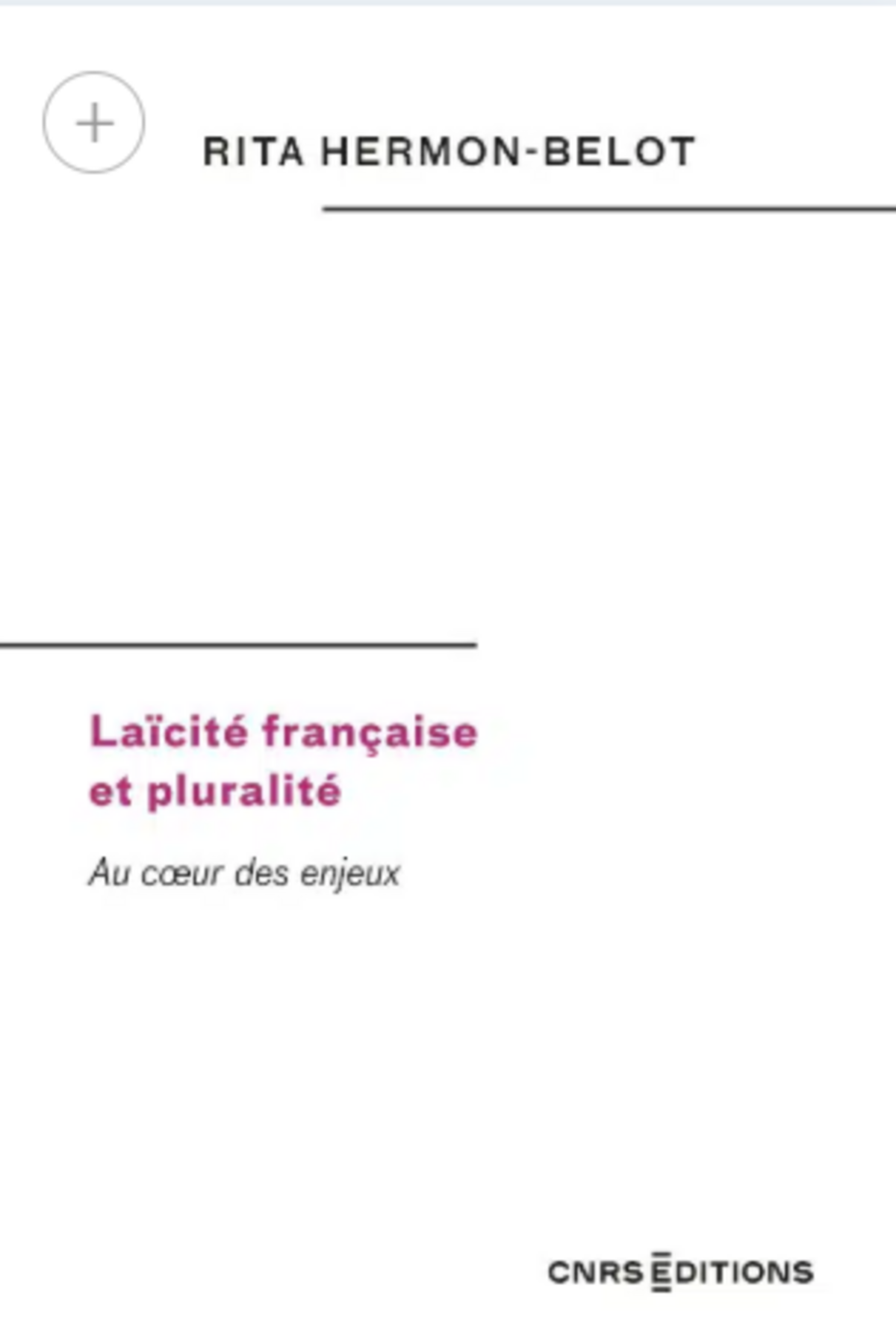
Directrice d'études émérite à l'EHESS, Rita Hermon-Belot a longtemps été titulaire de la chaire "Pluralité religieuse et laïcité dans l'histoire française, XVIIIe-XXe siècle". Nous lui devons notamment les ouvrages « L’abbé Grégoire. La politique et la vérité » (Seuil), « Aux sources de l’idée laïque » (Odile Jacob). Sa dernière œuvre « Laïcité française et pluralité. Au cœur des enjeux » publiée par CNRS Editions est une manière de synthèse de l’ensemble de ses travaux. Elle rappelle l’histoire et surtout expose les problèmes existants et les solutions éventuelles avec clarté et en donnant de nombreuses références : articles, livres, rapports...
« Laïcité française et pluralité. Au cœur des enjeux » est divisé en trois grandes parties. La première partie, de 90 pages, est historique. La pluralité des appartenances est soulignée, notamment avec les présences protestantes et juives sous l’Ancien régime. Suit une première affirmation laïque au coeur même de la tourmente révolutionnaire, puis un régime des quatre cultes reconnus allant du concordat et des articles organiques jusqu’à notre loi de séparation des Eglises et de l’État de 1905. L’islam reste relégué dans le cadre colonial, aussi bien dans cette période qu’après la loi de 1905. L’article 43 de celle-ci prévoyant des règlements d’administration publique pour l’application de la loi dans les colonies qui ne seront pas mis en œuvre. Nous allons ainsi jusqu’au vote de la loi sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, dite loi Debré.
La deuxième partie entreprend de lister les problèmes « posés à la pluralité religieuse et à la laïcité ». Sur 150 pages sont ainsi présentées les situations, parfois inégalitaires, des différents cultes existants. Le déclin des pratiques pratiques religieuses, la sécularisation de la société, n’est que peu évoquée. En revanche les réaffirmations identitaires générales et l’essor des religions autrefois minoritaires constituent la trame des problèmes évoqués : aux ou entre fidèles eux-mêmes (hostilité, violence..), dans les services publics (enseignement, santé, justice…) ou dans le privé (entreprises, sport…), la vie quotidienne (inscription dans l’espace, situation des femmes, application des normes religieuses…) jusqu’aux atteintes à l’intégrité et à la sécurité des personnes (dérives sectaires, terrorisme…).

Agrandissement : Illustration 2

La troisième partie dresse un inventaire des solutions mises en œuvre ou possibles en 250 pages, soit la moitié du livre. Les nouvelles lois sont détaillées. Sur les dérives sectaires en 2001, les signes religieux à l’école en 2004, la dissimulation du visage dans l’espace public en 2010 (sans référence à laïcité), les principes de la République en 2021. Au delà des lois, l’autrice explore les voies de l’action publique, des institutions elles-mêmes comme de l’impulsion à constituer une instance représentative de l’islam. L’assurance de l’ordre public et de la sûreté des personnes, la lutte contre les discriminations et contre tous les racismes, dont l’antisémitisme, exacerbés par le conflit au Proche-Orient complètent les efforts de garantie de libre exercice des cultes (avec de nombreuses dérogations au principe de laïcité).
Les deux chapitres finaux sont plein d’intérêt. Dans le premier, Rita Hermon-Belot va jusqu’à évoquer un changement de paradigme initié lors du discours du président de la République aux Mureaux le 2 octobre 2020. Elle relève une thématique de reconquête républicaine déjà esquissée quelques mois plus tôt à Mulhouse. Les débats qui conduiront à l’adoption de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite « loi séparatisme », sont exposés avec minutie. Dans le deuxième chapitre l’autrice analyse l’application de la loi, ses suites et les commentaires allant jusqu’à l’automne 2023. Une conclusion d’une dizaine de pages s’interroge sur la forme d’action la plus pertinente : « plutôt la plus grande souplesse, ou une fermeté nécessaire, ou encore un alliage très réfléchi des deux ? ». L’autrice inscrit cette interrogation dans le cadre d’une réflexion culturelle et philosophique : la « conception de notre identité. La laïcité n’est-elle pas inséparable d’une vision de cette identité comme une identité complexe se déployant dans des registres multiples ? ».



