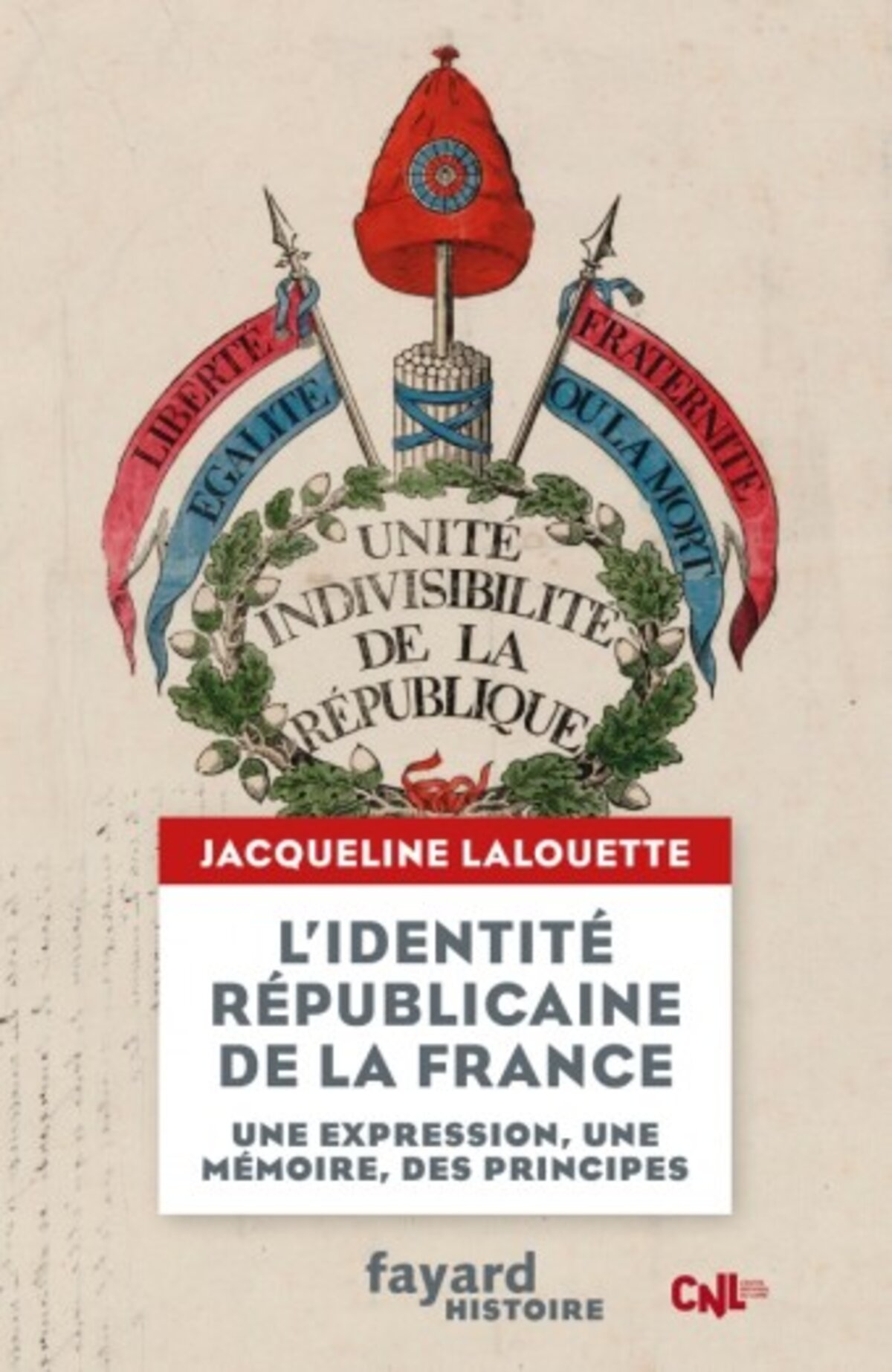
En une vingtaine d’ouvrages, l’historienne Jacqueline Lalouette propose une vaste fresque érudite et passionnante de ce qui constitue les Français en une République laïque. Leurs thèmes sont la libre pensée, l’anticléricalisme, la séparation des Eglises et de l’Etat, les lieux de culte, les jours de fête, Jean Jaurès… et son maître Maurice Agulhon. Elle travaille sur les statues avec un beau livre « Un peuple de statues. La célébration sculptée des grands hommes (1801-2018) » publié chez Mare et Martin, et une analyse des polémiques récentes « Les statues de la discorde » publié par Passés/Composés.
Le titre de son dernier livre « L’identité républicaine de la France. Une expression. Une mémoire. Des principes » (Fayard Histoire) situe bien son ambition. Jacqueline Lalouette a entrepris de scruter notre identité politique et culturelle. Elle analyse d’abord les termes, les expressions, utilisées autrefois pour parler des identités collectives : l’âme, le génie, l’esprit des peuples. Michelet évoque ainsi le pays dans son Histoire de la France : « Le premier je la vis comme une âme et une personne ». Voltaire use du second terme dans son Dictionnaire philosophique : « On appelle génie d’une nation le caractère, les mœurs, les talents principaux, les vices mêmes qui distinguent un peuple d’un autre ». Et Léon Bourgeois, dans un discours prononcé en 1900, souligne : « Voilà ce qu’est l’esprit national ; voilà celui que nous revendiquons pour le nôtre ». Cet esprit national étant celui du patriotisme républicain, qui veut rassembler dans l’égalité, à l’opposé de la dérive nationaliste, qui divise par xénophobie.
L’identité est aussi une mémoire, ou plutôt une double mémoire : celle des Lumières et celle de la Révolution française. Jacqueline Lalouette leur consacre deux chapitres. Les Lumières, inspirées par l’antiquité greco-latine, se sont diffusées dans toute l’Europe bien sûr et pas seulement en France. Elles sont plus diverses que ce qu’on pense parfois. Leur incrustation dans l’identité républicaine et française a été particulièrement bien illustrée dans l’ouvrage de Louis Réau « L’Europe française au siècle des Lumières ». Il n’est que de citer les noms de Rousseau (quoique suisse), Voltaire, Condorcet, Diderot, d’Alembert… L’édition de leurs œuvres, la panthéonisation de certains, leur évocation récurrente, les noms de rues et d’établissements scolaires, les statues… les inscrivent dans notre mémoire collective.
La Révolution française fonde la République qui finira par s’instaurer durablement. Le peuple français affirme sa souveraineté et se constitue en nation par la République. Dans le temps même où elle se déroule la Révolution construit sa mémoire, notamment par les arts et les cérémonies. Fête de la Fédération, célébrations des victoires, architecture, peinture, sculpture, estampes, théâtre, programmes scolaires… Tout cela nous imprègne au point qu’on a pu voir dans le mouvement des Gilets Jaunes une résurgence du sans-culottisme. Le bicentenaire de la Révolution française en 1989, dans lequel la Ligue de l’enseignement a joué un rôle important, a été révélateur jusque dans la polémique qui a accompagné le défilé carnavalesque conçu par Jean-Paul Goude.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.

« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». La première phrase de l’article premier de notre Constitution est nette. Pour mieux cerner l’identité républicaine de la France, Jacqueline Lalouette scrute deux des principes ainsi affirmés : l’indivisibilité et la laïcité. Des principes d’unité et d’indivisibilité liés en 1792 ne subsiste que l’indivisibilité. L’épithète « Une » ne perdure que dans les discours. Le peuple français reste politiquement uni tout en étant culturellement divers. La loi de 1982 relative aux droits et libertés ds communes, des départements et des régions tout comme les dispositions de la Constitution qui posent de fait une politique du français langue de la République et des langues régionales doivent être lues en ce sens. Les débats démocratiques qui portent sur leur compréhension et leur application sont légitimes et nécessaires. De même que ceux qui portent sur la notion émergente de séparatisme, applicable à bien des groupes sociaux.
Le chapitre sur la laïcité « cœur battant de la République » va de la question de l’étymologie à celle de l’alimentation en passant par le rappel de la série des lois de laïcisation du XIX° siècle, les dérogations en Alsace, en Moselle et dans les Outre-Mer, le financement public des établissements d’enseignement privés, les signes religieux… Tous thèmes longuement traités dans la présente édition… Jacqueline Lalouette clôt son ouvrage avec une évocation de son grand collègue Alphonse Aulard et en reprenant un appel à faire un effort pour que la République soit toujours plus forte, toujours plus belle. On ne saurait mieux dire…



