"La Laïcité" de Jacques Limouzin, Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional honoraire, vient de paraître aux Editions Cairn, collection "Les mots essentiels pour comprendre". Une recension de Michel Miaille, professeur honoraire à la Faculté de droit de l'université de Montpellier, auteur de "La Laïcité" Editions Dalloz, président de la Ligue de l'enseignement de l'Hérault.

Agrandissement : Illustration 1
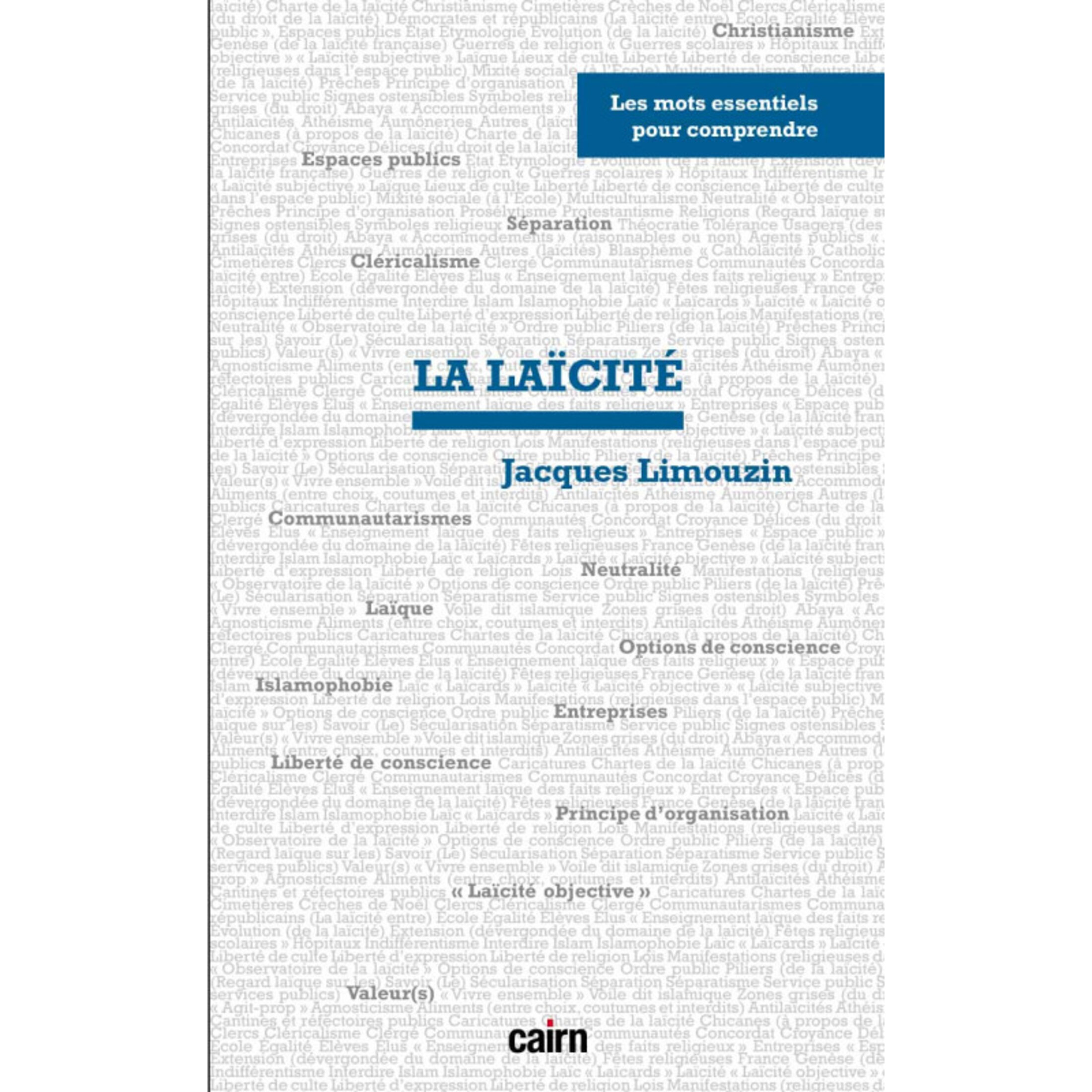
A travers ces notices abordant la laïcité, source de débats publics et d’affrontements médiatiques, Jacques Limouzin clarifie et
questionne l’usage de nombreux lieux communs à propos de celle-ci, à l’aide de source historique et de réflexion juridique
et politique.
Effectivement, on ne compte plus les livres parus sous ce thème :pour ne prendre que les plus récents , nous avons un livre d'histoire sur la loi " De la laïcité en France" par P Weil ( Gallimard 2022), un livre d'une juriste Gwénaële Calves , " La laïcité" ( Edit la Découverte , 2023), la réédition enrichie de " En finir avec Idées fausses sur la laïcité" de Nicolas Cadène ( Edit l'Atelier 2023), ou même " La laïcité , un principe: de l'antiquité au temps présent" de Eric Anceau ( 2022 edit Passé Composé) et même d'un prêtre très traditionnaliste de l'université catholique de Lyon...." La laïcité en France au regard de l'histoire " de Daniel Moulinet (Edit Parole et silence , 2023). Alors, ce qui compte ,c'est la différence.
Cette différence apparait d'abord dans le texte lui même : non pas un discours construit pour développer un positionnement personnel, mais un "dictionnaire" où de lettre en lettre, les thèmes liés a ce principe de la République , apparaissent : on commence par "Abaya" pour terminer avec tous les mots qui, de près ou de loin, entrent en résonance avec le thème de la laïcité. Cette présentation, éclatée, a l'avantage que le lecteur choisit son mode de lecture en fonction de ses interrogations. C'est un livre qu'on prend, qu'on pose et qu'on reprend en fonction du besoin, d'une discussion ou d'un éclaircissement sur tel ou tel vocable.
Pourtant l'unité du propos permet de relier entre eux tous ces mots de la laïcité . Peut- être l'essentiel est dans une des phrases : il y a plusieurs laïcités que l'auteur range dans deux catégories .La première est celle de "la laïcité subjective ", on dirait mieux dans les laïcités subjectives, celles dont nous sommes tous les auteurs en fonction de notre histoire, de nos préférences, de nos traditions, etc. Elles s'expriment dans tous les débats et souvent aboutissent à une certaine cacophonie ou, au contraire, à la suprématie d'une philosophie qui s'impose dans le débat. Mais, au fond, elles sont toutes particulières et donc apparemment, toutes égales. En revanche, il y a ce que l'auteur appelle "la laïcité objective", celle définie par la loi , essentiellement , la loi du 9 décembre 1905 telle qu'interprétée par le Conseil d'Etat : celle ci s'impose parce que nous sommes dans un Etat de droit et qu'après toutes les interprétations possibles, il y a une interprétation qui s'impose, celle que la loi et la justice administrative donneront parce qu'elles ont autorité pour trancher. Position moins légaliste que pratique, parce qu'il faut bien, dans notre société, mettre un terme au débat et donner une solution, et celle ci découlera de l'interprétation du texte de loi. Ce qui laisse ouverte toute possibilité de faire évoluer les solutions.
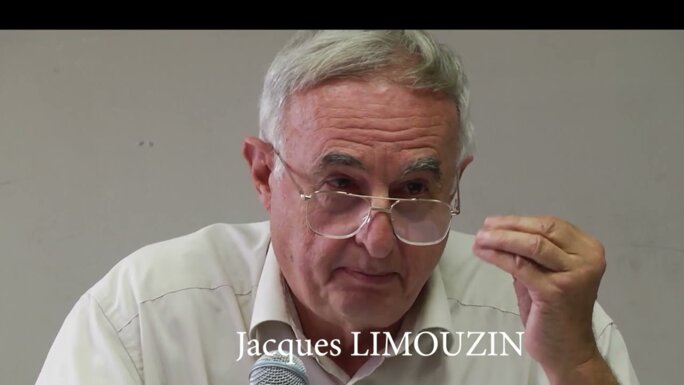
Agrandissement : Illustration 2

L'auteur nous invite donc à connaitre les termes de la discussion et à partager la solution trouvée, en cas de conflit, par les interprètes autorisés de la loi en France. Il y a aussi des cas où la solution n'est pas encore définitive et le lecteur doit prolonger lui-même la lecture sur la base de ses convictions. cela ouvre un champ de discussions qui manque souvent dans des ouvrages un peu péremptoires sur ce sujet ! On serait infidèle à la lecture de cet ouvrage si l'on ne rappelait que l'auteur est un historien, et que les développements historiques sont non seulement présents, mais quelquefois très développés. A preuve ceux qui concernent les religions, notamment le christianisme ou l'Islam mais aussi les religions de l'Antiquité, notamment à Rome. Le coté érudit de l'auteur s'y déploie pour notre bonheur en rectifiant des "à peu près" ou des erreurs que nous commettons par manque de culture historique.
Le style enfin du propos n'est pas la moindre qualité de cet ouvrage, émaillé d'un humour qui vise souvent des zones d'ombre ou des a priori qui encombrent les discussions sur les religions et sur la laïcité. In fine , que retenir de cet ouvrage qui se place dans le débat français comme un guide pratique de discussion et comme une invitation à poursuivre et à approfondir nos connaissances et notre capacité à nous situer dans un débat qui, souvent, ne brille pas par la clarté ?
On pourrait, peut-être, au delà des lectures hasardeuses que nous venons de pointer, essayer de proposer des lectures plus thématiques pour approfondir un angle d'attaque "en fonction des intérêts propres du lecteur.

Agrandissement : Illustration 3

Par exemple, on pourrait imaginer un lecteur qui veut approfondir le thème, comme savoir spécifique. On lui suggèrera de commencer par la lettre S « Savoir » et continuer par « Regard laïque sur les religions », poursuivre ensuite sur les « Laïcités (subjectives et objectives) », continuer par L « Liberté », ensuite M « Manifestations religieuses » et terminer par P « Piliers de la laïcité ». C'est ici une lecture relativement technique, qui embrasse la question dans ses dimensions sociologiques et juridiques.
Mais on pourrait aussi proposer à un philosophe de prendre A comme « Agnostique », puis A comme « Athéisme », C comme « Christianisme » et puis comme « Croyance », E comme « Etymologie », I comme « Islam » et finir sur T comme « Théocratie ». Mais un lecteur intéressé par les aspects pratiques, ceux évoqués dans les conversations lira avec profit : dans A comme « Aliments », C comme « Cantines », F comme « Fêtes religieuses » ou S comme « Signes ostensibles » et V comme « Voile », de quoi alimenter une discussion ordinaire, celle qui intéresse bien de nos contemporains. Evidemment, le juriste et surtout le non juriste savoureront C comme « Chartes », D comme « Délices du droit) et Z comme « Zones grises du droit ». L'humour de l'auteur s'y déploie, qui rappelle aux juristes que l'historien n'est pas dupe de leur construction !

Agrandissement : Illustration 4

Bref, il y a donc des lectures multiples. On aimerait discuter le mot « Prosélytisme » car il pose des questions délicates : en effet le prosélytisme n'est pas "en soi" condamnable : car comment convaincre son prochain si l'on ne peut argumenter sur la base d 'une Vérité supposée ? Car ce que la règle de droit condamne, c'est le prosélytisme abusif, les techniques de pression, quand ce ne sont pas les pratiques connues sous le terme générique de "pratiques sectaires". Trop souvent aujourd'hui nos contemporains pensent que tenir un petit étal de journaux ou de textes religieux comme la Bible dans la rue, fait partie du "prosélytisme" interdit. Et qu'il est interdit de faire de la "propagande" pour une religion, sans se rendre compte qu'ils bafouent alors la liberté de pratiquer ses croyances, pour autant que l'ordre public n'est pas menacé. Le lecteur s'intéressera aussi au mot " Etymologie" qui rappelle que le mot apparemment si simple de "religion" n'a pas le même sens pour un Romain du premier siècle et pour nous aujourd'hui.
Mais on pourrait certainement prolonger la réflexion car "religion" n'a aujourd'hui pas le même sens pour un hindou, un catholique, un témoin de Jéhovah et un communiste ! On pourrait aussi avoir envie de reprendre avec l'auteur le passage sur la République, confondue par nombre de nos contemporains avec la France : or, un système politique représente une société, il n'est pas cette société....même si l'article premier de la Constitution énonce que " la France est une République...." avec toutes ses qualités propres. Le verbe "être " est ici ambigu ! Il faut comprendre que la France, comme société concrète et historique se donne comme représentation politique et juridique, le statut de République. Evidemment c'est un peu plus compliqué mais c'est plus exact !
L'ouvrage de Jacques Limouzin nous ramène aux vielles querelles des Universaux qui ont fait les délices des érudits du Moyen Age mais que les spécialistes d'épistémologie ne renient pas. C'est dire qu'avec des mots simples, l’auteur, nous oblige à nous élever vers des horizons pas si souvent fréquentés ! On peut souhaiter une belle diffusion a cet ouvrage pour contribuer au débat tellement nécessaire aujourd'hui.
Michel MIAILLE
Vous retrouverez les vidéos des contributions de Jacques Limouzin et Michel Miaille dans le cadre du séminaire sur la laïcité du Comité régional de la Ligue de l'enseignement d'Occitanie en accès libre dans la présente édition "Laïcité".



