
Agrandissement : Illustration 1

Martine Cohen est sociologue émérite au GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités) du CNRS. Elle a travaillé sur le renouveau charismatique catholique en France et sur la question des "sectes". Depuis une trentaine d’année elle s’investit sur la sociologie des Juifs et du judaïsme, avec notamment une étude approfondie du réseau des établissements d’enseignement privés juifs. Elle a également coordonné, dans une forme de perspective comparatiste, l’ouvrage collectif « Associations laïques et confessionnelles. Identités et valeurs » (L’Harmattan, 2006).
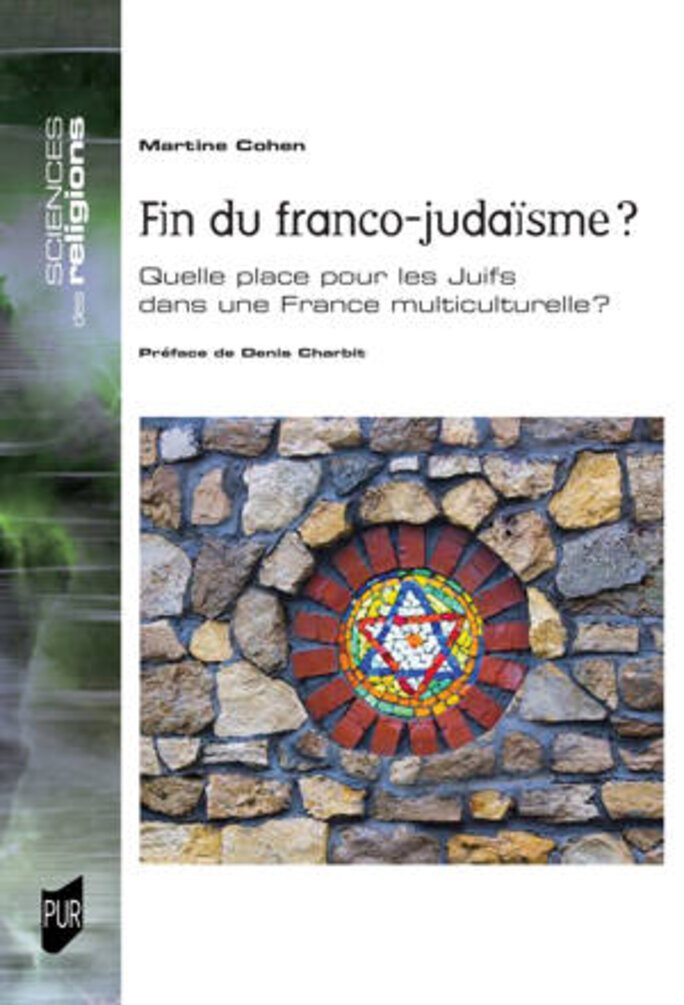
Le dernier livre de Martine Cohen « Fin du franco-judaïsme ? Quelle place pour les Juifs dans une France multiculturelle ? » (Presses Universitaires de Rennes) est une synthèse sociologique de l’histoire des Juifs de France. Elle se distingue par son ampleur historique et par la richesse et la précision de ses nombreuses références qui rendent difficile une recension complète. On relève toutefois que l’ouvrage est structuré en trois grandes parties aux intitulés explicites : « Le franco-judaïsme israélite et ses déclinaisons (1808-1944), « Rupture avec l’israélitisme : vers un nouveau franco-judaïsme (1945-2000) » et « Des années 200 à nos jours : fin ou recomposition du franco-judaïsme ? ».

Martine Cohen décrit par le terme « israélitisme » la redéfinition identitaire à l’œuvre depuis la création du Consistoire par Napoléon Bonaparte. Auparavant réputés étrangers, les membres des trois « nations juives » (Bordelais, Comtadins, Alsaciens…) sous l’Ancien Régime sont désormais des citoyens à part entière, pratiquant le judaïsme. Le slogan adopté par le Consistoire, qui gère le culte, au lendemain de sa création est « Patrie et religion ». Le Consistoire a le monopole de la représentation des citoyens pratiquant ce culte jusqu’en 1944. La création d’autres structures, telles que l’Alliance Israélite Universelle ou les Eclaireurs israélites de France (sur la même option républicaine), ne le remet pas en cause.

Agrandissement : Illustration 4

En revanche, la création de la LICA (Ligue contre l’antisémitisme, qui deviendra LICRA) en 1929 puis du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France) en 1944 entraîne une modification progressive de la définition de l’identité juive par celles et ceux qui s’en revendiquent. C’est un processus complexe qu’on peut caractériser comme la prise de conscience, ou l’invention, selon les points de vue, d’un « peuple juif » non réduit à sa dimension religieuse. La mémoire du génocide nazi, appelé « Shoah » depuis le film de Claude Lanzmann sorti en 1985 et la solidarité avec l’Etat d’Israël s’ajoutent à la référence religieuse. Même si le président du Consistoire reste président de droit du CRIF jusqu’en 1983, c’est cette deuxième institution qui monte en puissance et devient la vitrine publique et l’interlocutrice des pouvoirs publics. A cela s’ajoute le développement d’envergure du FSJU (Fonds Social Juif Unifié) qui gère les dimensions culturelle et sociale de la « communauté » suivant le terme de plus en plus fréquemment employé. En 1967, la guerre des six-jours entraîne une montée du soutien à l’Etat d’Israël qui conforte la redéfinition identitaire.
Les années 80 sont marquées par plusieurs mouvements culturels et politiques. Une diversification interne est indéniable. Les ultra-orthodoxes s’organisent à partir de « yeshivot (école)-village » en retrait de la société comme à Aix-les-Bains. Ils exercent une pression croissante sur le Consistoire, notamment sur les exigences en matière de cacherout, les mariages mixtes, l’égalité entre les femmes et les hommes… Le judaïsme libéral, qui accepte les femmes rabbins, se développe aussi. Les écoles juives se multiplient de façon spectaculaire. Il n’existait avant-guerre que quelques petites structures. Le FSJU gère aujourd’hui plus d’une centaine d’établissements accueillant le tiers de la population juive en âge scolaire.
De plus l’image de l’Etat d’Israël (la répression en Palestine) se dégrade dans l’opinion publique française. La droitisation croissante du CRIF est relevée. Cette réaffirmation identitaire, parallèle à celles d’autres groupes sociaux, a été analysée par les journalistes Sylvain Cypel et Charles Enderlin. Les discours politiques oscillent de la reconnaissance de la « double fidélité » à la critique de la « double appartenance ». Des rencontres interreligieuses avec des notables musulmans ne suffisent pas à enrayer la montée d’une « nouvelle judéophobie ». Martine Cohen constate l’essor d’un « franco-judaïsme victimaire », dont Alain Finkielkraut pourrait être la meilleure incarnation : le lien avec la République étant réduit à un rôle de protection. Elle s’interroge sur la possibilité de réinventer un nouveau franco-judaïsme fondé sur la reconnaissance d’une participation spécifique dans le cadre d’une société devenue multiculturelle. Les réaffirmations identitaires touchent les milieux les plus divers. Comment y répondre ? Nous entrons dans le vaste et difficile débat sur la légitimité des droits culturels et le refus républicain d’octroyer des statuts spécifiques (ce que Martine Cohen ne propose pas)… Cet ouvrage de qualité y a toute sa place.
Martine Cohen présente son travail dans un entretien intitulé "Le consistoire s'st endurci...", vidéo en ligne sur Akadem



