
Agrandissement : Illustration 1
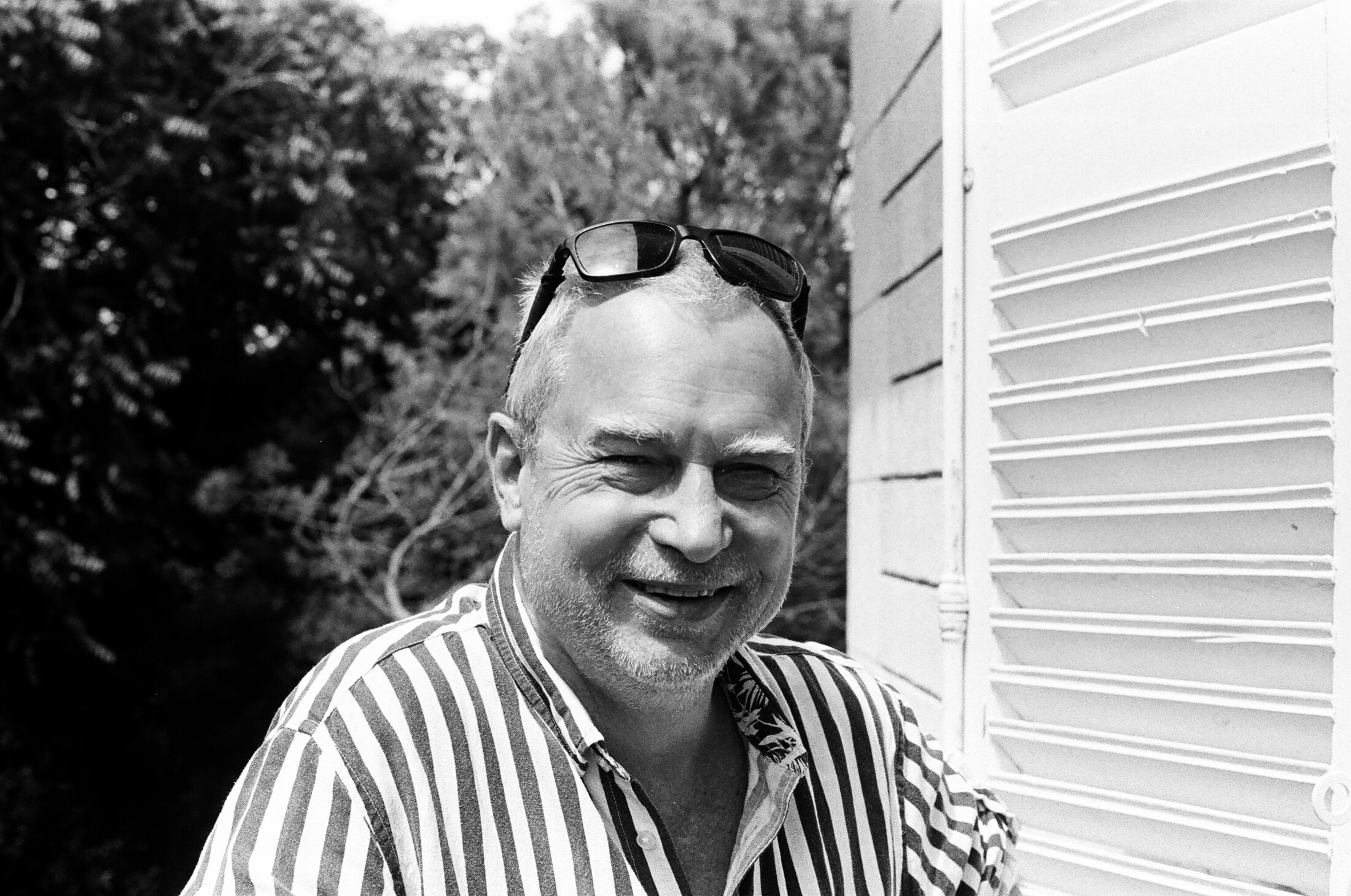
F. R. : Depuis plusieurs années, le Sas-culture suit votre travail et notamment la préparation de votre nouveau roman paru dans l’été « Le pont aux écrevisses » qui raconte, sous la forme d’une fiction, l’histoire possible de votre père durant l’occupation. Quel regard portez-vous désormais sur votre propre histoire, comment s’est-elle modifiée avec cette expérience d’écriture au long cours ?
Ivan Maurer : Je lisais récemment dans un roman : « Il n’y a pas de plus belle aventure que la famille ! » Je crois que cette formule résume mieux que tout mon travail d’écriture. Chaque famille est un univers, un microcosme, l’humanité entière s’y condense. Chaque cellule familiale (j’aime ce terme de « cellule » qui ramène à l’organique) recèle dans son patrimoine l’histoire du monde. Les dernières avancées de la science et particulièrement celles effectuées dans le domaine de l’épigénétique ont mis en évidence la transmission des évènements traumatiques d’une génération à l’autre. Depuis mon plus jeune âge, je savais dans quelles circonstances tragiques ma grand-mère paternelle avait mis fin à ses jours, laissant derrière elle deux garçons en bas âges, mon père et mon oncle. Des années plus tard, ma cousine s’est également suicidée, laissant à nouveau derrière elle, deux jeunes garçons orphelins. Un homme relie ces deux suicides : mon grand-père Serge, mari de l’une et père de l’autre. Il est la pierre angulaire de cette histoire, même s’il n’est coupable de rien.
Cette tragédie familiale m’a hanté toute ma vie. Et pour ce qui concerne ma grand-mère, sujet de mes deux romans « Le Quai de l’île sonnante » et « Le pont aux écrevisses », l’absence de trace, de tombeau, d’image, était pour moi comme un vide abyssal, un trou noir, un précipice. L’écriture était devenue une nécessité pour combler ce manque et donner corps et âme à cette aïeule disparue. Mon père m’a dit après la lecture du livre : « Tu m’as raconté ma vie ! » Je ne pouvais pas rêver plus beau compliment. J’ai inventé une histoire familiale, car c’était une nécessité. Ce n’est pas la vérité, ce n’est pas la réalité, c’est une histoire qui comble un vide. Peu importe qu’elle soit fausse ou vraie, elle donne un sens, et une mémoire aux générations futures.
F. R. : Entrons dans le détail de votre intention romanesque : vous mettez en avant la figure de l’enfant, son appréhension naïve et touchante du monde, qui contraste avec des adultes précipités dans l’action. Entre les deux, la narration apporte une certaine distance qui recompose l’histoire. Pouvez-vous nous parler des livres ou des auteurs qui vous ont inspiré pour construire cette approche ?
Ivan Maurer : Comme pour beaucoup, mes premières lectures ont été des contes qui mettent souvent en scène des enfants. Il y a eu ensuite les bibliothèques roses et vertes que ceux de ma génération connaissent bien. D’autres lectures adolescentes m’ont conduit vers ce monde de l’enfance et de l’adolescence : la série des « Claudine » de Collette, « le Petit Chose » de Daudet, « Deux ans de vacances » de Jules Verne, « Sa Majesté des Mouches » de William Golding que je considère comme un chef-d’œuvre, et tant d’autres, pour arriver évidemment à Pagnol et ses souvenirs d’enfance, qui m’ont, je crois, le plus influencés.
Raconter les choses à hauteur d’enfants permet de s’émerveiller du monde sans tomber dans la bluette, de s’émouvoir sans faire dans la sensiblerie. L’écueil reste cependant de ne pas appauvrir le style avec un discours puéril. C’est là que la narration intervient et corrige par un regard parfois omniscient. Pagnol est un maître en la matière et je relis régulièrement « La gloire de mon père » et « Le château de ma mère ». Bien qu’académicien, Pagnol n’a, à mon avis, pas la place qu’il mérite dans la littérature française.
F. R. : Parallèlement à l’écriture, vous pratiquez le dessin, ce qui a donné envie au Sas-culture de vous proposer d’illustrer les nouvelles parutions de cette rentrée 2024, dans la tradition des belles éditions. Si chaque lecteur se fait sa représentation d’un texte, il est une autre étape de la représenter vraiment en une image. Comment s’opère chez vous cette transformation de l’impression d’une histoire en une scène fixée sur une seule page ?
Ivan Maurer : Je me souviens encore de ma première peinture à la maternelle, c’était un pommier sur fond de ciel bleu. J’ai toujours dessiné. Handicapé de naissance par une sévère atrophie de la jambe droite qui nécessita de nombreuses interventions et des mois d’immobilité, le dessin est devenu rapidement une activité importante dans ma vie. Cette capacité, là encore, à inventer un monde, sur papier, m’aidait à m’échapper des longues heures d’ennui dans les hôpitaux. De simples passe-temps, le dessin et la peinture sont rapidement devenus des passions, pour devenir « une injonction de l’âme », comme je l’ai écrit il y a peu dans le roman auquel je m’attelle en ce moment.
Dès l’âge de quinze ans, je suivais assidûment les cours de Beaux-Arts à Châteauroux et pratiquais, avant mes études supérieures, jusqu’à quinze heures par semaine de dessin et de peinture académique. Mon bac en section Arts plastiques et les années suivantes aux Beaux-arts d’Orléans m’ouvrirent à l’Art contemporain. Mon roman « Le buste de Voltaire » est directement inspiré de cette expérience. Mais même si le dessin me passionne, j’ai rapidement pris conscience des limites de mon petit talent et j’en ai ressenti une grande frustration : l’incapacité à faire passer des émotions, ou en tout cas, pas à la hauteur de mes exigences.
Le travail d’illustration est différent, le support du texte est un guide. À la lecture l’image s’imprègne dans mon esprit, elle est nette et précise, il n’y a, en quelque sorte, plus qu’à recopier.
F. R. : Un de vos prochains projets poursuit l’exploration de votre histoire familiale, toujours dans le passé, mais cette fois en vous incluant comme personnage. Vous développez la relation à votre tante, qui renvoie à deux autres de vos livres, « Un pied devant l’autre » touchant au handicap et « Le Buste de Voltaire » dans un atelier d’artiste. Quelles dimensions complémentaires, nouvelles ouvertures, souhaitez-vous apporter ?
Ivan Maurer : Pour ce prochain livre, en effet, je continue à fouiller la mémoire familiale. Je m’attache, dans le cadre de la série « Femme de Caractères » proposée par Le Sas Culture, à la personnalité engagée de ma grand-tante, Paule Maurer, militante communiste de la première heure. Cette femme d’une intelligence remarquable et d’une immense culture, à qui je dois mon amour des livres et de la peinture, pouvait tomber dans le manichéisme quand il s’agissait de politique. C’est ce paradoxe qui m’intéresse, l’absence parfois de recul et de pondération, quand il s’agit de religion ou de politique. Essayer de comprendre cette femme m’oblige à revenir en arrière sur les fondements du communisme.
Mon parcours de vie, de 1962 à aujourd’hui, a accompagné les évolutions de notre société et les méandres de la politique française que j’ai toujours suivis avec passion. Du jeune garçon influencé par sa tante qui vota « communiste » en 1981 au chef d’entreprise que je suis devenu, il s’est écoulé beaucoup d’années. Je les regarde avec bienveillance, mais les questionne aussi. La France est un peu une famille, on s’y chamaille beaucoup, surtout pour la politique ! En abordant ce thème de l’idéal et de l’engagement, j’ajoute au questionnement familial qui est mon terreau habituel d’écriture, une dimension plus universelle.



