
Agrandissement : Illustration 1

« Je suis historienne, et féministe. La nuance est très importante : je ne suis pas une historienne féministe, je ne sers pas de cause, même si le féminisme a joué un très grand rôle dans ma vie… En tant qu’historienne, je ne porte pas la parole : j’essaie de la faire entendre, de la révéler, mais mon rôle s’arrête là ». Dès les premières pages de son ouvrage, Michelle Perrot trace avec netteté la distinction entre le métier d’historienne et son engagement militant. Elle se démarque ainsi d’une mouvance qui justifie le mélange des deux, au détriment de l’histoire, qui devient moins crédible, comme du militantisme, qui semble vouloir manipuler les faits.
L’œuvre de Michèle Perrot est immense. Dès 1966, elle travaille sur la condition ouvrière. En 2012 elle publie « Mélancolie ouvrière » sur l’itinéraire de Lucie Baud (1870-1913), ouvrière en soie du Dauphiné, femme rebelle méconnue en dépit de son investissement dans des grèves mémorables. Gérard Mordillat en tire un film poignant en 2018. Michèle Perrot est la grande historienne des femmes, qu’elle ouvre avec des études sur George Sand, et qu’elle déploie dans des œuvres telles que celles réunies dans « Le chemin des femmes » ou écrites en collaboration comme « Femmes et histoire » et « La plus belle histoire des femmes ».
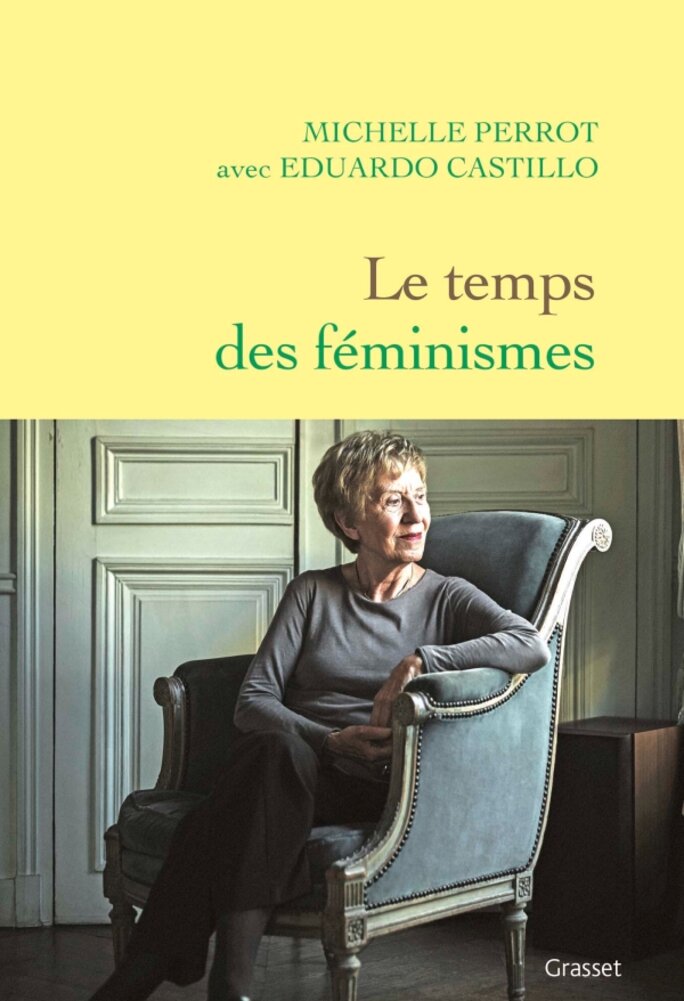
Agrandissement : Illustration 2
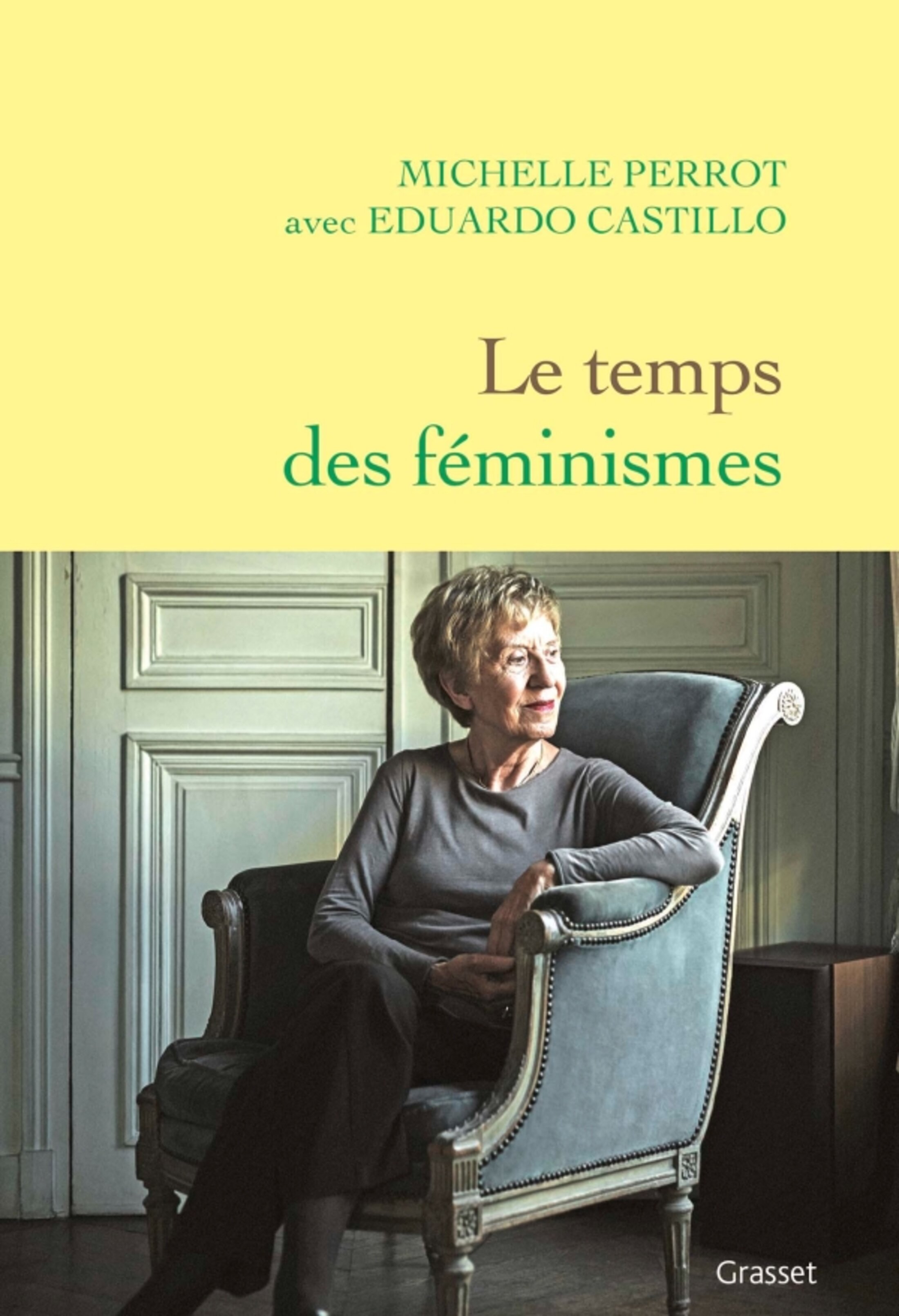
« Le temps des féminismes », qui vient de paraître chez Grasset, est dû à une suggestion d’un de ses anciens étudiants, Edouardo Castillo. Une série d’entretiens a abouti à l’ouvrage. Michèle Perrot se livre d’abord à un exercice devenu classique : celui de l’ego-histoire qui consiste à se situer socialement et culturellement pour tenter d’expliquer son intérêt pour la discipline. Elle évoque ensuite les principales autrices et auteurs qui l’ont illustrée : Fabienne Bock, Georges Duby, Yvonne Knibiehler, Nicole Pellegrin, Simone de Beauvoir, Françoise Héritier, Georges Vigarello, Françoise Thébaud, fondatrice de la revue « Clio » avec Michelle Zancarini-Fournel… et qui la construisent aujourd’hui : Geneviève Fraisse, Eliane Viennot, Florence Rochefort, Camille Froidevaux-Metterie, Christine Bard… Leurs œuvres sont présentées en fonction des thèmes traités au fil de l’ouvrage : patriarcat, inégalités sociales, violences, droits sexuels et reproductifs, le corps, l’amour… Nous avons là de précieux conseils de lecture.
Michèle Perrot fait état de son intérêt et de ses désaccords avec les thèses comme celles de sa collègue et amie américaine Joan Scott. Le féminisme porte-t-il un « masque blanc » ? Michèle Perrot récuse « la cancel culture qui signifie, effacement, retrait, suppression : ce n’est pas une attitude d’historien ». « J’ai du mal à penser que le féminisme soit une censure et je ne le veux en aucun cas ». Elle dénonce tout autant le refus de discuter autour des mots : « décolonial », « intersectionnalité », « woke »… « Il faut les prendre au sérieux, les étudier historiquement, voir comment un mot est né, pourquoi, et quels sont les emplois successifs qui en sont faits ».
Le livre se termine avec des réflexions ouvertes à la suite du salutaire mouvement #MeToo. Il porte à terme une révolution mentale favorable aux femmes comme aux hommes. « Comme l’amour, la relation entre les sexes est toujours à réinventer. Réaffirmons la puissance de l’amour. Mais réinventons-la dans l’égalité et la liberté ».



