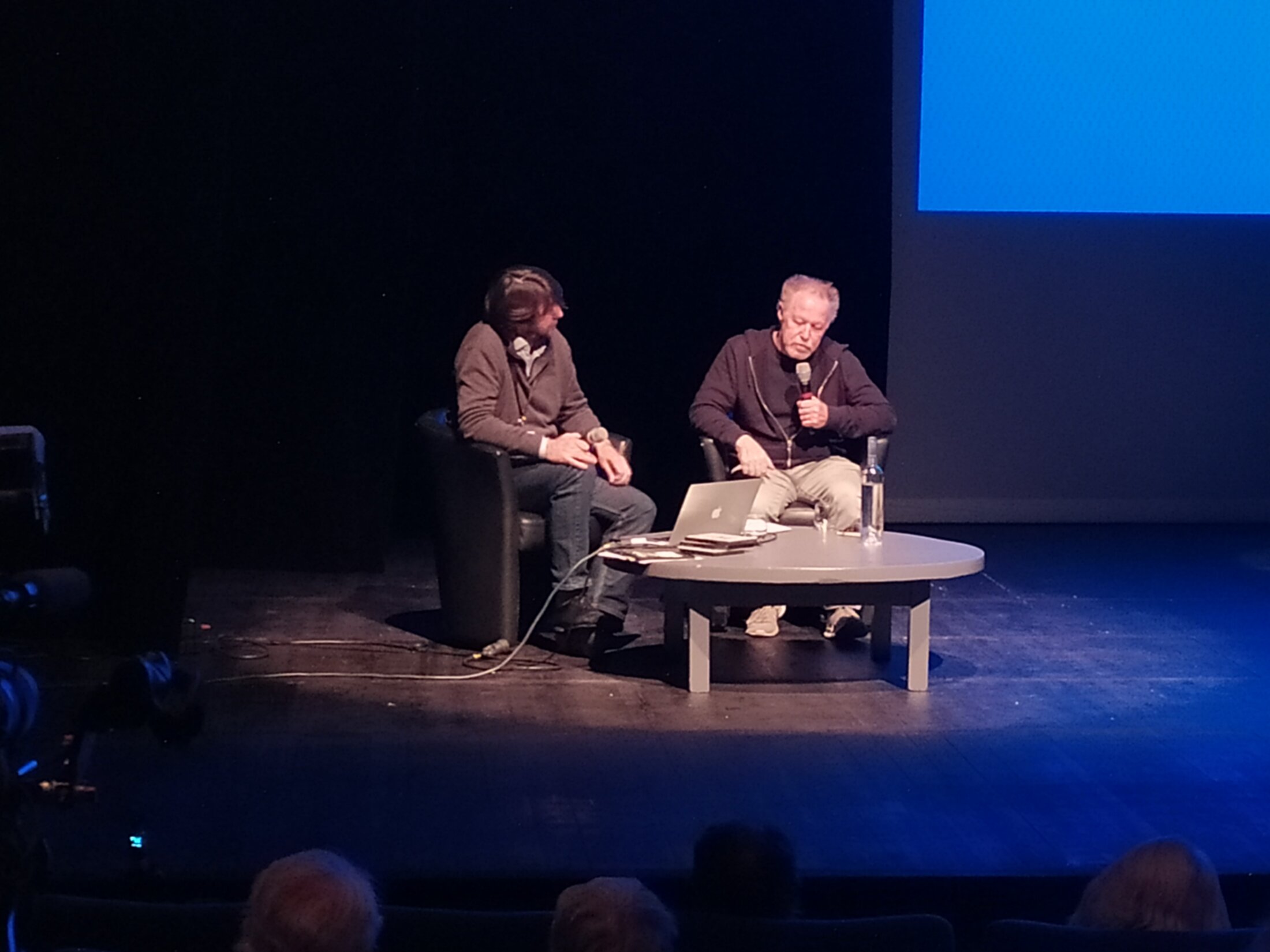Le but de ces leçons de cinéma est d'entourer les 30 films de la sélection de Cannes 1939 de rencontre et de montrer que ces films rentrent en résonance avec ceux d'aujourd'hui. C'est aussi une manière de donner la parole à des réalisateurs. Plusieurs extraits de ces films sont projetés avec pour mission à Nicolas de les commenter ou de les analyser.
Nicolas Philibert, jeune, ne se prédestine pas au cinéma puis, vers l'adolescence, comme son père projetait et analysait des films, il décide d'aller à certaines séances. Il réalise alors que le cinéma n'est pas qu'un divertissement mais un moyen de découvrir le monde, de voyager et de critiquer la ou les société(s). Comme il n'était pas suffisamment bon à l'école, il ne pouvait espérer entrer à la Fémis ou à l'institut Louis Lumière. Il entre donc dans le monde de l'audiovisuel par le biais d'un stage à Florac dans les Cévennes et n'en sortira plus. Travaillant pour « les films d'ici », réalisant des documentaires, on lui reproche souvent d'oeuvrer pour un genre perçu comme mineur.
Il co-réalise son premier film avec Gérard Mordillat La Voix de son maître. Des patrons donnent leur point de vue sur le mode de fonctionnement des entreprises, les relations entre les hommes qui les font vivre, et tentent de faire un portrait du patron des années 1970. C'est un documentaire qui a été remarqué et même marqué car il s'assume entièrement et a été censuré à la télévision (il n'y jamais été diffusé). Pour Nicolas, faire un documentaire c'est une seconde façon de faire de la fiction car c'est une interprétation du réel, une relecture du monde. Chaque personne sur un même événement aura sa vision subjective et personne ne verra la chose entièrement de la même façon.
En 1990, c'est La ville Louvre qui lui ouvre les portes des institutions. Fin des années 80, le Louvre entreprend de créer le grand Louvre (création de nouveaux passages souterrains, les restaurants, boutiques, réorganisation des salles, etc). Certaines œuvres, dans les réserves, depuis la seconde guerre mondiale, doivent être exposés dont des tableaux de 12m de long. Pour réussir à les sortir de véritables chantier sont mis en place (abattage de pan de mur entre autre). Le personnel du Louvre souhaite garder un film de ces opérations et font donc appel à lui. Le contrat devait durer deux journées. A la fin, il décide d'y retourner avec son équipe, le jour suivant, puis le jour d'après et ainsi pendant trois semaines. Les coulisses du musée lui ont plu, cette effervescence, cet amour de l'art, les corps de métier représenté, tout ce que le public lambda ne peut deviner. Pendant trois semaines, ils filment de façon clandestine et en fonction des contraintes. Ce sont des grands espaces avec beaucoup de réverbération et ils décident donc de jouer avec le son (les pas, les craquements du parquet, les paroles inintelligibles...), la bande son y est très importante. Puis, vient l'heure de demander l'autorisation au Louvre et de chercher du financement. Nicolas sélectionne donc des rushes d'une durée d'une heure. Personne n'avait alors filmé les coulisses d'un musée. Le financement ne pose pas de soucis et Michel Laclotte, le directeur du Louvre est enthousiasmé par ce projet. Il leur demande de continuer. Ce documentaire est sur le travail, on ne voit les œuvres qu'à travers lui (déplacement, restauration, scénographie...).
Le Louvre incarne une diversité sociale comme dans une ville (il y a les penseurs, les donneurs d'ordre, ceux qui exécutent...) et montre la hiérarchie existante partout. Nicolas constate aussi que ces employés sont fiers de leur travail, qu'ils ont l'impression de travailler pour le bien commun et de préserver les œuvres, le patrimoine pour les générations futures. Il fera ensuite la maison de la radio. Pour lui, les institutions sont la porte d'entrée. Les rouages de l'institution ne l'intéresse pas mais pouvoir montrer la comédie humaine est son but. A chaque tournage, il réfléchit au film final, au montage en tournant, il ne faut pas trop montrer. Nous sommes actuellement dans un monde d'image où tout est visible et le cinéma doit construire un regard, proposer quelque chose.
En 1995, il réalise un animal, des animaux. C'est sur la galerie de l'évolution au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et, plus spécifiquement sur sa création, la scénographie et le transport des animaux empaillés. Peut-on comprendre ce que l'on filme en filmant des animaux? La comédie animale existe-elle? Lors du tournage, les employés du musée jouent avec ceux qui filment. Le travail de Nicolas consiste non pas à faire des films sur mais des films avec. Les films servent à aller à la rencontre de ses contemporains, à la rencontre du monde dans lequel on vit. Ces films sont fait avec des questions, de l'ignorance et de la curiosité. Pour Nicolas, la beauté et la grandeur d'un film n'est pas proportionnelle à son sujet.
En 2010, Nénette sort sur les écrans. Nénette est le nom de la femelle orang-outan du Jardin des plantes à Paris. Doyenne de la ménagerie, elle a eu 50 ans en juin 2019. Les grands singes sont nos cousins, 95% de notre patrimoine génétique est similaire. Il n'a donc pas l'impression de filmer un animal. Nénette observe tout ce qui se passe autour de sa cage comme les visiteurs l'observent eux aussi. Ce documentaire montre une dissociation complète du son et de l'image. Des soigneurs, du personnel, des visiteurs sont interviewés mais nous ne voyons que Nénette sur l'écran. Elle ne parle mais regarde intensément avec ses grand yeux noirs. Ce film est sur l'étrangeté, l'altérité et le racisme, Nénette représentant l'autre par excellence (elle est très proche et très différente). La vitre de sa cage est ce qui permet de nous approcher mais aussi ce qui nous protège. Le monde animal nous interroge. Il y a 40 ans, on dissociait les animaux des humains sur trois critères (la conscience de soi, le rire, et le langage). Ces trois critères ont été détruits au fur et à mesure de l'avancée scientifique. Qu-est ce qui nous dissocie des animaux maintenant?
Nicolas pense que pour faire des films, il ne faut pas trop savoir, ni trop analyser ou réfléchir à ce que l'on fait ou devrait faire. Il faut juste suivre ses envies. Il faut aussi ne pas faire n'importe quoi surtout si on tourne avec des acteurs non-professionnels. En 1975, il est l'assistant de Réné Aillio sur Moi, Pierre Rivière. Son film Retour en Normandie, en 2007, revient sur les traces de tout ces paysans ayant appris un texte, s'étant costumé pour jouer sous la direction de Réné Aillio. La question de ce film tourne autour de ce qu'on laisse derrière soi quand on fait un film. Un cinéaste oriente la vie de ses acteurs, il est responsable vis-à-vis des gens qu'il se propose de filmer.
Merci à Antoine de Baecque et à Nicolas Philibert pour cette leçon de cinéma.

Agrandissement : Illustration 1