Un article de Lise Brenot, psychologue clinicienne à la Coordination Marseillaise Santé mentale et Habitat (CMSMH)
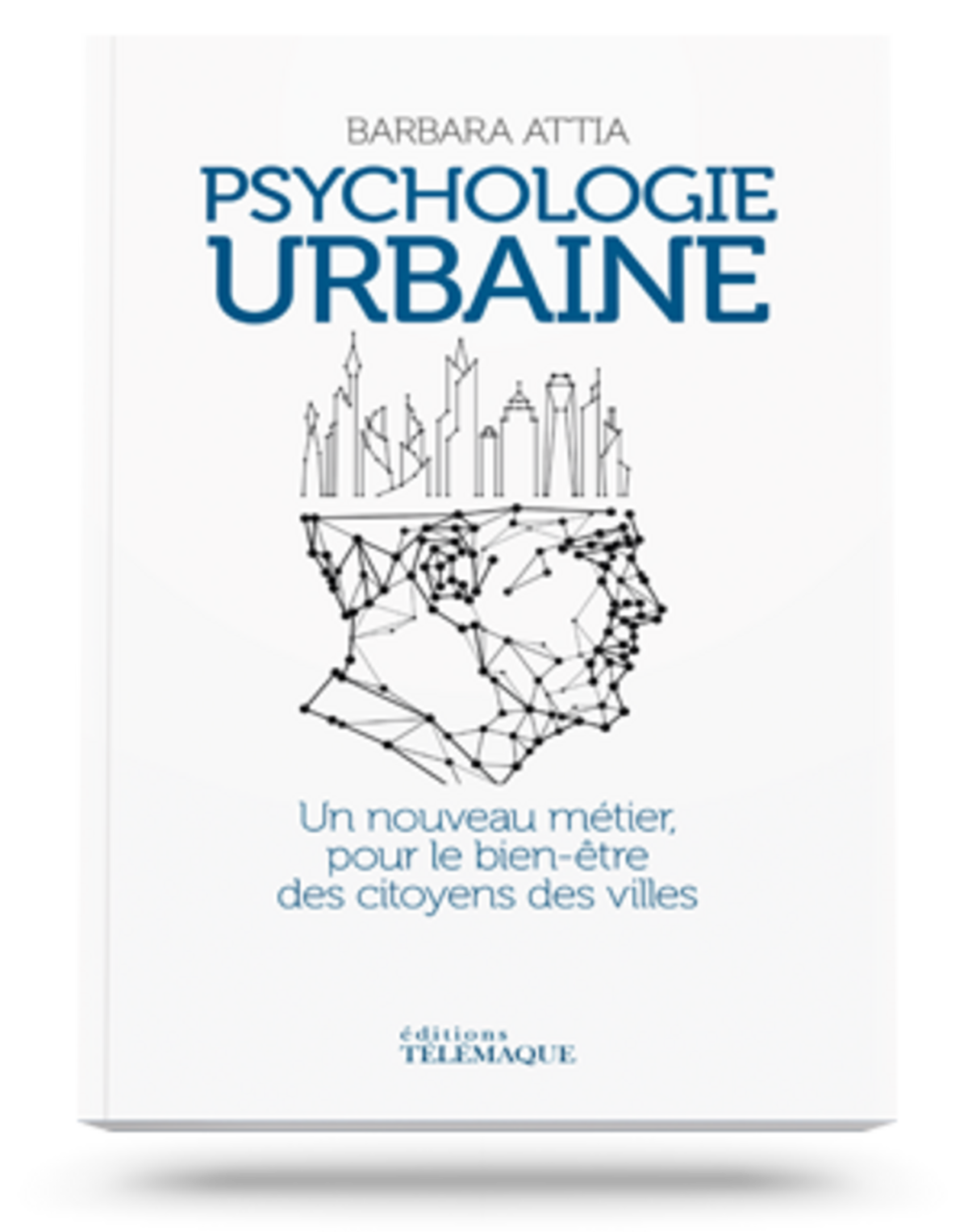
La sarcellite : la maladie apparaît au début des années 1960 avec les villes nouvelles et les premiers grands ensembles. Diagnostiquée par ceux qui dénoncent le caractère enclavé de bâtiments sans âme, greffés artificiellement au corps ancien des villages ou des villes de banlieue, elle désigne la névrose des habitants de ces quartiers exclusivement composés de logements. Une névrose qui prend la forme d’un état de déprime induit par l’exclusion sociale et économique et que l’aspect brutal des barres d’immeubles est censé rendre contagieux. Comme à Sarcelles, commune du nouveau département du Val-d’Oise dont la métamorphose urbaine s’étala de 1955 à 1970.
Mais ce mal-être naît-il de la « rude » apparence des immeubles en béton ou bien d’une organisation sociale réduite à l’empilement de blocs de « machines à habiter » ? C’est dans cet interstice que s’enracine la psychologie urbaine, nouvelle approche qui a donné lieu en 2019 à un congrès international à Londres et à laquelle Barbara Attia, fondatrice du cabinet Hurba, consacre un ouvrage où elle détaille la méthode qu’elle utilise elle-même dans ses interventions.
Cette méthode associe médiation avec les habitants et information des acteurs politiques et économiques concernés sur le vécu, les représentations symboliques et les aspirations des personnes. Le psychologue urbain prend à la fois en compte l’intime et le collectif afin d’identifier ce qui favorise et entretient le lien social dans un quartier donné, dans l’idée d’un « mieux-vivre ». Il est mandaté par les élus et les décideurs en amont d’un projet et reste ensuite indépendant dans la façon de mener son étude. La rencontre avec les habitants du quartier – échelle privilégiée parce qu’elle correspond au vécu quotidien – s’organise par l’entremise d’entretiens qualitatifs où, comme dans un cabinet, le psychologue écoute avec empathie le récit de vie de la personne.
Cette méthode de l’entretien puise dans les concepts fondamentaux de la psychologie, tels que ceux d’« attachement » et d’« identification », les représentations personnelles et la capacité de résilience. Ce qui, en psychologie urbaine, se traduit par « sentiment d’appartenance », « exclusion », « identité locale » et « perceptions ». Les éléments tirés de ces entretiens sont ensuite analysés et transmis aux acteurs du projet urbain sous forme d’un « cahier de recommandations » qui s’apparente à un diagnostic. Entre-temps, cette approche sensible d’un territoire a permis de saisir comment il est « habité » par ceux qui y vivent.

Agrandissement : Illustration 2

Dans le podcast qui accompagne la sortie de son livre, Barbara Attia présente l’exemple de la réhabilitation du quartier de la Briqueterie, à Marcq-en-Barœul (Nord), où les entretiens et des ateliers organisés à la maison de quartier ont permis d’échanger avec les habitants les plus mobilisés mais aussi, grâce à une présence quotidienne, avec les jeunes, et de faire accepter, entre autres, la destruction de trois grandes tours. Autre exemple, celui d’un déplacement d’habitants en raison du risque de coulées de boue de nature volcanique sur la commune du Prêcheur, en Martinique. En dépit du danger, ceux-ci s’opposaient fermement à tout déménagement. Mais l’expression des appréhensions et la formulation des attentes liées au projet a rendu possible le dialogue, et son acceptation.
La prise en compte du discours des habitants possède une dimension thérapeutique et d’empowerment – l’autonomisation des personnes par l’octroi de davantage de pouvoir pour agir sur leurs conditions de vie. Il s’agit de « prendre soin » des habitants et de susciter une « identité urbaine » valorisante dans laquelle chacun peut se reconnaître et exprimer ses potentiels. La psychologie urbaine se différencie ainsi des approches sociologiques et de la classique « concertation habitante » en urbanisme par ce rapport au care, et par sa capacité à réunir les aspects intimes et collectifs de la vie des habitants pour les faire coexister sans clivage dans l’espace public.
Psychologie urbaine, Barbara Attia, éditions Télémaque, 2022, 148 pages, 12 €.
_________________________________

Agrandissement : Illustration 3

Les Cercles Condorcet sont affiliés à la Ligue de l'enseignement. Celle-ci anime une autre édition sur Médiapart: "Laïcité". Fondée en 2009 cette édition propose plus de 500 articles. Elle assure le suivi des événements, initiatives et publications liées à la laïcité au sens le plus large. Ne manquez pas de la visiter !



