
Agrandissement : Illustration 1

Maire, député, conseiller général et régional, ministre, maître des requêtes au Conseil d'État, secrétaire général de la présidence de la République (sous la présidence de François Mitterrand, le plus jeune en titre et celui qui exercera le plus longtemps la fonction), Jean-Louis Bianco a mené une remarquable carrière politique. On le retrouvera aussi bien président de l’Office national des forêts que de l’Observatoire de la laïcité dont nous avons suivi de prés les travaux. A chacun de ces niveaux d’engagement et de travail, Jean-Louis Bianco a intégré d’une façon ou d’une autre la dimension européenne à laquelle il a consacré un ouvrage « Trans-Europe-Express » (Editions Plon) en 1992. Comme sur chacun des sujets auxquels il s’est consacré, il l’accompagne d’une réflexion approfondie. C’est le cas avec la présente étude qu’il nous a aimablement autorisé à publier.
Le couple France-Allemagne est en crise ! Ou le moteur, ou le tandem, comme vous voudrez. Est-ce grave docteur ? C’est arrivé tellement de fois depuis le Traité de l’Elysée en 1963. Les difficultés ont commencé le jour même de sa ratification, quand le Bundestag y ajouta unilatéralement un préambule exaltant l’Alliance Atlantique. Selon Alain Peyrefitte dans C’était de Gaulle, le Général a réagi en privé avec fureur: « Les Américains essaient de vider notre traité de son contenu… tout ça pourquoi ? Parce que les politiciens allemands craignent de ne pas s’aplatir suffisamment devant les Anglo-Saxons ! ».

Agrandissement : Illustration 2

Ce doute originel sur la conviction allemande à s’engager dans ce couple et dans l’Europe a duré très longtemps. Il a connu un sommet d’intensité pendant la phase de réunification de l’Allemagne, au cours de laquelle j’ai assisté à une grave crise. La reconnaissance par l’Allemagne de la nouvelle frontière avec la Pologne, dite ligne Oder-Neisse, était une condition nécessaire à un processus pacifique. J’avais souligné auprès du Président Mitterrand combien la difficulté était extrême pour l’Allemagne, comme si nous devions renoncer à plusieurs Alsace-Moselle, sans compter que la guerre avait déplacé des millions d’Allemands et que le Chancelier Kohl avait une partie importante de son électorat dans les familles de réfugiés qui rêvaient toujours d’un impossible retour au passé . Kohl tardait à franchir le pas, au point que la tension a été forte entre le Chancelier et le Président. J’étais malgré tout convaincu que Kohl, ardent Européen, finirait par reconnaitre la frontière. Ce qu’il fit à la fin du processus le 21 juin 1990. On n’a pas non plus suffisamment mesuré en France le courage qu’il a fallu au chancelier Kohl pour s’engager en faveur de la création de l’Euro et renoncer ainsi à la sphère d’influence que constituait la zone mark.

Agrandissement : Illustration 3

L’Europe, et au premier chef la France et l’Allemagne, sont aujourd’hui face à des défis historiques. Crise covid, fragilité des équilibres géopolitiques et proximité de guerres que l’on croyait impossibles, crises énergétiques, perte de vitesse des démocraties libérales : jamais le besoin d’une Union Européenne puissante n’a été si fort. Ne peut-elle reposer que sur un couple franco-allemand soudé ? Comment le réinventer ?
D’abord comprenons que l’Allemagne est empêtrée dans une coalition compliquée, coalition à trois partenaires: le SPD, les libéraux et les verts. Et même en Allemagne l’atterrissage entre les promesses de campagne et la réalité se révèle… sportif. Qui dit sortie du nucléaire, dit relance du charbon et dépendance aux importations de gaz. C’est un changement d’ère (Zeitenwende) difficile à négocier, surtout quand on obtient de très mauvais résultats dans les élections régionales et que les sondages nationaux donnent l’AFD (extrême-droite) presque au niveau des verts et du SPD. Ajoutez à cela un Chancelier dont l’autorité et le charisme ne sautent pas aux yeux et des écologistes qu’on accuse d’avoir une vision « punitive » de l’écologie.

Agrandissement : Illustration 4

Par ailleurs, n’ignorons pas le poids de la différence entre nos deux régimes, l’un parlementaire et l’autre présidentiel. Les Français n’ont pas intégré le fonctionnement des institutions outre-Rhin, en témoigne l’indifférence avec laquelle sont reçus les présidents de Länder qui ont pourtant un pouvoir décisif dans la vie économique allemande. D’autre part, quand bien même les positionnements politiques du Chancelier et du Président du moment sont un tant soit peu alignés, il faut une intimité et une confiance entre ces deux personnalités. Elle ne semble pas évidente entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, qui au surplus jouent chacun leur propre partition sur la scène internationale.
Nous avons des divergences de visions du monde et d’intérêts. Pascal Lamy les résume parfaitement : « la guerre de Poutine a fait remonter à la surface les trois sujets sur lesquels les Français et les Allemands n’ont jamais été d’accord : l’énergie, la défense et le budget européen. Nucléaire contre charbon, dépendance américaine contre autonomie stratégique, dépensiers contre frugaux » (Le Grand continent 12/04/23).
L’énergie. Sujet doté d’une forte charge idéologique dès qu’on aborde la place du nucléaire. Fierté de l’Allemagne d’en être sortie, fierté de la France d’avoir un modèle dont on redécouvre la vertu d’indépendance à l’occasion de la guerre en Ukraine. Mais surtout intérêts divergents, la France voulant bénéficier d’une électricité moins coûteuse et cherchant à faire admettre le nucléaire comme énergie décarbonée dans les documents européens ;l’Allemagne accusant la France de rechercher un avantage compétitif, à un moment où le modèle industriel allemand, fondé sur l’exportation, est en difficulté. Ce qui amène à l’éternelle comparaison entre nos deux économies. Ironie de l’histoire : depuis le début de l’Union Européenne l’Allemagne est le bon élève, compétitif et exportateur, par opposition à la France, longtemps dopée à la dévaluation et toujours en déficit commercial.

Agrandissement : Illustration 5
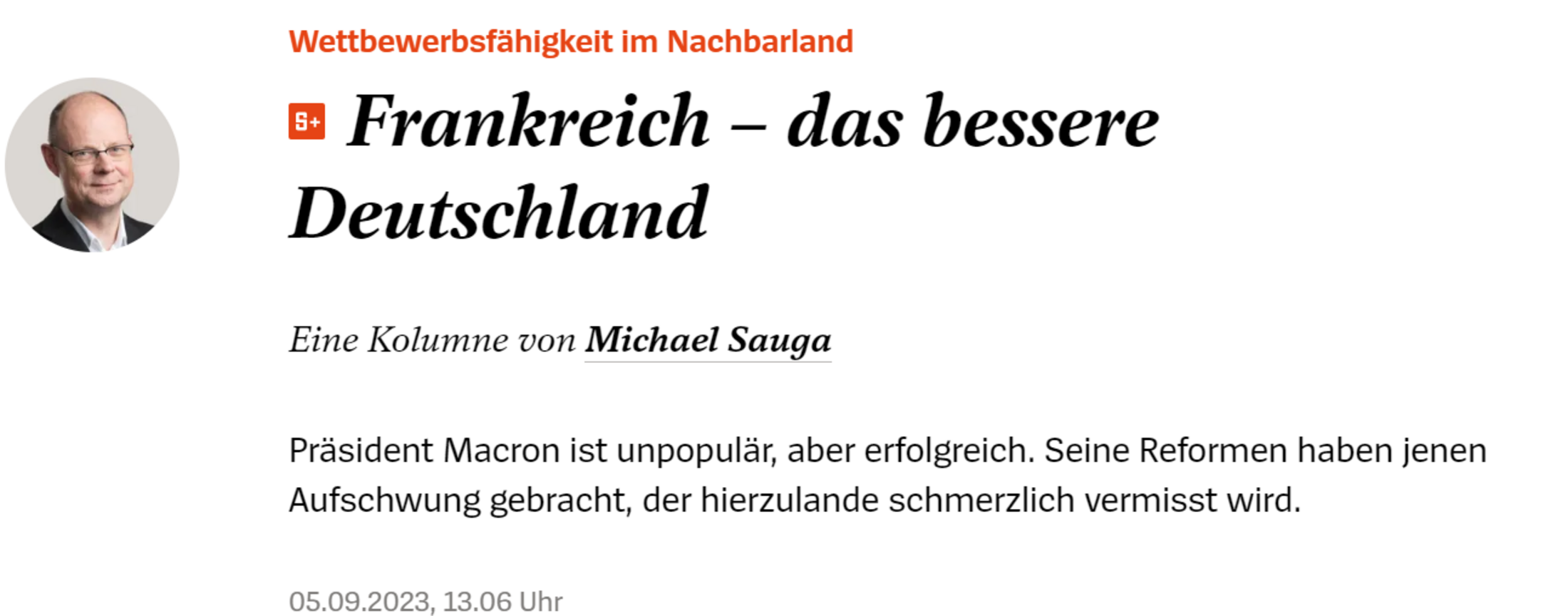
Et voilà que Der Spiegel titre : « La France c’est l’Allemagne en mieux. Frankreich : das bessere Deutschland ». Comme si le complexe d’infériorité changeait de camp, il commence à exister en Allemagne une sorte de crainte devant les performances économiques françaises.
La défense. L’expérience nous apprend que les coopérations sur le matériel de défense sont toujours compliquées, quels que soient les partenaires, à cause des habitudes différentes, des lobbies, des enjeux en termes d’emploi. Faire un porte-avions commun avec les Britanniques s’est révélé impossible… parce que les Anglais avaient des avions à décollage vertical et pas nous. Le projet d’un avion de combat européen a abouti à un mastodonte parce qu’il devait satisfaire des exigences différentes suivant les Etats-majors… Les Allemands et nous n’avons pas la même conception en matière de chars parce que nous ne pensons pas aux mêmes types d’interventions (usage frontal d’où des chars lourds pour les Allemands, chars plus légers pour les Français dans un contexte de guérilla). Et malheureusement les Allemands ont fait le choix d’un avion américain « sur étagère » au détriment d’un programme commun. Ainsi, « la décision d’acheter les F35 américains a été vécue comme un premier signe de défiance en France alors qu’elle était plutôt une réaction à une prise de conscience allemande d’une extrême vulnérabilité (…) ».(Michaela Wiegel, dans Le Grand Continent du 3 octobre 2023).

Construire une défense européenne est sans doute l’un des sujets sur lesquels le couple franco-allemand peut réaliser des avancées décisives. L’espoir est permis. La conception allemande est en train d’évoluer brusquement, à la suite de l’invasion russe en Ukraine, avec des choix budgétaires inédits. Plutôt que d’essayer de concilier des chaînes de valeurs inextricables pour concevoir des armements communs, ne peut-on pas concentrer notre énergie sur l’intégration des commandements, des exercices et des forces armées, en sélectionnant ce qui se fait de mieux dans les équipements nationaux ?
La politique budgétaire européenne. Depuis longtemps des voix s’élèvent, et pas seulement en France pour déplorer la rigidité des règles budgétaires européennes, qui mériteraient d’être différenciées selon la conjoncture économique et selon la nature des dépenses. L’Allemagne y est farouchement opposée, car elle voit dans ces règles une garantie contre les dépenses inconsidérées des pays les moins rigoureux (certains parlaient des « pays du Club Med »). Mais le coût très élevé des investissements nécessaires pour la transition écologique impose de réexaminer les règles historiques.

Y a-t-il une alternative au couple franco-allemand ? Non bien sûr. L’Angleterre est ligotée par les conséquences du Brexit et n’est vraiment pas d’humeur à se lancer dans un partenariat quel qu’il soit, sauf peut-être sur certaines postures en matière de défense. L’Italie est obnubilée par la question des migrants, l’Espagne cherche une majorité, les populistes progressent partout, entraînant les discours politiques vers la défense toujours plus étroite des intérêts nationaux à court terme et vers des positions de repli sur soi. Ce n’est pas une raison pour ne rien faire, notamment sur la transition écologique.
Du point de vue géopolitique, une communication cacophonique ne fait qu’affaiblir le couple et le poids de l’Union Européenne. La France et l’Allemagne ne devraient faire que des déclarations communes. Les récentes prises de position des deux chefs d’Etat sur le conflit israélo-palestinien, la démarche personnelle d’Ursula Von der Leyen (qui n’avait pourtant aucun mandat pour le faire) ont des effets désastreux sur notre crédibilité et montrent l’ampleur du chemin à parcourir. Je plaide pour un choc de confiance franco-allemand, qui devrait s’appuyer sur quelques sujets précis, en considérant davantage l’échelon des Länder. L’Allemagne semble prête à des investissements conjoints. Nous pourrions prioriser la défense, l’éducation (notamment en étendant considérablement Erasmus), la recherche (par exemple avec un nouvel « Eurêka » sur des innovations de rupture – « l’Airbus des batteries » est à cet égard encourageant).

Agrandissement : Illustration 8

Nous avons besoin d’un grand projet mobilisateur. Ce grand projet est tout trouvé, c’est celui de la transition verte. Il doit permettre une souplesse de périmètres d’action, condition nécessaire à l’efficacité. Tous les niveaux peuvent être mobilisés selon le sujet : pays, collectivités locales, entreprises, société civile. Certaines actions peuvent être réalisées entre Français et Allemands, d’autres sous la forme de coopérations renforcées avec les pays décidés à avancer sur un sujet précis. Ce projet doit avoir un branding, un nom qui soit connu de toutes et tous, comme Airbus ou Ariane. En politique, il faut prêter autant d’attention à l’action en elle-même qu’à sa perception. Il faut enfin aux dirigeants une volonté de semer pour solidifier cette relation sans attendre d’en récolter les fruits au cours de leurs mandats. Tâchons d’aller au bout de cette thérapie de couple, pourrait-on dire « dans l’intérêt de l’enfant », l’Union Européenne.
Jean-Louis Bianco.



