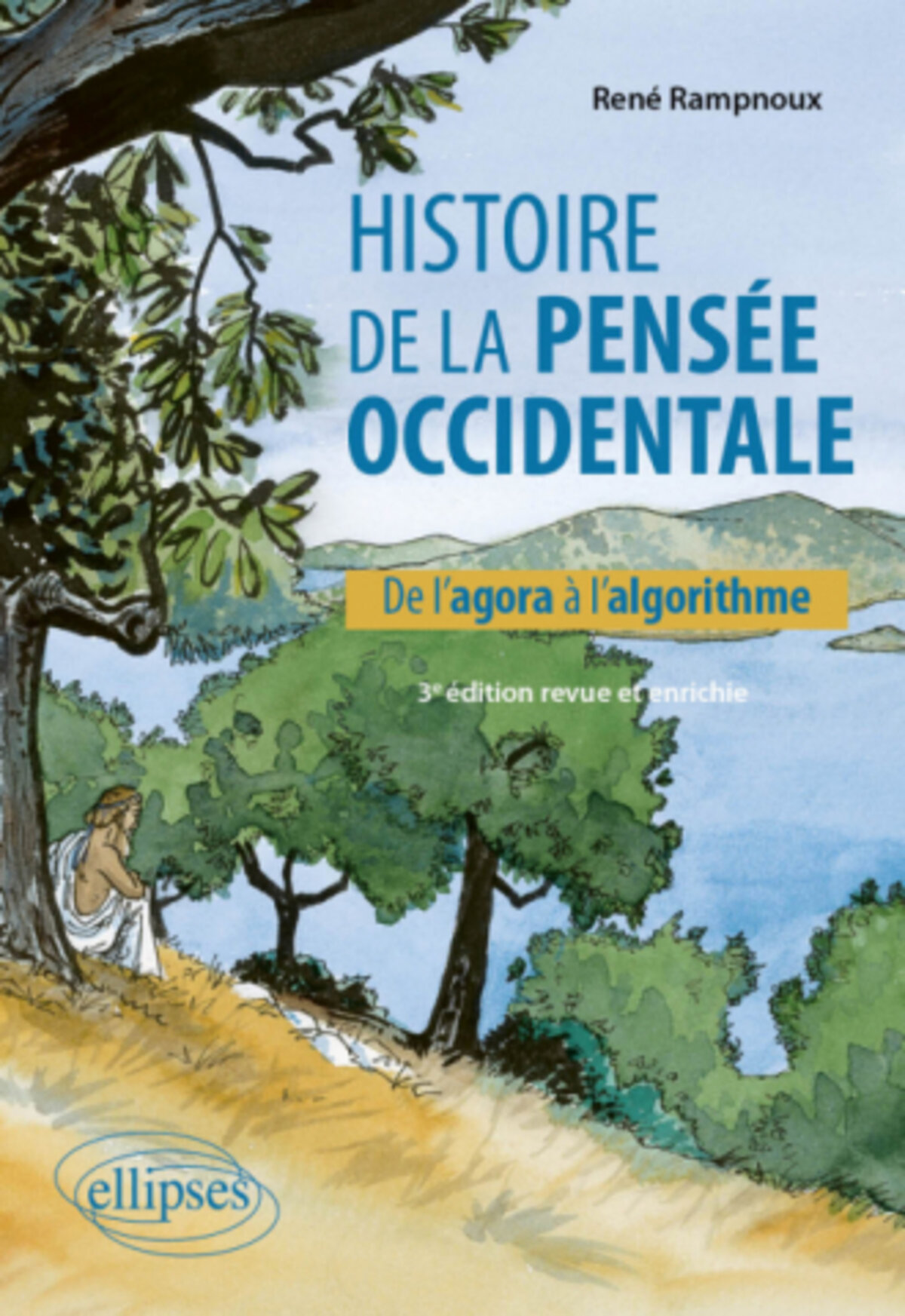
René Rampnoux est agrégé d’économie et de gestion, coordinateur d’ouvrages de préparation aux concours commun IEP, essayiste, ancien Grand Maître adjoint du Grand Orient de France, administrateur de la Ligue de l’enseignement de Gironde. Auteur d’une trentaine d’ouvrages, il propose dans les 480 pages de « Histoire de la pensée occidentale » un panorama détaillé de l’évolution de cette pensée « de l’agora à l’algorithme » pour reprendre le paronyme utilisé en sous titre. Gage de qualité, cet opus est publié par les Editions Ellipses connues pour l’attention portée à la fiabilité des œuvres qu’elles publient. Gage d’intérêt, c’est la troisième édition (enrichie) qui nous est proposée.
La présente recension s’inscrit dans le suivi par les Cercles Condorcet des principaux livres consacrés à l’Europe dans tous ses aspects. C’est pourquoi nous qualifions cette œuvre d’histoire de la pensée européenne. Elle est plus pertinente, nous semble-t-il, que « pensée occidentale » qui renvoie au monde transatlantique qui exclut l’Est de l’Europe. Car la quasi-totalité des penseurs évoqués sont tous de notre continent. Le défi était titanesque. Il a été relevé.
Comment rendre compte d’un tel ouvrage ? D’abord en citant l’auteur qui définit d’emblée son projet : « L’objet de ce livre est la joie de s’approcher de notre maison commune qui contient l’idée de progrès, l’aspiration à l’égalité, l’affirmation de la raison universelle et l’appétit de justice ». Ensuite en picorant dedans. Et d’abord, bien sûr, en nous plongeant dans les fondations grecques. Car tout était en germe dans le génie grec.
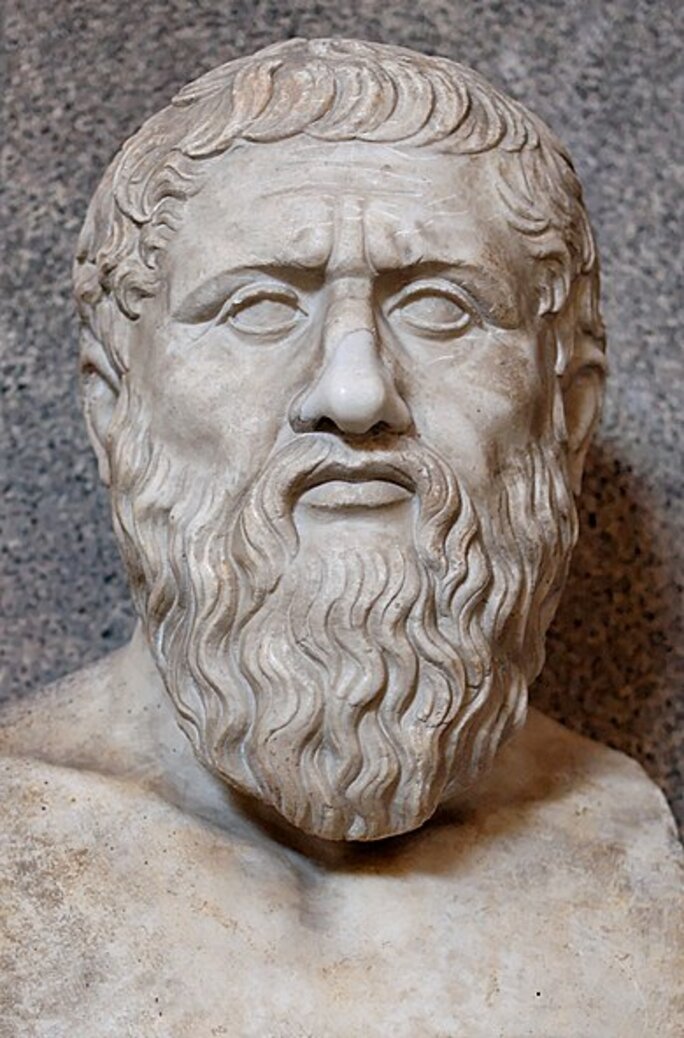
Prenons l’exemple de Platon, auquel René Rampnoux consacre huit pages. La vie d’Aristoclès, surnommé « Platon » (large d’épaules), est assez mal connue, mais son œuvre nous est intégralement parvenue. Très influente dans l’Antiquité gréco-latine, elle a été redécouverte au XV° siècle. Elle nourrit toujours nos réflexions. Ses dialogues sont des chefs d’œuvre de pédagogie, grâce auxquels l’auditeur puis le lecteur pensent par eux-mêmes. Usant de la démonstration, de l’interrogation, de l’allusion, du mythe… il traite du beau, du vrai, du bien… Ces huit pages sont une vraie ouverture à une pensée complexe, sollicitée par bien des auteurs.
Bondissons au Moyen-âge, les « temps alchimiques » écrit René Rampnoux. Que peut nous apprendre, exemple entre mille, la querelle des universaux qu’il présente avec concision dans une page et demie ? Existe-t-il un « universel », une notion générique, par exemple le concept d’ « Homme » ou seulement des choses singulières, dans cet exemple monsieur Dupont, monsieur Martin… L’air de rien cette querelle à l’allure très philosophique s’est retrouvée à l’arrière plan de la Révolution française…
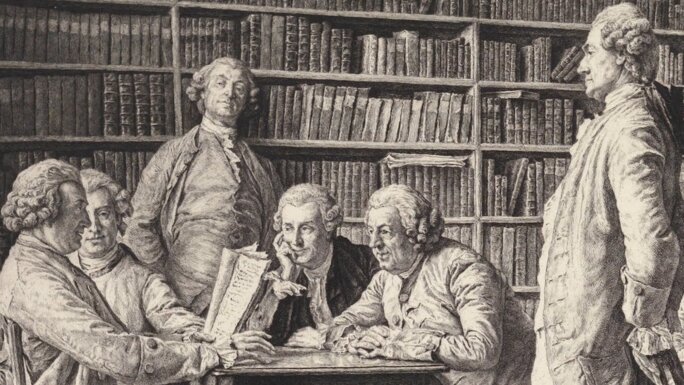
Agrandissement : Illustration 3
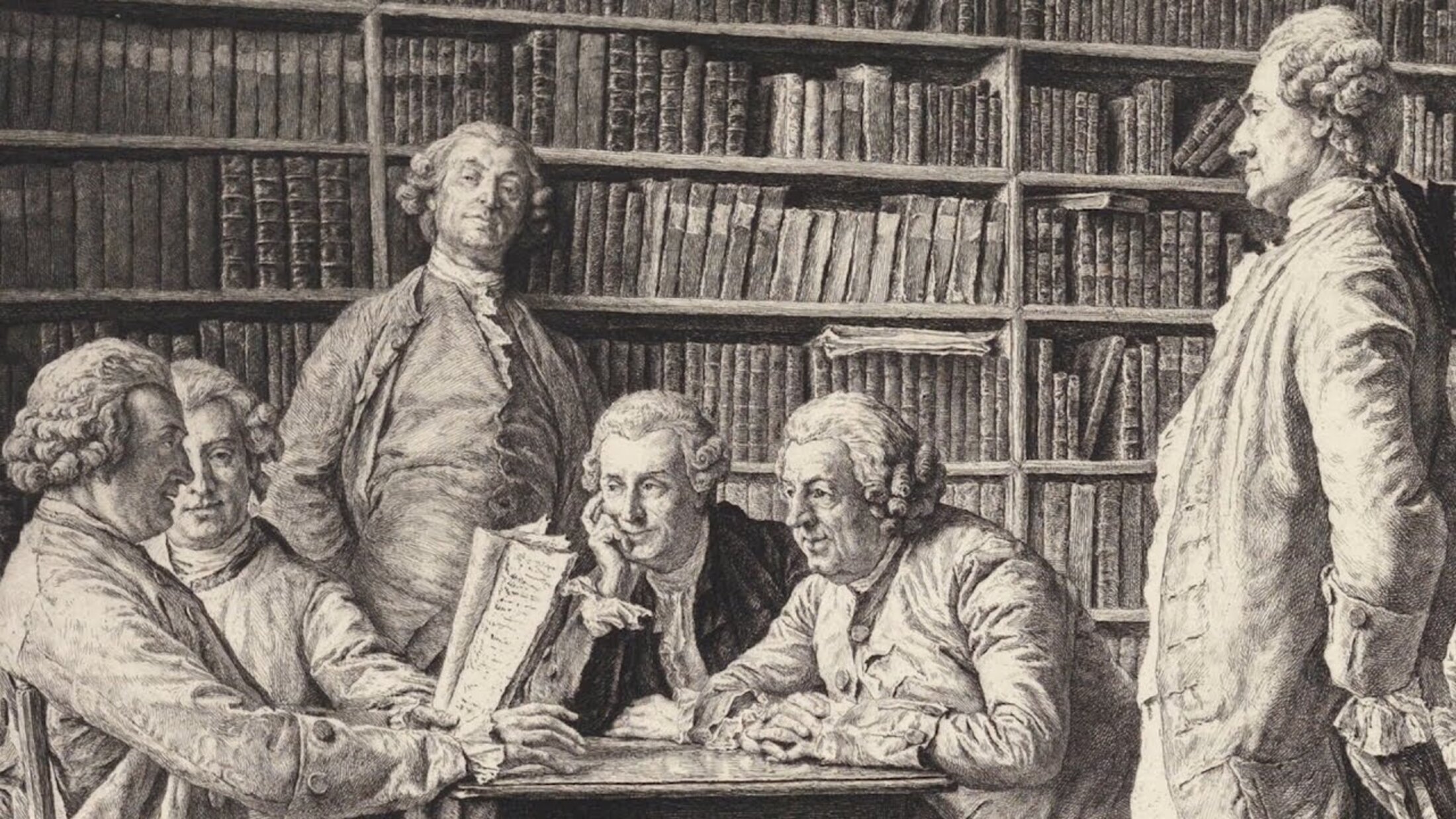
Ces deux exemples (neuf pages et demie sur 480 !) donnent une mince idée de l’ampleur des notions traitées et des auteurs mobilisés. La Renaissance est atteinte dès la page 80. Suit un fleuve intellectuel marqué par Copernic, Descartes, Spinoza, Leibnitz… puis les Lumières anglaises, françaises, allemandes… les conceptions rationnelles de l’économie, des sciences, l’humanisme face au nihilisme puis aux théories de l’évolution, voire le freudisme… Nous sommes ensuite invités à nous plonger dans la phénoménologie, la question de la place des intellectuels eux-mêmes, notamment comme particularité française… pour finir avec une réflexion sur la nature de la science et de sa méthodologie, et l’accélération des rythmes de l’histoire.

Agrandissement : Illustration 4

Devant cette érudition, cette convocation vertigineuse de toutes les interrogations et des tentatives de réponses que les penseurs européens ont opérées, on peut rester intimidé. Adoptons la formule consacrée : cette œuvre ne se lit pas comme un roman. Elle est une ressource permanente, une œuvre à ranger à portée de main, destinée à nourrir la réflexion au long cours de celles et ceux qui se réclament de l’humanisme européen.



