La métamorphose d’un jeune soldat…

Agrandissement : Illustration 1

La parution de « La conquête du courage » de Stephen Crane aux Etats-Unis en 1895 a été perçue "comme un éclair d'un ciel clair d'hiver". L’auteur a 24 ans. Ses parents sont des pasteurs méthodistes. Ils ont quatorze enfants. Stephen est le dernier né. Son premier livre, «Maggie, une fille des rues », ouvre la voie à un courant littéraire nouveau aux Amériques : le naturalisme. Il était déjà illustré en Europe par Emile Zola et bien d’autres. Journaliste, Stephen Crane couvre plusieurs guerres dans le monde. Il meurt à 28 ans de la tuberculose. « La conquête du courage » est devenu un classique aux Etats-Unis. Le style de Stephen Crane est précis, descriptif. L’action se déroule durant la « Civil War » que nous appelons Guerre de sécession. Terminée en 1865, elle est récente au moment où est écrit le livre. A la fois implacable et fratricide, elle a profondément marqué le pays.
L’histoire est simple. Un jeune homme, Henry Fleming, se porte volontaire dans l’armée nordiste. Une fois porteur de l’uniforme bleu, il constate une relative impréparation. Il doute de son propre courage. Et de l’armée elle-même : « Le soupçon subit lui vint que les généraux ne savaient pas ce qu’ils faisaient… ces forêts proches allaient soudain se hérisser de fusils, tous allaient être sacrifiés : les généraux étaient stupides ! L’ennemi ne ferait qu’une bouchée du régiment entier ! Il jeta des yeux égarés autour de lui, guettant l’approche furtive de la mort ».
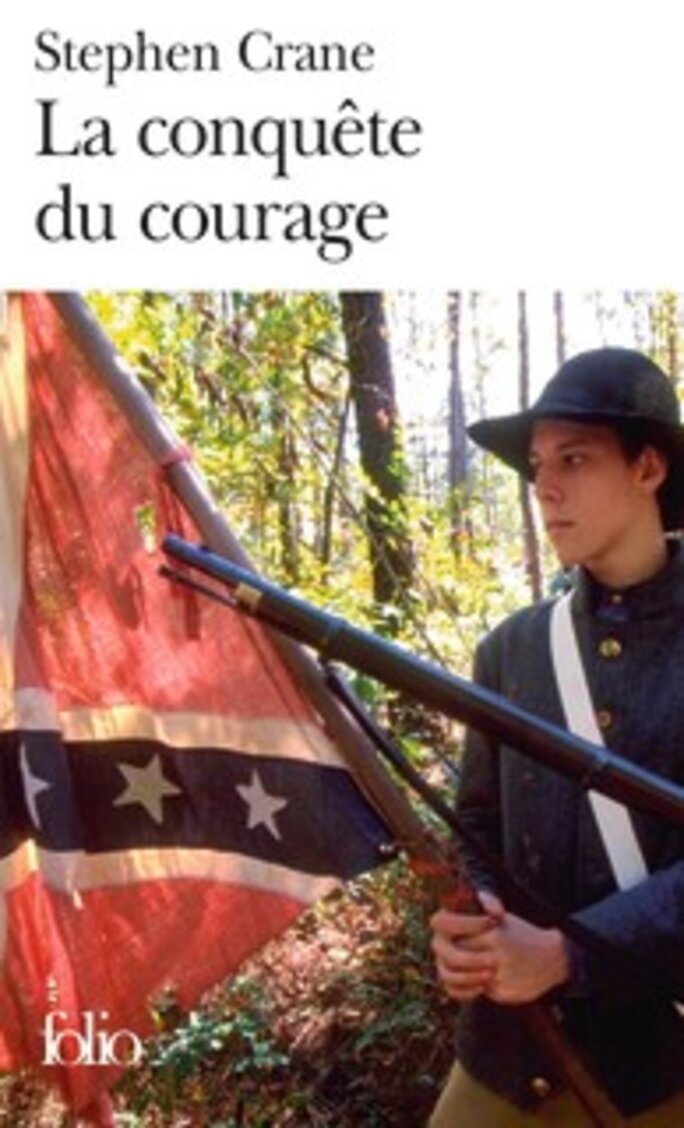
Dans le chaos de la bataille, le jeune soldat recule et se perd dans les bois. Il est blessé accidentellement à la tête par un autre fuyard. Retrouvant son peloton, il s’avise que plusieurs soldats ont fait de même alors que ceux restés en première ligne ont résisté à l’assaut des ennemis. A la fois inquiet d’une possible révélation de son moment de peur et honteux vis-à-vis de ses compagnons d’armes, Henry est désemparé. Mais il se reprend : « Les monstres de la bataille, il les avait vu de près, et il avait pu s’assurer qu’ils étaient moins hideux qu’il ne les avait imaginés. Leurs coups portaient au hasard, leurs dards étaient sans précision. Souvent, à les défier, un cœur solide échappait à leur rage ».
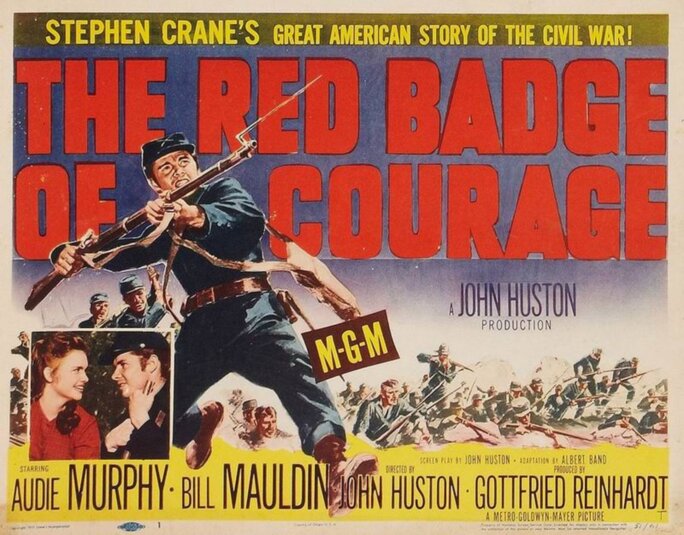
Agrandissement : Illustration 3

Lors de la bataille suivante, Henry puise en lui la force de s’affirmer. Il est emporté par le tourbillon, se saisit du drapeau nordiste tombé des mains d’un de ses camarades tué et monte à l’assaut. « Dans cette lutte, il avait surmonté des obstacles aussi hauts que des montagnes, écroulés maintenant comme des châteaux de cartes et il était devenu ce qu’on appelle un héros, sans avoir eu aucune conscience de sa métamorphose ». Le roman de Stephen Crane n’est ni une apologie ni une critique de la guerre. Il décrit précisément ce qu’annonce son titre : une conquête du courage. Un thème qu’il reprendra dans un recueil de nouvelles : « Un mystérieux héroïsme » (Editions Autrement). Son roman se termine ainsi : « Le jeune homme souriait, car il voyait que le monde était un monde à sa taille… Il s’était purgé du rouge affrontement de la mêlée. Il se tournait maintenant vers une existence de paix… ».
… et celle d’un jeune bourgeois
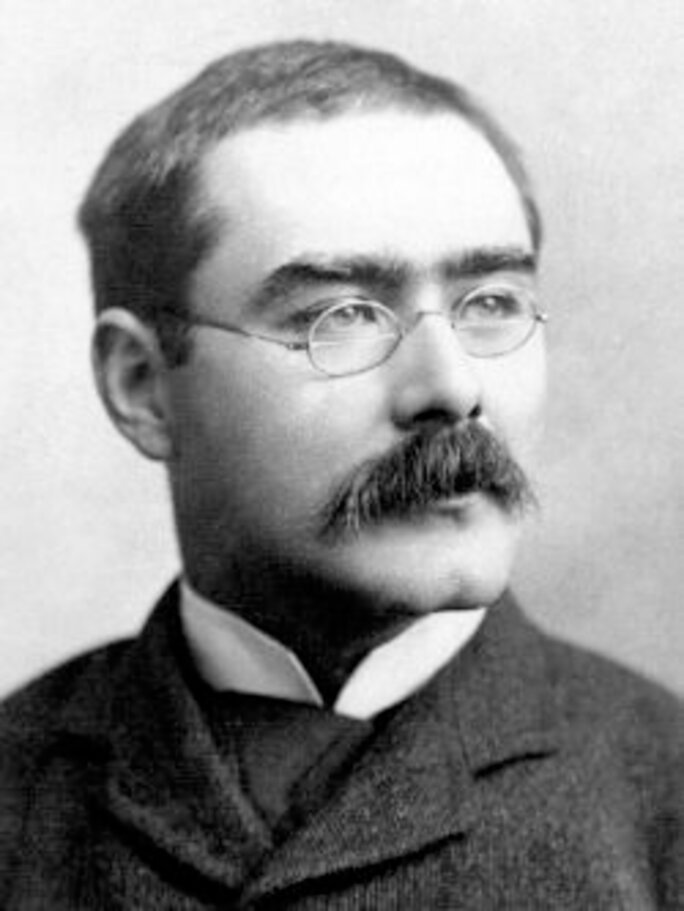
C’est une autre métamorphose que nous conte Rudyard Kipling dans « Capitaines courageux ». Kipling est aussi anglais que Crane est américain. Rudyard Kipling est, comme Stephen Crane, fils de deux pasteurs méthodistes. Les deux auteurs furent journalistes. « Capitaines courageux » et « La conquête du courage » furent adaptés au cinéma. Rudyard Kipling a 32 ans lorsqu’il écrit « Capitaines courageux » en 1897. Il connaîtra un succès immédiat. Son titre est tiré d’une vieille ballade anglaise. Il s’inscrit dans la prolifique tradition des romans maritimes. Comme chez Crane, l’histoire est simple. Harvey Cheyne est un jeune américain. La fortune de son père est de trente millions de dollars. C’est un prétentieux de quatorze ans imbu de sa classe sociale. « Harvey n’avait en toute sa vie jamais reçu d’ordre direct ». Voyageant sur un paquebot, il chute dans l’océan et est recueilli dans une goélette de pécheurs filant vers Terre Neuve. Arguant de sa fortune, il exige d’être reconduit à New York. Mais il n’est pas cru. Le capitaine poursuit sa route et l’embauche d’office avec un salaire correct pour un moussaillon : dix dollars par mois.
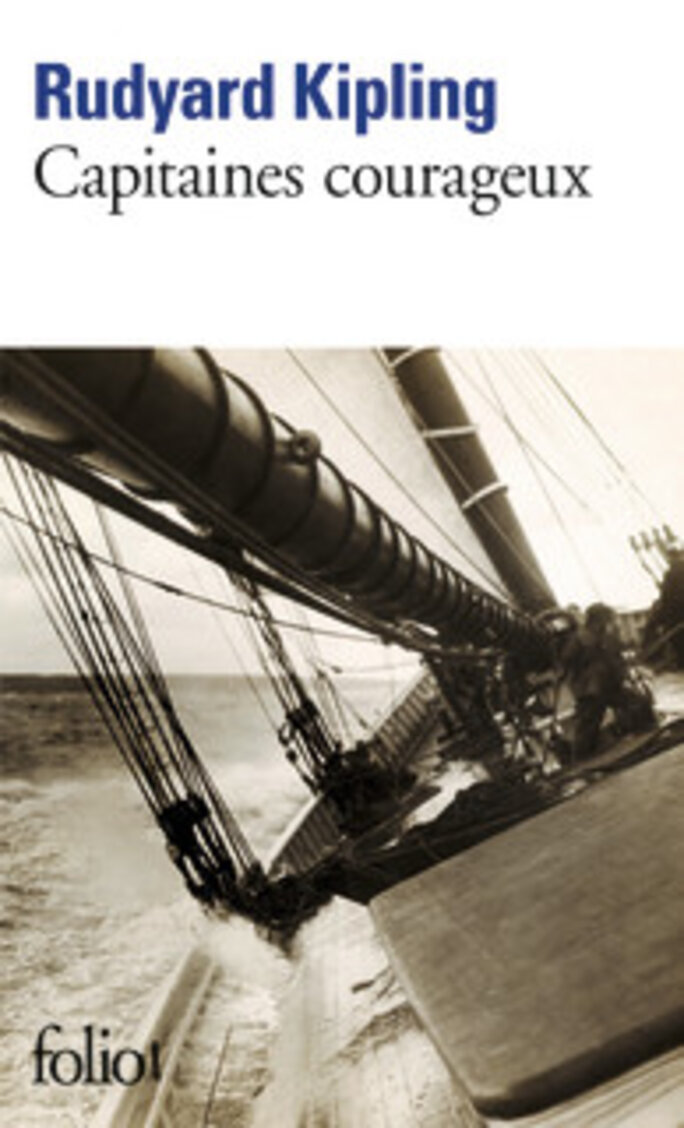
La saison de pêche dure plusieurs mois. Ni brimé, ni favorisé, Harvey est accepté par l’équipage. Mais l’apprentissage est rude: « Long Jack (un des matelots) avait le don de la clarté. Quand il voulait attirer l’attention de Harvey sur les drisses (un type de cordage), il incrustait ses phalanges dans la nuque du gamin et le forçait à fixer son regard l’espace d’une demi-minute… Il appuyait sur la différence qui existe entre l’avant et l’arrière en frottant le nez de Harvey sur une certaine longueur ».
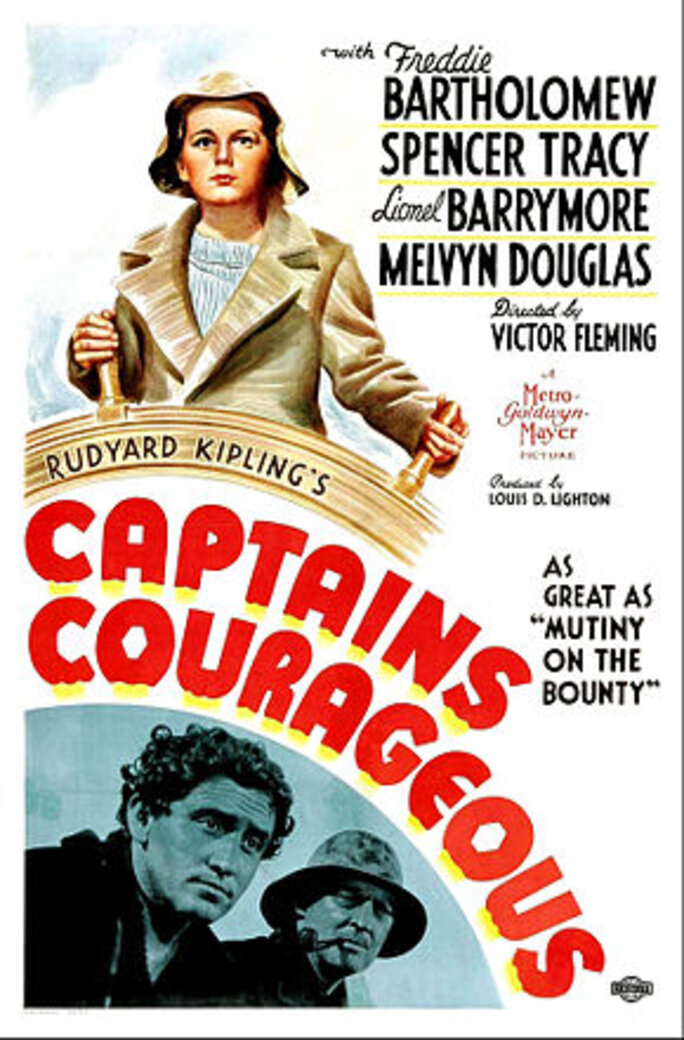
Le métier est dur : « Harvey avait les jointures à vif et en sang… Le visage bleu pourpre, moitié à cause de l’émotion, moitié à cause de l’effort, il dégouttait de sueur, et n’y voyait presque plus à force de fixer les rides éblouissantes de soleil à la surface de l’eau ». Harvey se construit dans l’épreuve: « Il sentait pour la première fois de sa vie qu’il faisait partie d’une équipe d’hommes au travail, en tirait de l’orgueil, et tenait bon d’un air sombre ». Il retrouve ensuite sa famille et l’estime de son père ému par le courage de son fils.
Rudyard Kipling confirme avec ce livre sa réputation de professeur d’énergie. Un des matelots de la goélette est franc-maçon. Il se dévoile devant notre héros en conversant avec des marins d’un navire français. Car remarque l’auteur : « Tous ces bateaux français sont bondés de francs-maçons ». Au-delà de ce clin d’œil anecdotique dans l’histoire, c’est l’ensemble du roman qu’il faut considérer comme un roman d’apprentissage voire initiatique.
La reconquête d’une vertu démocratique

Agrandissement : Illustration 7

La question du courage est éternelle. Plus d’un siècle après Stephen Crane et Rudyard Kipling, la philosophe Cynthia Fleury la scrute à son tour. Elle y consacre un livre bref et dense. Son titre est étonnant : « La fin du courage ». Il est éclairé par le sous-titre « La reconquête d’une vertu démocratique ». Cet essai a une dimension personnelle qui apparaît aussi bien dans la préface que dans le titre. Celle d’un effacement momentané de la vitalité et donc du courage. Cela reste en partie énigmatique pour le lecteur. Mais celui-ci pourra se livrer à une lecture fructueuse en picorant hardiment dans les riches réflexions ainsi offertes.
Etre courageux, c’est être soi-même. Et, bien sûr, être soi-même implique d’avoir le courage de s’affirmer. Montaigne l’a souligné avec fermeté : « De nos maladies, la plus sauvage c’est de mépriser notre être ». Et, de façon cohérente, d’estimer l’autre. C’est Victor Hugo qui l’écrit : « La haine, c’est l’hiver du cœur ». Le respect des autres et de soi-même... Cynthia Fleury est philosophiquement attachée à ce principe. Elle attire aussi notre attention : le courage a ses territoires. « On peut être courageux à la maison et couard au travail ». Etre courageux, c’est l’être en tout temps et en tout lieu. Mais ce n’est pas facile.
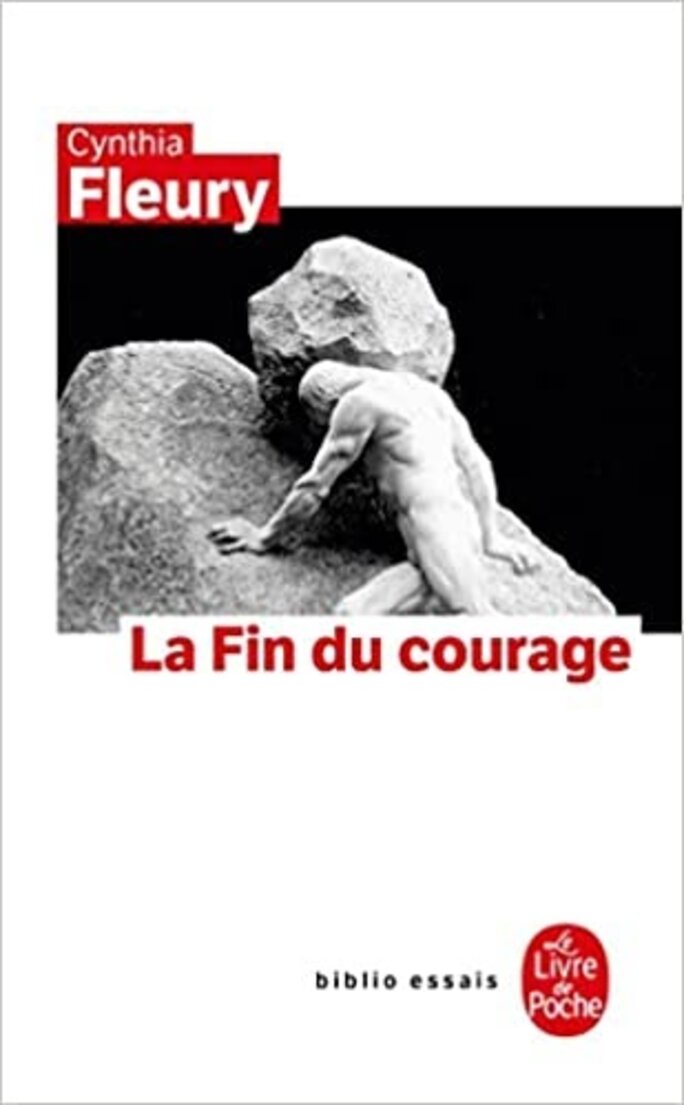
Le courage n’est pas l’absence de peur. « Ce serait pourtant plus simple : il suffirait pour être courageux de ne pas éprouver la peur, de l’occulter, de la nier, de l’enfouir. Mais voilà, nier la peur, lui refuser un droit de parole… c’est prendre le risque de chuter plus tard et de ne plus savoir pourquoi on a chuté. Alors vivre la peur devient la maxime du courage ». Ceci étant assumé, il nous faut également intégrer que le courage n’est pas seulement une construction solitaire. Les aventures de nos deux héros le montrent bien. Henry Fleming au milieu des autres soldats. Harvey Cheyne au milieu des autres matelots.

« Depuis Rousseau, Robespierre, Montesquieu, on sait que la vertu est constitutive de la République » écrit Cynthia Fleury. La vertu, héritière de la « virtù » romaine antique, est bien plus que la virilité masculine ou le courage individuel. C’est la capacité, la volonté, personnelle et collective d’accomplir de grandes choses. « Le profil du courageux est un profil souverain. Il s’agit bien de récupérer une maîtrise de soi, de s’imposer comme sujet souverain, sans pour autant pratiquer l’illusoire souveraineté sur les autres ». C’est cette vertu démocratique que Cynthia Fleury nous invite à reconquérir. Cette foi civique est une affirmation et une incitation à l’action illustrées par le célèbre proverbe romain : « Le courage augmente en osant et la peur en hésitant ».
___________________________

Les Cercles Condorcet sont affiliés à la Ligue de l'enseignement. Celle-ci anime une autre édition sur Médiapart: "Laïcité". Fondée en 2009 cette édition propose plus de 500 articles. Elle assure le suivi des événements, initiatives et publications liées à la laïcité au sens le plus large. Ne manquez pas de la visiter !



