Vous avez un parcours personnel remarquable au sein de l’ESS. Pouvez-vous nous le présenter ? Et préciser le sens de cet engagement personnel ?

Je ne suis pas tombé tout petit dans la marmite de l’ESS… C’est le produit un peu hasardeux de choix professionnels qui m’ont conduit à exercer des responsabilités dans le mouvement mutualiste, puis à creuser un sillon dans le champ plus large de l’ESS. En revanche, je reconnais un lien fort entre mes engagements dans l’ESS depuis une vingtaine d’années, et les engagements citoyens qui ont été les miens depuis près de 35 ans (depuis le syndicalisme étudiant jusqu’à l’engagement politique, que j’ai depuis mis un peu de côté). J’ai tenté de ne jamais dissocier mon envie de réaliser des choses socialement utiles dans mes activités professionnelles, de mes convictions de citoyen portées vers les causes progressistes et la justice sociale. Même si l’ESS peut parfois sembler un curieux oxymore aux oreilles des profanes, elle constitue selon moi un moyen pertinent pour concilier ces deux exigences.
Mes fonctions successives dans les univers mutualiste, coopératif et associatif, m’ont convaincu du formidable potentiel d’innovation de l’ESS pour appréhender les nécessaires mutations économiques, sociales et environnementales, à condition qu’elle sache penser et agir de façon un peu plus « macro ». Mais j’ai aussi pris conscience de sa place incontestable dans le contrat social français et dans la réalisation de la promesse républicaine.
Dans une société française tenaillée par un doute quasi existentiel et par des fractures multiples, nous avons besoin de formes d’engagement et d’entreprises qui nous réconcilient sur tous les plans : économique, social et démocratique. Dans un contexte international durement secoué ces deux dernières années par la crise sanitaire et ses conséquences économiques, puis par le retour de la guerre en Europe et sans doute l’avènement d’un nouvel ordre géopolitique, nous avons besoin de promouvoir une extension du champ démocratique, notamment à l’économie.
C’est le sens de l’appel que j’avais lancé aux forces de l’ESS en mai 2020, qui s’intitulait « Pour que les jours d’après soient les jours heureux ! », mais aussi du livre que j’ai souhaité publier pendant cette période électorale (« Pour une économie de la réconciliation – Faire de l’ESS la norme de l’économie de demain », Editions Les Petits Matins, mars 2022).
Dans son livre « L’Economie sociale et solidaire » (Editions Le Bord de l’Eau) Timothée Duverger n’évoque pas moins de 250 organisations à l’œuvre depuis 1968 ! Est-il possible de dresser un panorama à la fois concis et révélateur de l’ESS ?
Parler de l’ESS avec des chiffres n’est pas l’exercice le plus éclairant. On dit communément que, toutes formes et activités confondues, elle représente 14.9% de l'emploi privé, 22 millions de bénévoles, plus d’un million d'entreprises ou organisations en comptant toutes les associations, et même 10% du PIB si tant est que cette notion soit pertinente pour qualifier la valeur créée par l’ESS. Nous avons besoin de ces données pour nous faire comprendre, mais elles illustrent une grande diversité et surtout ne reposent pas nécessairement sur une revendication d’appartenance de la part de tous ceux qui y sont comptabilisés.
C’est sur ce point que nous avons engagé au sein d’ESS France un travail collectif pour définir et revendiquer nos « raisons d’agir », qui a débouché sur la proclamation à l’unanimité lors du « Congrès de l’ESS » le 10 décembre 2021 d’une déclaration d’engagement: "Pour une République sociale et solidaire : nos raisons d'agir". Celle-ci expose ce qui nous unit dans notre diversité, ce qui nous distingue du reste de l’économie, et ce qui nous permet de nous projeter dans la construction d’un monde meilleur.
Les nombreux travaux de Timothée Duverger sur l’ESS que vous évoquez renouvellent le genre, dans la lignée de grands chercheurs méconnus qui en ont exploré les nombreuses formes, les motivations et même les traditions philosophiques dont elles se réclament. Ces travaux permettent notamment de nous projeter désormais dans la perspective d’une ESS qui serait une actrice résolue de la transition écologique et du développement des territoires. Ce sont deux des « nouvelles frontières » de l’ESS.
La première occurrence des mots « économie sociale » remonte à 1773. On peut identifier des pratiques en relevant peut-être des siècles avant. Depuis quand existe-t-il une véritable politique de l’ESS menée par les pouvoirs publics ? En quoi consiste-t-elle aujourd’hui ?
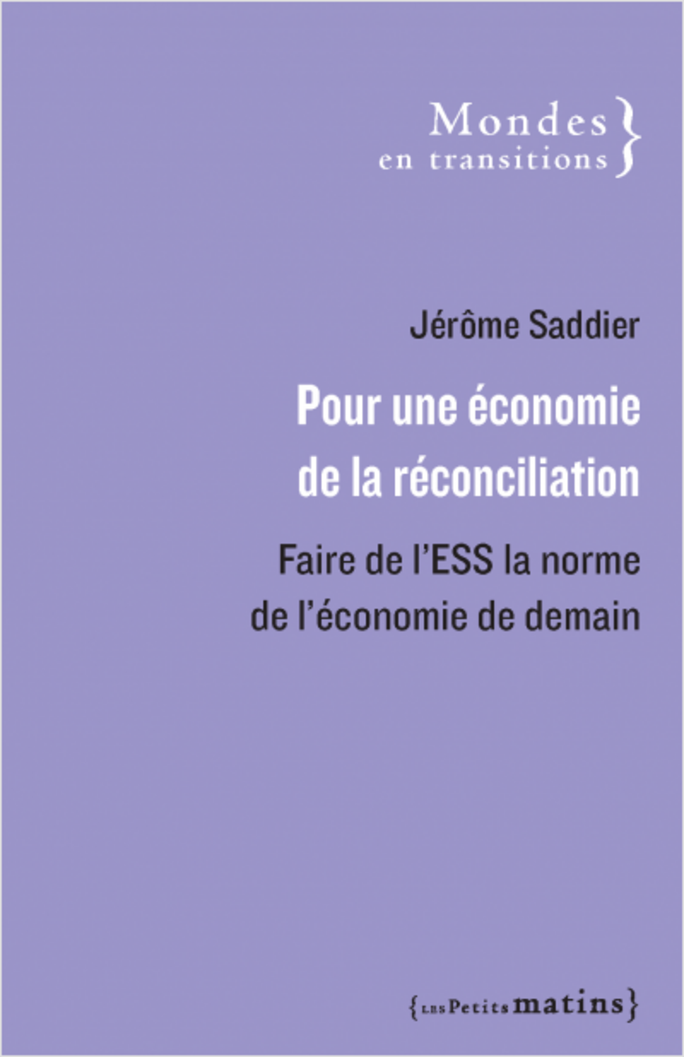
Agrandissement : Illustration 3
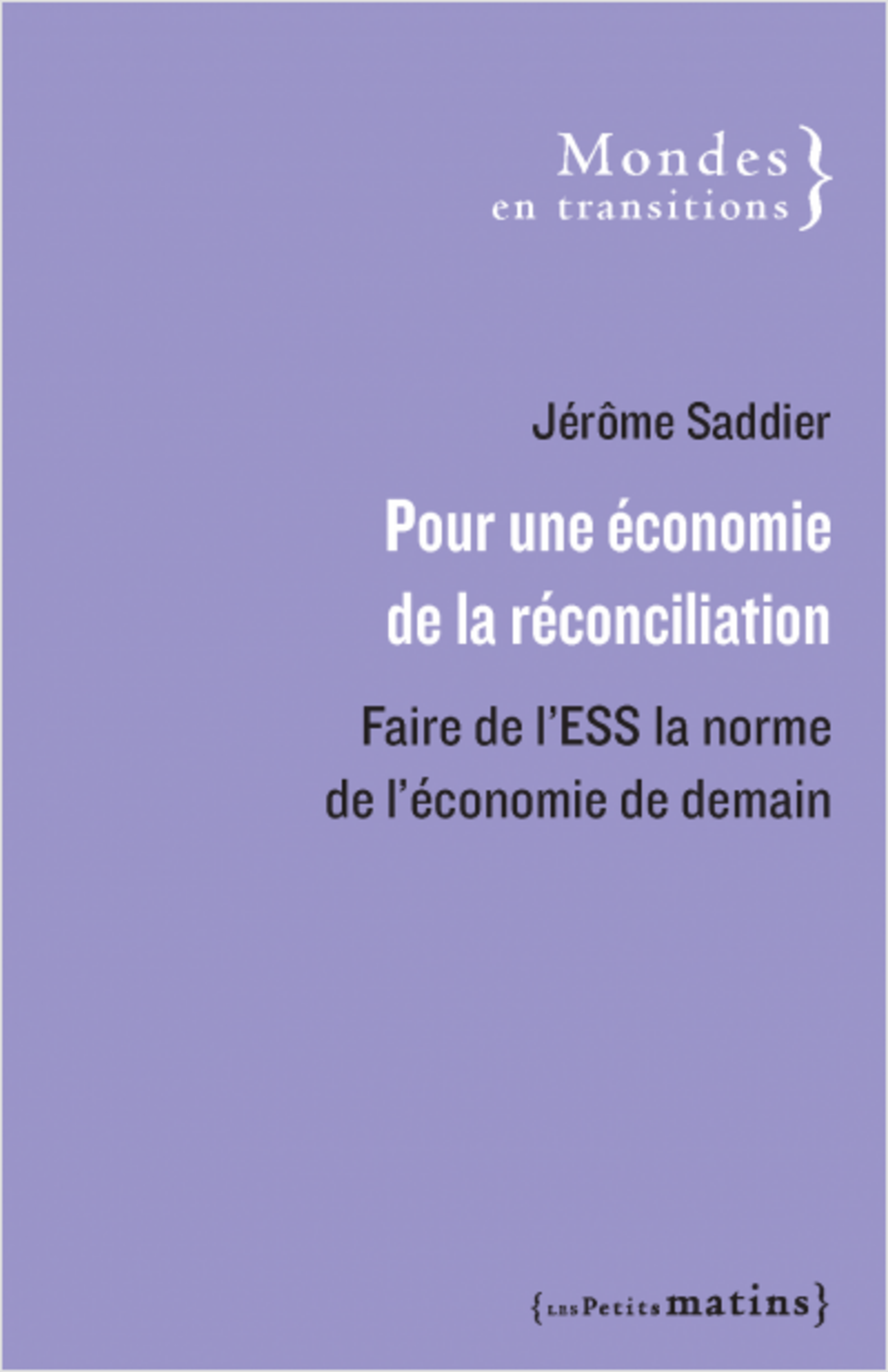
L’histoire sert à comprendre que l’ESS, sous les formes qui étaient les siennes au Moyen-Age, peut être demain la norme de l’économie. Sous des formes associatives et coopératives, parce que communautaires et liées à des systèmes de valeur puissants, elle a de fait précédé le capitalisme. Lorsque ce dernier a pris le pas, sous ses formes successives, elle n’a pas disparu mais elle a perdu sa puissance économique, symbolique et donc politique. La reconstitution de celle-ci est un long chemin. Dans notre contexte français, elle s’est avant tout illustrée, grâce à une liberté d’entreprendre collective, dans des activités bien connues et qui font partie de notre vie quotidienne puisque les mutuelles, les coopératives et les associations sont présentes dans bien des domaines de notre vie quotidienne.
Pour ce qui concerne les politiques publiques en revanche, le constat est moins linéaire. Il y a certes une œuvre législative avec les grandes lois sur la mutualité, la coopération et les associations, inspirées par la construction de la « République sociale ». Mais le terme « économie sociale », forgé notamment par l’économiste Charles Gide au début du vingtième siècle, était tombé dans l’oubli jusqu’à ce qu’il ressurgisse dans les sillons de la reconstruction de la gauche non-communiste des années 60 et 70. Il permettait de désigner une alternative aussi bien au « tout marché » qu’au « tout public », et un large mouvement pouvant contribuer à un combat culturel et politique.
Sa reconnaissance d’ensemble (à la fois comme réalité économique et sociale, et comme sujet de politiques publiques), est néanmoins fragile à l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981. C’est Michel Rocard qui en revendique la compétence dans un moment politique qui est a contrario marqué par les nationalisations. Mais c’est en 1983 qu’est nommé pour la première fois, en la personne de Jean Gatel, un secrétaire d’Etat à l’économie sociale, et c’est de cette première époque que datent les premiers instruments de politique publique sous la forme de statuts juridiques et d’instruments financiers dédiés ; la délégation interministérielle à l’économie sociale est alors un ferment majeur de beaucoup de ce qui sera entrepris pendant des années (et même à certains égards une école de formation pour des cadres bien connus de l’ESS). Plus tard, sous le gouvernement Jospin, un secrétaire d’Etat à l’économie solidaire (Guy Hascoët), incarne une dimension plus territoriale des enjeux de cette économie, et c’est sous son égide que nait un nouveau statut très prometteur pour le développement de l’ESS : la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
La période la plus récente consacre deux moments.
Le premier, avec la nomination sous la présidence de François Hollande d’un ministre délégué, Benoit Hamon, positionné à Bercy comme le souhaitaient les acteurs de l’ESS qui souhaitaient voir reconnue leur dimension économique et entrepreneuriale. La loi du 31 juillet 2014, qui porte son nom, est inédite au sens où son ambition est large : définir juridiquement l’ESS par-delà les statuts existants ; reconnaître et soutenir un écosystème de représentation ; donner quelques définitions juridiques et outils stratégiques pour son développement ; et plus généralement en faire un axe déterminant pour la résilience de notre économie alors convalescente après la crise financière de la fin des années 2000. Cette loi est assurément refondatrice, même si elle est marginalement critiquée pour son ouverture aux « sociétés commerciales de l’ESS », qui sont censées appliquer les principes communs de l’ESS en dépit de leur statut relevant du code de commerce et non des statuts historiques.
Le second moment – du moins j’espère qu’il sera durablement considéré comme tel en dépit de son absence de représentation symbolique, résulte des circonstances malheureuses de la crise économique née de la pandémie de Covid, gérées par un Haut-commissaire à l’ESS (Christophe Itier) puis par une Secrétaire d’Etat à l’économie sociale, solidaire et responsable (Olivia Grégoire). Même s’il a fallu batailler avec les administrations (et peut-être le faudra-t-il encore) pour permettre aux entreprises de l’ESS de bénéficier des dispositifs de secours aux entreprises de droit commun, leur intégration pourrait permettre, pour la première fois, d’instaurer cette reconnaissance de la diversité entrepreneuriale dans la production normative et les réflexes administratifs, mais rien n’est encore acquis… Au-delà, cette dernière période est celle de l’amplification des outils financiers dédiés à l’ESS (notamment par le renforcement du fléchage de l’épargne solidaire et le développement des contrats à impact) et de la relance de la dynamique des pôles territoriaux de coopération économique.
La présidence française semble vouloir jouer un rôle important pour la reconnaissance et le développement de l’ESS dans l'Union européenne. Un grand évènement est même prévu à Strasbourg en mai (« L’économie sociale, le futur de l’Europe ») avec des acteurs venus de tous les Etats membres, des ministres et des commissaires européens. Pouvez-vous nous expliquer quelle reconnaissance cet évènement donne à l’ESS ? Que pouvons-nous en espérer ?
Le gouvernement français a joué un rôle actif pour appuyer les efforts du Commissaire européen en charge de l’économie sociale (ce qui est une première) Nicolas Schmit, pour élaborer un plan d’action européen en faveur de l’économie sociale. La présentation de celui-ci en décembre 2021 est un aboutissement heureux, qui consacre aussi les acteurs européens de l’ESS fédérés au sein de Social Economy Europe. Ce plan comporte de nombreuses ambitions pour reconnaître et développer l’ESS dans tous les Etats membres, bien que partant de situations nationales très disparates tant en ce qui concerne les réalités juridiques qu’économiques. Le rôle de la présidence française est actuellement déterminant (mais peut-être un peu ingrat) pour transformer les axes de ce plan en recommandations du Conseil européen à destination de la Commission. Nous pouvons en tout cas compter sur le soutien fort du Parlement européen, et sur la future présidence espagnole au second semestre 2023 qui pourrait finaliser ces recommandations.
L’enjeu principal pour l’ESS française est de faire reconnaître l’existence de la diversité entrepreneuriale dans le droit européen alors qu’aujourd’hui seuls certains types de coopératives sont considérées comme des alternatives aux sociétés commerciales. De même, la non-lucrativité y est définie de manière très restrictive, excluant de fait tous les acteurs ayant des activités de marché tout en s’appuyant sur les formes non-lucratives définies en droit français. Cette situation est préjudiciable pour l’ESS en France et dans quelques pays où elle rivalise avec les acteurs lucratifs. Sur une échelle plus générale, l’action de la Commission est attendue pour mettre en œuvre des programmes pour développer l’ESS dans tous les Etats-membres, avec des outils juridiques et financiers, mais aussi pour favoriser l’émergence ou le développement d’écosystèmes nationaux, et enfin pour faire de l’ESS une actrice déterminante des grands plans de transition écologique et sociale qui ont été engagés.
Enfin, les travaux en cours sur l’avenir de l’Union constituent une opportunité pour l’ESS de contribuer au « réenchantement » d’une Europe qui a fortement dérivé dans une voie libérale et technocratique. Dans le projet communautaire initial, « l’économie sociale de marché » était un principe identitaire car incarnant une voie médiane et progressiste entre les deux blocs de la guerre froide. A l’heure de bouleversements géopolitiques majeurs, l’Union doit se refonder en se donnant une nouvelle identité, plus régulatrice, plus écologique et sociale, plus souveraine sans doute. Le « haut degré de qualité démocratique » inhérent au projet initial doit demeurer le moteur stratégique de l’Europe. Nos organisations de la société civile doivent y contribuer fortement.
Jérôme Saddier, Président d'ESS France: Affirmer la portée européenne et internationale de l'ESS:
_________________________________

Agrandissement : Illustration 6

Les Cercles Condorcet sont affiliés à la Ligue de l'enseignement. Celle-ci anime une autre édition sur Médiapart: "Laïcité". Fondée en 2009 cette édition propose plus de 500 articles. Elle assure le suivi des événements, initiatives et publications liées à la laïcité au sens le plus large. Ne manquez pas de la visiter !



