L'avocat Jean-Bernard Geoffroy et l'historien Louis-Georges Tin reviennent sur un jugement du tribunal correctionnel d'Arras, passée inaperçue, qui reconnaît la légitimité de se promener dans des lieux publics pour y chercher un partenaire sexuel, fût-il du même sexe.
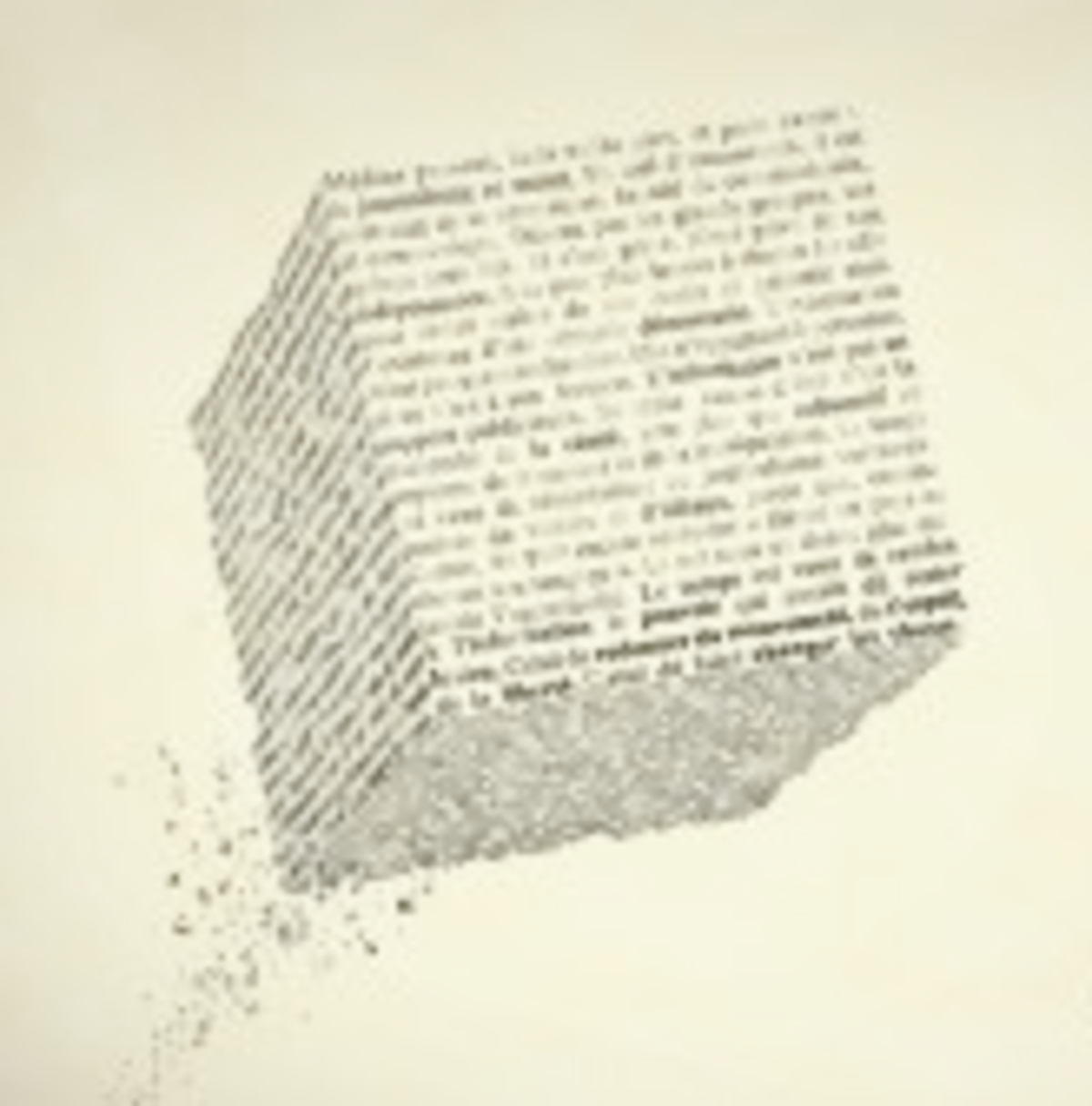
Il faut en prendre toute la mesure. Le jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Arras le 24 octobre, constitue, l’air de rien, une petite révolution symbolique en matière de sexualité. Mais revenons aux faits…
Le 16 janvier 2000, un homme se trouvait sur un lieu de drague, le long de l’A26, afin de nouer des relations sexuelles avec d’autres hommes. Mais il fut agressé par un individu, et reçut en pleine tête un projectile, une balle d’acier, tirée par une arme à feu. La victime, qui fut transportée à l’hôpital, et ne dut son salut qu’à une intervention neurochirurgicale fort délicate, et aujourd’hui encore, présente des troubles du langage dans certaines situations de fatigue ou de contrariété et des difficultés psychologiques.
L’auteur des faits fut arrêté, reconnu coupable et condamné à une peine de deux années de prison, dont 18 mois avec sursis. La condamnation était très légère, on en conviendra. Il est vrai qu’à cette époque, la loi aggravant les peines pour les agressions homophobes n’avait pas encore été votée. Le même jugement ordonnait une expertise médicale, dont le rapport fut déposé quelques années plus tard. L’expert nota un certain nombre de préjudices corporels, tout en constatant en outre que la victime continuait à souffrir d’angoisse.
Outre les dommages et intérêts ordinaires qui lui furent accordés en effet, la partie civile sollicita la prise en compte de son « préjudice d’agrément », qui n’avait pas été évoquée par l’expert. En droit français, cette formule désigne entre autres « une atteinte à la qualité de vie et aux joies de l’existence », et permet une indemnisation à ce titre si nécessaire. Or, la victime n’osait plus se promener seule, et se rendre sur ces lieux de drague qu’elle fréquentait jusqu’alors. Dès lors, le tribunal reconnut le bien fondé de la demande concernant le « préjudice d’agrément ». Il affirma qu’il ne pouvait être « sérieusement contesté que la victime a dû renoncer à se rendre seule dans ces lieux de rencontre, ce qu’il pratiquait avant son agression », et alloua une somme de 2.000 euros au plaignant à ce titre.
Cette décision mérite que l’on s’y arrête. Pour l’histoire de la sexualité, elle constitue sans doute un tournant symbolique. Pour mieux saisir l’enjeu de cette décision, il faut avoir à l’esprit les conditions dans lesquelles s’effectuaient, jusqu’à un passé récent, les rencontres sexuelles entre hommes. Elles ne pouvaient qu’avoir lieu dans des lieux de drague ouverts, jardins publics, terrains vagues, bois, plages isolées, ou aires d’autoroute (comme c’était le cas ici). Mais il s’agissait évidemment de lieux dangereux, où l’on était exposé à la fois aux loubards homophobes et à certains policiers, qui pouvaient l’être tout autant.
Dès lors, certains homosexuels choisissaient plutôt des lieux couverts, comme les bars, les dancings ou les boîtes de nuit. Or ces lieux, outre le fait qu’ils soient plus coûteux, s’avéraient souvent tout aussi dangereux. Les voyous savaient où trouver leurs victimes, les attendaient à la sortie, les suivaient, et les agressaient un peu plus loin, sachant bien qu’elles n’oseraient guère porter plainte auprès de la police, par peur du scandale. Par ailleurs, comme les voyous, la police elle-même savait où trouver les « pervers », et multipliait les « descentes » dans les boîtes de nuit, y compris dans les pays, comme la France, où l’homosexualité n’était plus pénalisée. C’est dans des boîtes de nuit qu’eurent lieu les rafles homophobes qui firent tant de bruit dans le monde entier : Stonewall, en 1969, le Queen Boat, en Egypte, en 2001, ou encore plus récemment, au Cameroun, en 2005. Enfin, dans de nombreux pays, aux Etats-Unis hier, en Inde aujourd’hui, et ailleurs encore, les policiers comme les voyous faisaient chanter les victimes qu’ils trouvaient si aisément dans les night-clubs.
Bref, qu’ils fréquentent les lieux ouverts, ou qu’ils choisissent les lieux couverts, les homosexuels se voyaient exposés aux agressions des voyous, aux brutalités policières, au chantage, à la prison, à la relégation, à la mort sociale, et parfois, acculés au suicide. L’historien Pierre Albertini a fait l’histoire de ces « scandales », et il donne quelques exemples de personnalités dont la vie fut brisée, parce qu’elles furent trouvées dans des lieux de drague homosexuelle : le comte de Germiny, arrêté dans une vespasienne en 1876, l’acteur britannique John Gielgud, arrêté pour « cottaging » en 1953, le ministre Ian Harvey, chassé du Cabinet pour avoir été trouvé avec un horse-guard dans Saint James’ Park en 1958, Ron David, surpris sur une aire de drague, obligé de quitter le gouvernement de Tony Blair en 1998, etc. La liste est longue.
Au-delà de ces cas éclatants, la crainte du scandale a formé la conscience des homosexuels de tous milieux pendant des décennies. Beaucoup continuaient à fréquenter les lieux publics, tout en sachant les risques qu’ils encouraient. Mais s’ils refusaient ce risque, il fallait accepter la misère, la frustration sexuelle, la solitude aussi...
Pendant longtemps, on reprocha aux homosexuels de fréquenter ces lieux (que diable allaient-ils faire à cette galère ?), en refusant de comprendre les conditions sociales qui leur étaient faites. Le jugement rendu tout récemment par le tribunal d’Arras constitue en ce sens une rupture symbolique : la justice française reconnaît qu’il n’est pas illégitime de se promener dans des lieux publics pour y chercher un partenaire sexuel, fût-il du même sexe. Ce qui était en soi un scandale est désormais reconnu. Et en ce sens, ne plus pouvoir se rendre sur un lieu de drague constitue bel et bien un « préjudice d’agrément ». Les personnes qui seront demain victimes d’agressions de ce genre pourront s’en prévaloir.
A l’heure où la Cour de cassation autorise les propos homophobes de M. Vanneste, qui avait affirmé que « l’homosexualité est moralement inférieure » (dès lors, si l’on suivait ce raisonnement, et si l’on renonçait au respect de la dignité de la Cour, aurait-on désormais le droit de lui dire qu’en rendant une telle décision, elle s’est montrée « moralement inférieure » ?), il importe de saluer ce jugement qui constitue heureusement un pas supplémentaire vers la reconnaissance non pas seulement de l’homosexualité, mais de la sexualité elle-même.
________
* Jean-Bernard Geoffroy, avocat de la victime, président du Réseau d'aide aux victimes d'agression et de discrimination (RAVAD) ; Louis-Georges Tin, historien de la sexualité, président du Comité IDAHO (International Day Against Homophobia).



