«La question sociale a longtemps mis en selle la social-démocratie. La question de la nature met aujourd'hui en scène les écologistes», estime Jean-Paul Besset, membre fondateur d'Europe Ecologie, rassemblement de mouvements écologistes en vue notamment des élections européennes de 2009. Et «si les astres électoraux sont favorables», au delà: «élargissement ou refondation d'un parti de l'écologie politique, mouvement populaire et citoyen, parti-mouvement, “écologisation” des grands partis ?»
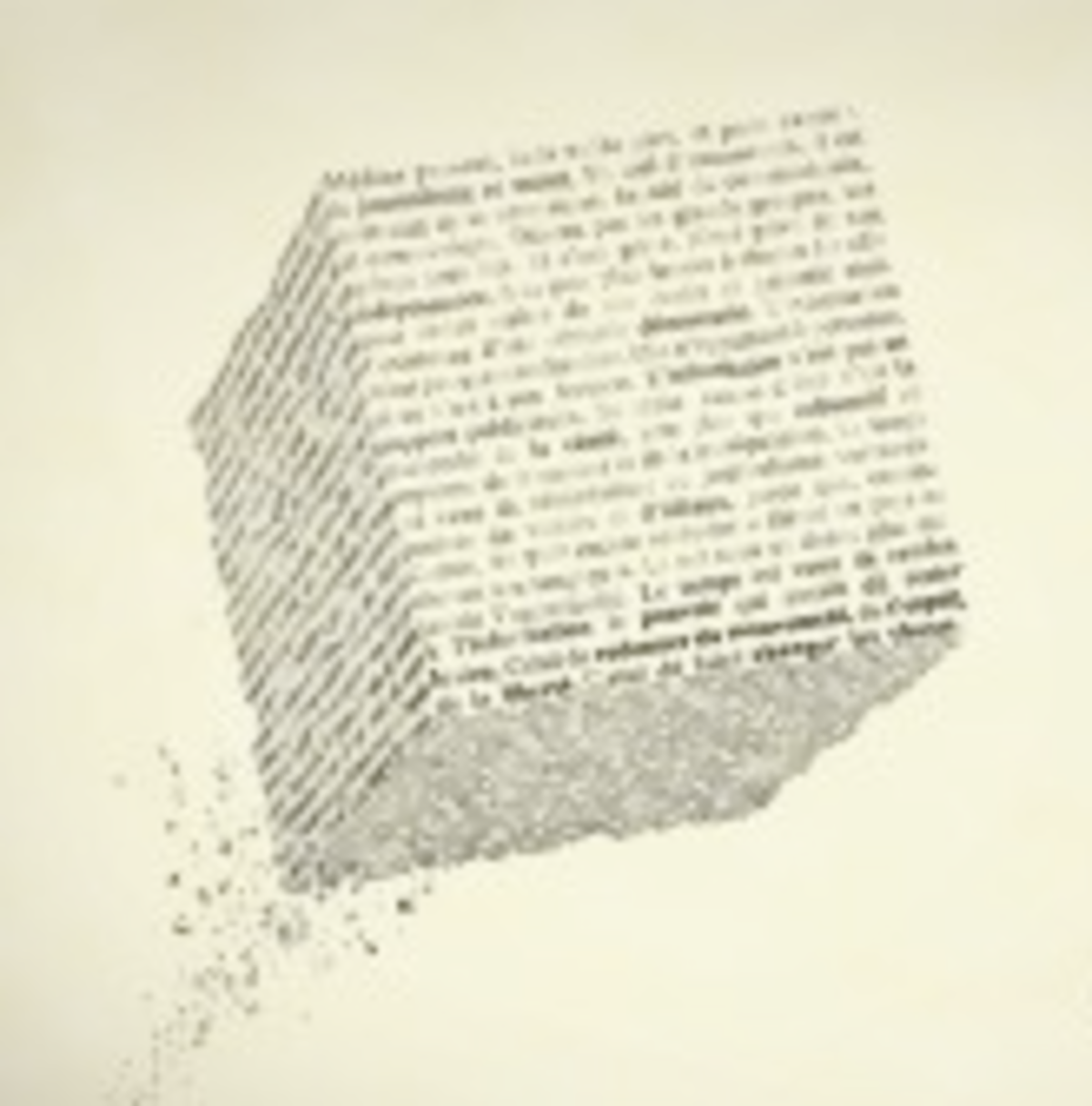
En apparence, la différence est flagrante: d'un coté on voit un Parti socialiste qui se déchire à belles dents, de l'autre on assiste à un rassemblement des écologistes qui additionnent leurs différences pour engager une dynamique politique. Surprenant paradoxe! Le parti de gouvernement est saisi de frénésie suicidaire tandis que les trublions imprévisibles et passablement narcissiques font assaut de raison et de responsabilité (jusqu'au parti des Verts, partie prenante et convaincue de ce rassemblement, qui devrait afficher un visage apaisé et uni à son congrès... C'est dire!).
Donc, au moment où les socialistes entretiennent ad nauseam leurs plaies, exacerbant leurs différenciations internes (sur des questions aussi décisives que le niveau de cotisation), les écologistes travaillent à dresser des passerelles en direction de la société au sein de leur nouveau mouvement, Europe Ecologie. Deux attitudes différentes, deux signaux divergents.
Contraste d'image, affaire de circonstances, que des événements aléatoires et imprévisibles — surtout en politique — se chargeront vite de modifier? Peut être que non cette fois. Car, de notre point de vue, il y a une explication de fond à ce double mouvement sur les formes; la forme qui n'est souvent que le fond qui remonte.
Si les socialistes sont aspirés dans un tunnel sans issue, où la détestation et les rivalités tiennent lieu désormais d'identité, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à dire sur les enjeux de l'époque. Depuis deux siècles, cahin-caha, le projet social démocrate a accompagné le progrès de l'humanité. Aujourd'hui, il est mort. Confronté à l'ébranlement colossal et inédit que la conjonction des crises actuelles annonce, il se découvre pétrifié. On peut le comprendre. Voici qu'en quelques courtes années nous passons sans transition du temps de l'abondance garantie, celui de la croissance, du développement et du progrès infini, à celui de la rareté des ressources élémentaires, de la rupture des équilibres naturels et de l'extension de la précarité sociale. Et voila que la question de la répartition des richesses produites — question identitaire du socialisme — se trouve devoir être réexaminée à l'aune de nouveaux critères, dont la sobriété n'est pas le moindre.
La trajectoire rectiligne de l'insouciance progressiste vient soudainement se briser sur l'imaginaire de la catastrophe planétaire. Tout s'en trouve bouleversé, complexifié, indémêlable: la question sociale, l'organisation économique, la destination des biens et services, le type de consommation, l'aménagement du territoire, les modes de production, de déplacement et de vie, la fiscalité, le rôle des sciences, la place des technologies, le rapport à la nature, l'échelle des valeurs... Confrontée à ces défis, la «foi» sociale démocrate s'effondre car ce sur quoi elle reposait, son programme, sa stratégie, son identité, est désintégré. Dans ces conditions, que peut-il rester d'autre que le vase clos des petites ambitions, des passions claniques, du ressentiment généralisé?
On dit souvent que si la gauche est malade, c'est parce qu'elle ne sait plus marquer ses différences avec la droite. C'est souvent inexact quand on regarde dans les détails mais le tableau général, lui, est bien celui là. Sauf que ce n'est pas pour les raisons qu'on invoque traditionnellement, conversion au libéralisme ou à la raison d'Etat. L'essentiel de la convergence est ailleurs. La gauche comme la droite appartiennent au même arbre historique de la révolution industrielle, elles fonctionnent selon une même représentation développementiste du monde, elles s'enracinent dans la même matrice d'une croissance à tout va. Elles partagent la même croyance illusoire en l'illimité de la destinée humaine.
En revanche, les écologistes sont en prise avec le changement de cycle de l'histoire dont nous sommes des témoins de hasard, et ils ne cachent rien de sa réalité potentiellement tragique. On les a caricaturés en bouffeurs de carottes ou besogneux de la bicyclette. C'est vrai qu'en général, ils n'ont rien montré d'exceptionnel sur le champ politique tout en agissant efficacement localement. Mais leurs discours, leurs alertes, leur représentation du monde se trouvent aujourd'hui validées par les faits et confortées par les observations scientifiques dans toutes les disciplines. Leurs propositions alternatives pour éviter l'effondrement et engager les sociétés dans une grande mutation écologique, un «new green deal», ouvrant sur une autre politique de civilisation, sont argumentées, chiffrées, expérimentées, cohérentes. Leur faisabilité est manifeste. C'est ainsi par exemple que le modeste Grenelle de l'environnement (qu'ils ont initié) n'a dû son succès qu'à la reprise d'une partie significative de leurs expertises et de leurs orientations. Depuis trente ans, ces huluberlus d'écolos ont (hélas) raison, ils savent que la fête est finie et qu'il faut en tirer les conséquences jusqu'au bout afin que la vie puisse continuer, peut-être mieux.
La question sociale a longtemps mis en selle la social-démocratie. La question de la nature, dont la question sociale est désormais subséquente, met aujourd'hui en scène les écologistes.
Alors, parce qu'ils croient en ce qu'ils disent et que, soudain, le décalage entre la minceur de l'offre politique qu'ils véhiculent et l'écrasante responsabilité qui leur échoit leur est apparu, les représentants de la galaxie écologique ont décidé de se rassembler. En s'appliquant enfin à eux mêmes le «principe responsabilité» qu'ils exigent de l'ensemble de la société. En surmontant les humeurs des chapelles et les prurits du huis clos. En dépassant le confort des bandes. En unissant leurs cultures et leurs itinéraires.
Pour aller où? A l'occasion des élections européennes de juin 2009, le rassemblement Europe Ecologie veut offrir une traduction politique à la prise de conscience de plus en plus vive de la société. Encore faut-il que ce mouvement sache rendre son projet à la fois réaliste et désirable, qu'il s'adresse positivement à la société sans succomber aux surenchères tribuniciennes, qu'il mobilise autour de lui les forces vives du terrain. Au delà du succès électoral espéré, une fois renforcé le pôle écologique au Parlement européen, là où l'essentiel des choix se jouera de plus en plus, jusqu'où la dynamique de rassemblement pourra-t-elle continuer? Si les astres électoraux s'avèrent favorables à ses listes, alors nul doute que les lignes devront encore bouger. Elargissement ou refondation d'un parti de l'écologie politique, mouvement populaire et citoyen, parti-mouvement, «écologisation» des grands partis ? Le chemin sera ce que les marcheurs en décideront.



