Christian Terras est directeur de la revue Golias*.
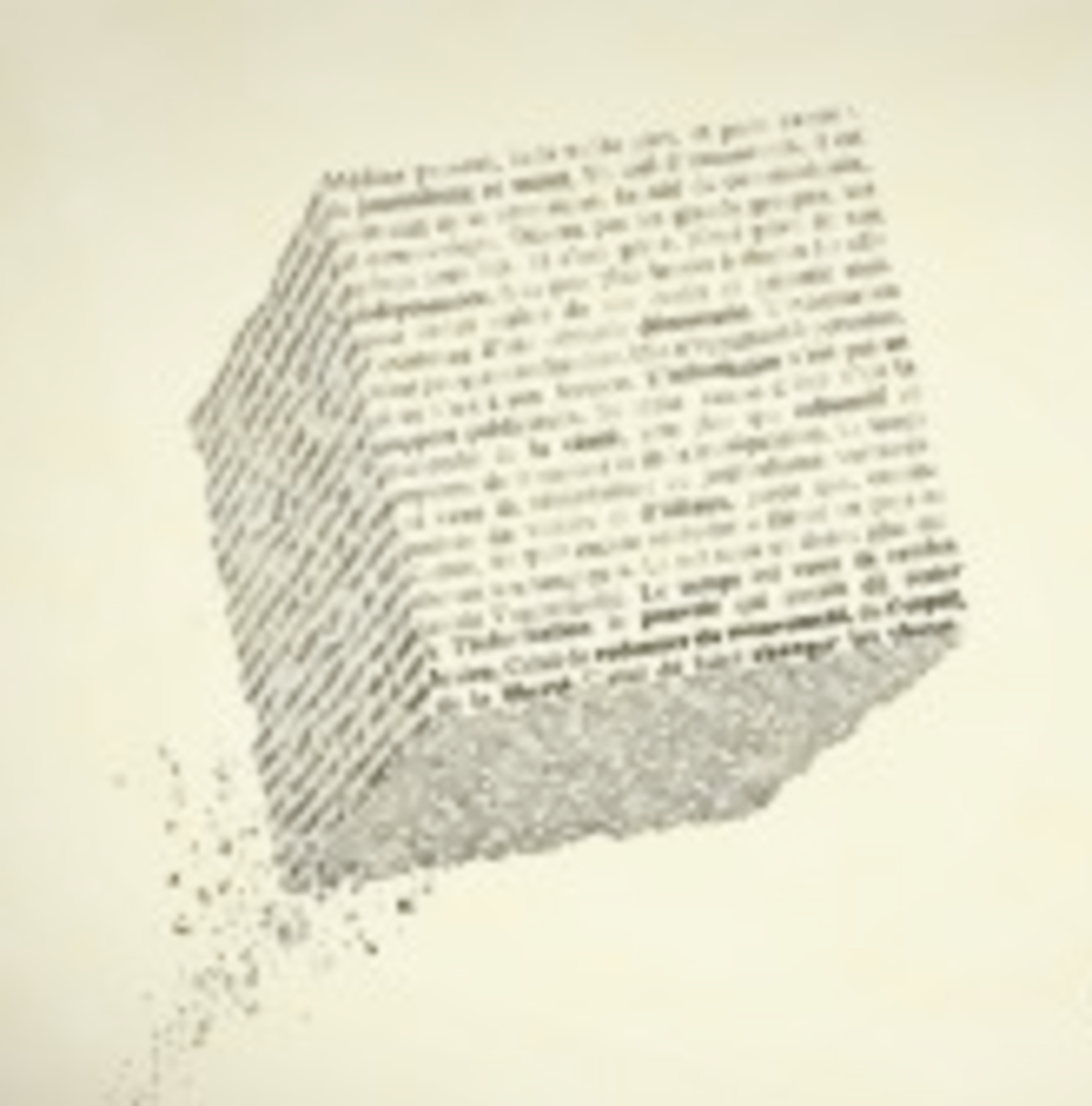
Beaucoup de chrétiens, parmi lesquels Golias a la chance de se compter, entendent entrer en résistance contre les orientations intransigeantes et rétrogrades de l'actuel pontificat.
Il ne s'agit pas, dans notre esprit, d'une sorte d'opposition systématique et indifférenciée, adolescente, qui chercherait à tuer le père, ou, pour parler comme Nietzsche, à faire disparaître le fantôme de Dieu qui, toujours, nous hanterait.
Cette résistance spirituelle s'impose comme un devoir et comme une conviction, en raison de ce qu'une analyse rationnelle nous permet de discerner, serait-ce en filigrane, de ce pontificat. En effet, il nous paraît clair que Joseph Ratzinger entend donner un véritable coup de barre, dans un sens réactionnaire, en opposition avec les intuitions et les intentions qui donnent tout son sens au concile Vatican II et sans lesquelles il serait lettre morte, corpus intellectuel dénué de sens.
Aussi nous estimons de notre droit de récuser certains choix philosophiques et théologiques de fond qui expriment le style propre de ce pontificat et lui donne d'une certaine façon, malgré tout, sa cohérence. Universitaire, Joseph Ratzinger n'a rien d'un moniteur de colonie et encore moins d'un garde-chiourme. Ce que nous nous permettons, en toute fraternité évangélique, de reprocher à Benoît XVI est d'un autre ordre. Ce dernier n'a donné suite à aucun des projets de réformes évoqués lors du conclave de 2005, lors même que, certes de façon progressive, il réalise peu à peu un programme de restauration, disciplinaire, morale, doctrinale et liturgique, qui tourne le dos aux audaces du concile et du post-concile. Nous ne pouvons ici dresser une sorte d'inventaire, d'autant plus qu'au réquisitoire devrait s'ajouter une plaidoirie. Nous nous permettons, uniquement à titre d'exemple, de relever un point: sa croisade contre le relativisme.
La cible intellectuelle première et favorite de Benoît XVI semble être le relativisme, que Joseph Ratzinger se garde d'ailleurs bien de définir de façon rigoureuse et circonstanciée, en établissant des distinctions entre par exemple ce que serait un «relativisme absolu» (pôle idéologique évidemment impossible et contradictoire dans la mesure où il se nierait en quelque sorte lui-même, comme le scepticisme absolu) et un sens de la relativité et de l'historicité qui n'a évidemment rien à voir avec un pirandellien (du grand dramaturge italien Pirandello) «tout est relatif». Un certain sens du relatif permet justement d’honorer... l'absolu lui-même en refusant de l'identifier à l'une de ses représentations historiquement située.
Au fil d'un certain nombre d'interventions, le pape saisit nombre d’occasions de dénoncer le cynisme actuel, lié bien sûr – selon lui – au relativisme, et qui ne saurait aboutir, toujours selon le souverain pontife, qu'au nihilisme et à la destruction de l'humanité.
Le pape ne semble pas accepter que l'humanité puisse avoir d'autres ressources de survie et de progrès que la référence docile et soumise à une transcendance, considérée parfois avec une certaine étroitesse. Ainsi, lors de sa visite en Allemagne, sa patrie d'origine, Benoît XVI n'a pas hésité à fustiger en termes très durs l'occident laïc qui, en excluant Dieu, fait perdre aux hommes leur identité. L'esprit des lumières, évidemment présenté de façon caricaturale, voilà l'ennemi.
A l'évidence, cette insistance constante du pape contre le relativisme est l'expression de sa structure mentale profonde, en fait binaire et d'empreinte néoplatonicienne avec une tendance persistante et insurmontée à opposer le monde d'en haut avec celui d'ici-bas, l'absolu et le relatif, l'éternel et l'éphémère. Or, la singularité de l'expérience chrétienne pourrait bien résider au contraire, ainsi que l'a somptueusement compris un grand théologien comme Karl Rahner, dans l'incarnation, autrement dit dans le fait que le monde d'en haut ne soit plus à chercher en fuyant ce monde-ci (c'est tout le sens de la fête liturgique de l'Ascension) mais en son cœur, dans le fait que l'absolu se donne et se communique justement au travers des formes relatives et toujours évolutives de son expression et de sa compréhension rationnelle, et non pas dans une sorte de fixité marmoréenne, dans le fait que l'éternel puisse se vivre dans le temps et dans l'histoire.Une perspective véritablement chrétienne, également mise en valeur en théologie par Marie-Dominique Chenu, à laquelle Joseph Ratzinger semble décidément sourd et de plus en plus. Il n'y a d'ailleurs pas de plus grand sourd que celui qui ne veut pas entendre !
Ce n'est pas le moindre des paradoxes : l'hyperorthodoxie dont Joseph Ratzinger se veut le champion n'est en fait... pas si orthodoxe que cela, puisqu'elle se constitue sur le fond de l'occultation de ce qui fait le christianisme dans sa nouveauté irréductible. En tout cas, on se laisse surprendre et étonner par l'absence d'une réflexion critique qui s'imposerait, de la part d'une intelligence aussi fameuse (de «fama», la réputation) que celle de Benoît XVI, sur le ressort de ses prises de position, pour le moins simpliste et discutable. Quelle carence de problématisation des arguments avancés et des critiques opposées !
On en reste souvent confondu. Si la théologie ne saurait renier sa vocation de confesser le mystère, de témoigner de la lumière qui l'habite, irréductible à un savoir humain, il est également de son mandat d'interroger les évidences, de les confronter au point de vue des autres, d'avancer dans l'intelligence de ce qui est proposé en contestant parfois le mode présent de compréhension. On a l'impression que par une étrange peur, que semble parfois trahir son regard, Joseph Ratzinger se dérobe à cette tâche pourtant si belle et exaltante, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer.
Cette attitude intellectuelle défensive est apparue, notamment, au sujet d'une polémique concernant la mise en garde de l'alors cardinal Ratzinger sur la saga Harry Potter. Le futur pape y dénonçait les influences négatives subtiles mais néanmoins, et peut-être justement pour cela, profondes, de cette série très populaire. Ce penchant à toujours mettre en garde contre des dangers éventuels, ce sentiment d'une menace permanente qui pèse sur l'intégrité de la foi et des mœurs est bien une marque de fabrique du pontificat actuel.
Des observateurs un peu superficiels ont cru pouvoir se réjouir du dialogue, de haut vol, entre Joseph Ratzinger et le philosophe Jürgen Habermas pour vanter l'ouverture intellectuelle du pape.
Or, ce qui oppose ces deux grands esprits est précisément ce qui sépare l'intransigeantisme, même avec le sourire, d'un esprit d'ouverture au pluralisme. Depuis Etienne de la Boétie, nous savons que les hommes se prêtent volontiers à la servitude volontaire, nous savons aussi qu'il n'y a peut-être rien de plus effrayant – relisons Fédor Dostoïevski –, pour l'homme que sa propre liberté. Est-ce une raison pour ne pas courir le risque ?
_______
* A l'occasion de la venue de Benoît XVI en France, du 12 au 15 septembre, la revue Golias publie un hors série (n° 121 bis, septembre-octobre 2008) intitulé «Benoît XVI en 12 leçons».



