Pour Patrick Bruneteaux, auteur du rapport « Pauvreté, précarité et formes d'exclusion à la Martinique »*, «ce que disent aujourd'hui beaucoup de personnes dans la rue [aux Antilles], c'est le pourrissement d'une situation dualiste entre des très riches et des très pauvres sur fond d'absence d'emploi»
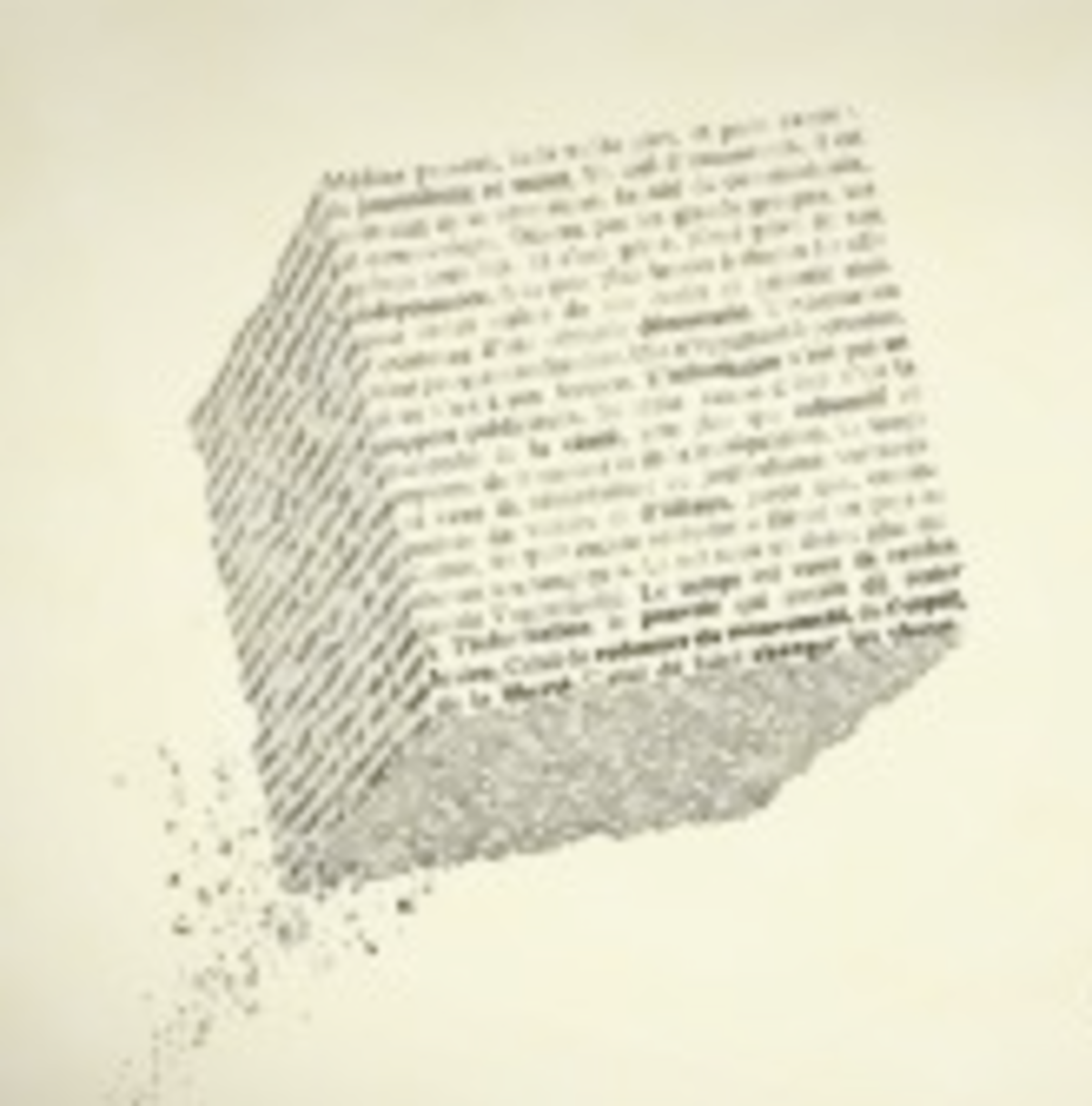
Pour comprendre la crise actuelle en Guadeloupe et à la Martinique, il est indispensable de dépasser un certain nombre de croyances binaires. Notamment celle qui, s'appuyant sur le remarquable reportage récent de Romain Bolzinger sur les colons créoles dits « Békés » et intitulé Les derniers maîtres de la Martinique, insiste sur le coût de la vie engendré par les marges bénéficiaires conséquences voire scandaleuses que s'octroie cette petite caste néo-coloniale dominant économiquement ces deux îles. Bien sûr, une centaine de grandes familles békés représentant 1% de la population générale détient presque la moitié des supermarchés, deux tiers des terres agricoles et presque tout l'agro-alimentaire ; ce qui induit une situation de quasi monopole sur toute la filière alimentaire. Cependant, s'en tenir à ce constat, c'est ne pas voir que l'ensemble de ces départements dits ultra-marins fonctionnent sur une logique néo-coloniale que la survivance de la caste raciste, phénomène unique dans le monde, ne fait que révéler de manière superficielle.
L'économie locale, tous les acteurs le savent, repose sur la mono-culture d'exportation de la banane, laquelle est largement subventionnée par l'Etat français et l'Europe. Du sucre de canne à la banane, la continuité d'un mode de production agricole s'affirme, avec pour effet une impossibilité d'assurer l'auto-subsistance alimentaire, laquelle ne couvre que 10 % des besoins. Cette dépendance économique à l'égard de la métropole, fondée sur la culture d'exportation issue de la plantation coloniale, structure tout le circuit économique qui repose sur les transferts publics de la métropole vers la « colonie ». La faiblesse structurelle de l'emploi dans un système économique sans industrie, la subsistance des personnes en fonction des revenus sociaux (outre les minima sociaux connus, comme le RMI, il existe des aides sociales spécifiques comme le revenu de solidarité issu de la loi d'orientation pour l'outre-mer de 2000, ou les contrats d'insertion par l'activité qui représentent une manne incontournable pour les chantiers d'insertion), l'existence d'un immense marché du travail de survie -travail au noir, sans jeu de mot, dit des jobs- sont caractéristiques d'une économie à deux vitesses : celle qui, d'une part, fonctionne en rapport avec cette économie de transferts dans laquelle la part la plus importante des ressources provient des salaires versés par l'Etat et les collectivités locales, lesquels sont consommés dans l'achat des produits chers importés et contrôlés largement par les dirigeants békés. Et si tous les cadres du secteur privé de la distribution, ceux de la fonction publique nationale métropolitaine, ceux de la fonction publique territoriale et aussi, les élus locaux, peuvent autant écouler ces produits chers, c'est qu'ils bénéficient tous de 40 % de salaires en plus. Celle qui, d'autre part, sans emploi régulier dans une économie assistée, chômeurs dont la part oscille du double au triple de la moyenne nationale (de 2001 à 2005, dans les DOM, la fourchette est de 21,8 % à la Martinique à 32,9 % à la Réunion), survivent par de faibles gains monétaires, des petits contrats et un grand sens de la débrouille (avec le jardin créole notamment). Cette survie précaire, malgré tout, rend difficile l'adaptation à cette économie monétaire marquée par un coût exorbitant des denrées alimentaires reposant sur les salaires mirobolants d'une classe moyenne du privé et surtout du public, désireuse de se faire oublier dans cette affaire. Autrement dit, tout se passe comme si l'ancien groupe des affranchis de la plantation, devenue la classe moyenne des mulâtres dans la période contemporaine jusqu'en 1940, aujourd'hui bourgeoisie et classe moyenne noires du privé et du public, continuait à être structurellement solidaire du système néo-colonial français, au delà des discours politiques de façade. Sur le plan politique, la notion de département français d'outre-mer cache totalement cette réalité économique et sociale issue de la période coloniale. Est-ce un hasard si les élus locaux martiniquais ont mis tant de temps (plus de 10 jours) avant de se déclarer solidaires des grévistes guadeloupéens ? Est-ce un hasard si, sur les deux îles, ce sont des leaders syndicalistes n'appartenant à aucune des formations politiques dominantes qui mènent tambour battant la lutte sociale ? Est-ce un hasard si on voit ces « responsables » politiques appeler à la modération ? Est-ce un hasard si ces mêmes cadres politiques, nourris aux 40 %, dans un système reconnu par tous comme clientéliste et même népotiste, donc manipulés par les Békés et l'Etat « métropolitain » qui achètent la paix sociale -enfin c'est ce qu'ils espéraient jusqu'à une date récente-, n'ont jamais protesté contre une vie chère dont ils sont épargnés des effets catastrophiques dans la vie quotidienne et à laquelle ils participent structurellement en bénéficiant eux aussi de ces fameux 40 % ?
Il ne s'agit donc pas de parler uniquement de la vie chère mais aussi d'analyser plus globalement un fonctionnement socio-économique global dont le reportage montrait bien les dessous politiques. Ce que disent aujourd'hui beaucoup de personnes dans la rue et, bien avant, tous les experts rencontrés depuis plusieurs années à la Martinique, c'est le pourrissement d'une situation dualiste entre des très riches et des très pauvres sur fond d'absence d'emploi. C'est l'opposition entre le sur-salariat de classes moyennes prises dans « le système » (comme on dit la bas) et les minima sociaux d'un sous-prolétariat assisté qui vient d'occuper la rue et qui commence à se couper des appels à la modération de leurs représentants ; lesquels ont perdu le message d'Aimé Césaire sur la colonisation et, de ce fait, perdent aussi de plus en plus leur légitimité auprès d'un peuple accablé reportant ses espoirs sur les nouveaux leaders syndicalistes qui émergent des collectifs LKP ou du 5 février. La dénonciation sociale actuelle de ce système, clairement posée un contexte de forte dénonciation des Békés qui prend l'aspect de barrages devant leurs centres commerciaux fermés de force, semble devoir pousser les élites politiques locales vers un nouveau positionnement politique.
* Ministère de l'Outre-mer, janvier 2007. Sous la responsabilité de Justin Daniel, Doyen de l'UAG



