La ministre de la santé, Roselyne Bachelot, organise, jeudi 23 avril, une table ronde sur les dangers potentiels des téléphones mobiles et des antennes-relais. «Cette question de l’implantation des antennes-relais est un cas d’école. Nous n’en serions pas là si une véritable concertation avait été engagée dès le départ», explique Bertrand Pancher, député UMP de la Meuse, président de l'association Décider ensemble et du Groupe d'études parlementaires sur la participation du public et la gouvernance.
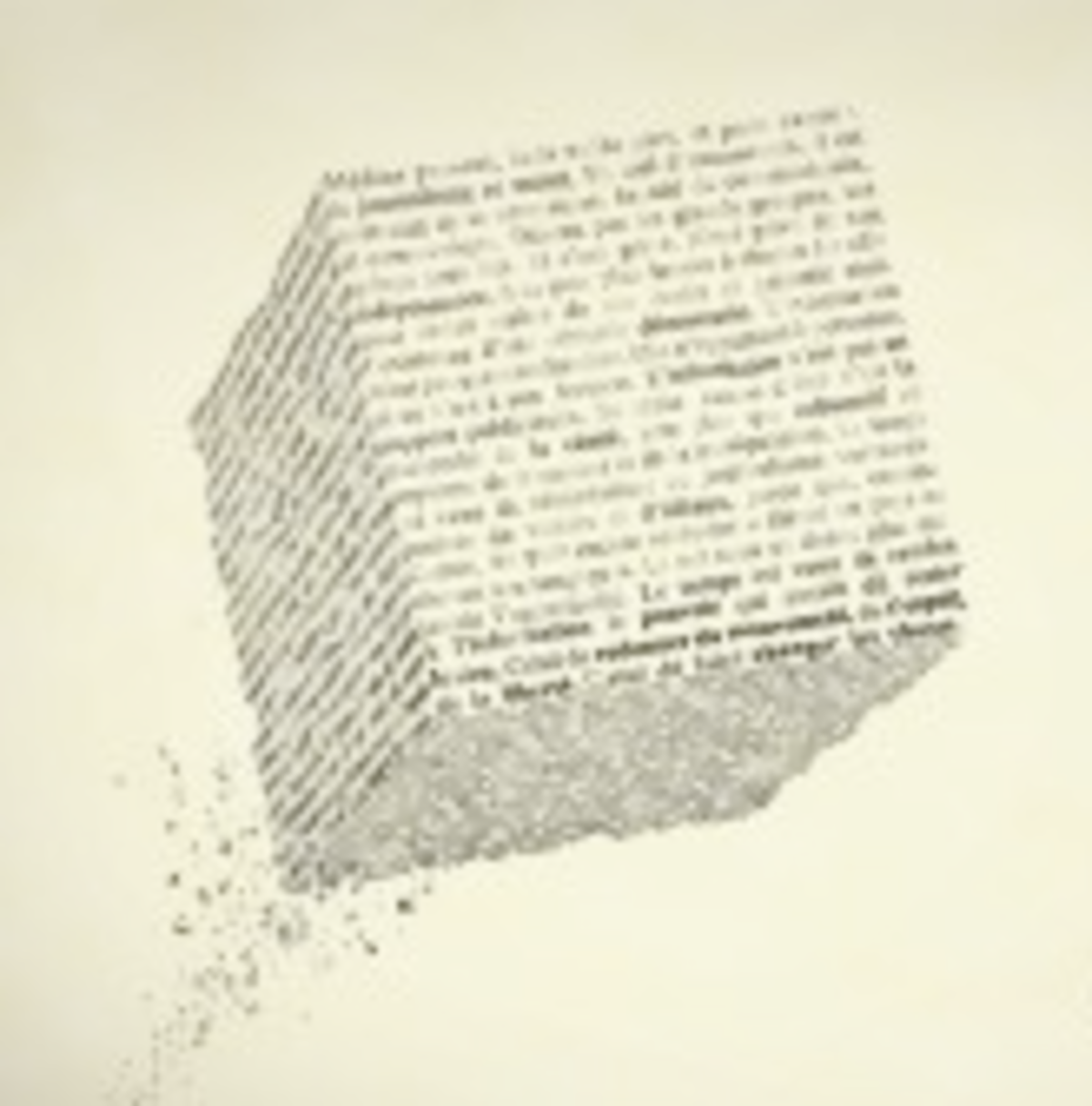
La question des antennes-relais est aujourd’hui au cœur de l’actualité. En l’espace d’un mois — du 4 février au 5 mars 2009 — trois jugements ont condamné les trois opérateurs français à démonter leurs antennes-relais ou à interdire leur installation. Les tribunaux se sont fondés sur la notion de « trouble anormal à voisinage » et, de fait, ont donc accepté les arguments des parties plaignantes, à savoir, l’idée d’un « risque potentiel ».
La question du principe de précaution est donc ici posée. Cette notion a été introduite dans notre constitution par l’article 5 de la charte de l’environnement. Cependant, c’est une notion floue dont il est très difficile de définir les contours. Contrairement à la prévention, la précaution vise les risques probables, non encore confirmés scientifiquement. Or, les scientifiques justement n’arrivent pas à s’accorder sur la dangerosité de ces antennes-relais. Les études (Rapport Bio-Initiative, étude Interphone de l’Organisation Mondiale de la Santé, étude du CNRS pilotée par Jean-François Viel…) sont contradictoires, les qualités des expertises sont remises en cause, on accuse les uns de ne pas être indépendants, les autres de ne pas avoir une démarche scientifique. Bref, nous sommes dans un dialogue de sourds.
En France, d'après le décret du 3 mai 2002(1), les seuils d'émission autorisés varient de 41 à 61 volts par mètre (v/m) en fonction de la fréquence mesurée au niveau des antennes-relais, ce qui est au dessus de certains seuils européens. Les associations environnementales réclament une diminution drastique de ces seuils. Cependant plus les émissions sont faibles plus le nombre d’antennes doit être augmenté afin de garantir le fonctionnement optimal des services qu’elles offrent. Pour atteindre le seuil de 0,6 v/m revendiqué par les associations, il faudrait donc multiplier le nombre d’antennes-relais sur notre territoire. Si cela semble faisable techniquement, la question des coûts d’installation pour les opérateurs et de leur répercussion sur les consommateurs est avancée. Cela serait d’autant plus problématique dans les espaces ruraux compte-tenu des obligations de couverture du territoire imposées aux opérateurs. Enfin et peut-être surtout, en cas d’accord sur une forte diminution des émissions, l’accueil réservé aux antennes-relais au niveau local sera-t-il réellement différent ?
On ne peut que déplorer le manque de dialogue initial entre les opérateurs et les associations, alors que la question des antennes-relais se pose depuis une dizaine d’années. Je suis convaincu que nous n’en serions pas là si une véritable concertation avait été engagée dès le départ, c'est-à-dire beaucoup plus en amont du problème. Aujourd’hui la pression médiatique est très forte et, les sondages le montrent, l’opinion est très sensible.
Le premier volet de la loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dite « Grenelle 1 » précise qu’«une synthèse des études scientifiques relatives aux effets des champs électromagnétiques sur la santé sera présentée par le Gouvernement au Parlement avant la fin 2009. » Mais la situation actuelle montre l’urgence d’un dialogue entre les parties prenantes et d’une prise de position claire et univoque de l’Etat. A ce titre, la table ronde sur le sujet prévue le 23 avril, en permettant d’ouvrir des espaces de dialogue, va dans le bon sens. Il est indispensable qu’à l’issue de cette table ronde, des orientations partagées par l’Etat et les grandes associations environnementales, professionnelles et de consommateurs puissent être dégagées à la lumière d’exposés pluralistes.
Au delà de l’urgence, comment éviter qu’une telle situation de blocage ne se reproduise ?
Au niveau national, il est indispensable d’apporter des réponses à la question de l’expertise. Il s’agit de savoir comment élaborer une expertise fiable, indépendante, reconnue de tous et donc légitime. Un travail de fond est nécessaire dans ce domaine et le Parlement a ici un rôle à jouer. Par exemple, il me semble intéressant de faire évoluer l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Techniques et Scientifiques (OPECST)(2), afin que cet organisme puisse devenir une structure d’expertise ouverte à la société civile, pour appuyer le Parlement dans ses décisions. Le « Danish Board of Technology » au Danemark pourrait alors nous inspirer. De plus, la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) qui instruit des dossiers d’aménagement et de politique publique d’intérêt national pourrait par exemple s’appuyer sur les travaux de cet office dans le cadre d’une demande d’expertise complémentaire.
D’une façon plus générale, il nous faut nous doter de moyens permanents permettant de prendre des décisions publiques en s’appuyant sur les avis éclairés de nos concitoyens et des parties prenantes. Le comité opérationnel n°24 du Grenelle de l’environnement « Institutions et représentativité des acteurs » que j’ai eu l’honneur de présider proposait d’ailleurs d’élargir le Conseil Economique et Social aux acteurs de l’environnement (les associations environnementales mais aussi les associations des usagers de l’environnement comme les chasseurs et les pêcheurs). En l’état actuel, le projet de loi « Grenelle 2 » reprend largement ces propositions. On le voit, les outils se mettent en place. Il faut à présent les coordonner pour qu’une expertise forte et crédible puisse être rendue en lien avec des instances de concertation pérennes. Dans de telles conditions, la question du principe de précaution par exemple pourrait être débattue raisonnablement avec l’ensemble des acteurs. Les contours de cette notion seraient alors moins définis par la jurisprudence - et les procès - que par la recherche de consensus.
Au niveau local, les élus, pris entre considérations économiques et inquiétudes de leurs administrés, sont de plus en plus démunis. Si certaines initiatives sont à souligner, telles le « Guide de bonnes pratiques entre maires et opérateurs » réalisé par l’Association française des opérateurs de téléphonie mobile (AFOM) et l’Association des maires de France (AMF) en avril 2004, la concertation entre les parties prenantes et le public doit également pouvoir se mettre en place.
Pour le moment, la législation impose un certain nombre de règles d’installation, mais du fait de leur taille et de leur faible emprise au sol, le législateur n’a pour le moment pas prévu de soumettre les antennes-relais à enquête publique ou à des procédures spécifiques de concertation. Les opérateurs et les maires doivent tirer parti de cette situation, non pas pour continuer à réaliser des ouvrages sans prendre en compte les différentes parties prenantes, mais au contraire pour inventer de nouvelles formes de concertation. Si de telles démarches peuvent, de prime abord, paraître longues et délicates à mettre en place, elles pourraient à terme contribuer à limiter la judiciarisation des procédures et à instaurer plus de dialogue entre opérateurs, élus et associations locales. Il faut pour cela que les opérateurs et les collectivités locales opèrent une véritable révolution culturelle en interne. Ils doivent pouvoir se doter de moyens humains et méthodologiques leur permettant de mieux anticiper les difficultés sur le long terme, et ainsi de mieux y répondre le moment venu.
Pour cela, ils ont besoin d’orientations qui font encore défaut. L’association Décider ensemble(3) que je préside vise justement à repérer les pratiques novatrices des entreprises et collectivités locales en matière de concertation. Avec pour objectif de développer la culture de la concertation et de la décision partagée en France, Décider ensemble diffuse ces bonnes pratiques et cherche à élaborer des outils et des méthodes nécessaires à la réussite des projets, afin de favoriser l’implication de tous les acteurs dans un processus de décision volontariste et éclairé.
La question de l’implantation des antennes-relais est un cas d’école d’incompréhension et de manque de dialogue. Il faut qu’à la lumière de cet exemple nous puissions interroger notre façon de prendre des décisions. Je suis convaincu qu’une plus grande concertation et un meilleur dialogue sont les éléments indispensables pour réintroduire cette confiance dans notre pays entre les citoyens, les usagers, les élus et les entreprises à toutes les échelles de notre territoire. Et dans le contexte d’une certaine défiance de nos concitoyens vis-à-vis de l’entreprise et des élus, phénomène encore accéléré par la crise, la question de la confiance réciproque est cruciale.
Bertrand PANCHER
député de la Meuse
1 Décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12o de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.
2 Cet organisme créé par la loi n° 83-609 du 8 juillet 1983, à la suite d'un vote unanime du Parlement a pour mission "d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d'éclairer ses décisions". A cet effet, l'Office "recueille des informations, met en œuvre des programmes d'études et procède à des évaluations". L’OPESCT a organisé le 6 avril 2009 une audition publique sur les effets sanitaires des antennes-relais.
1



