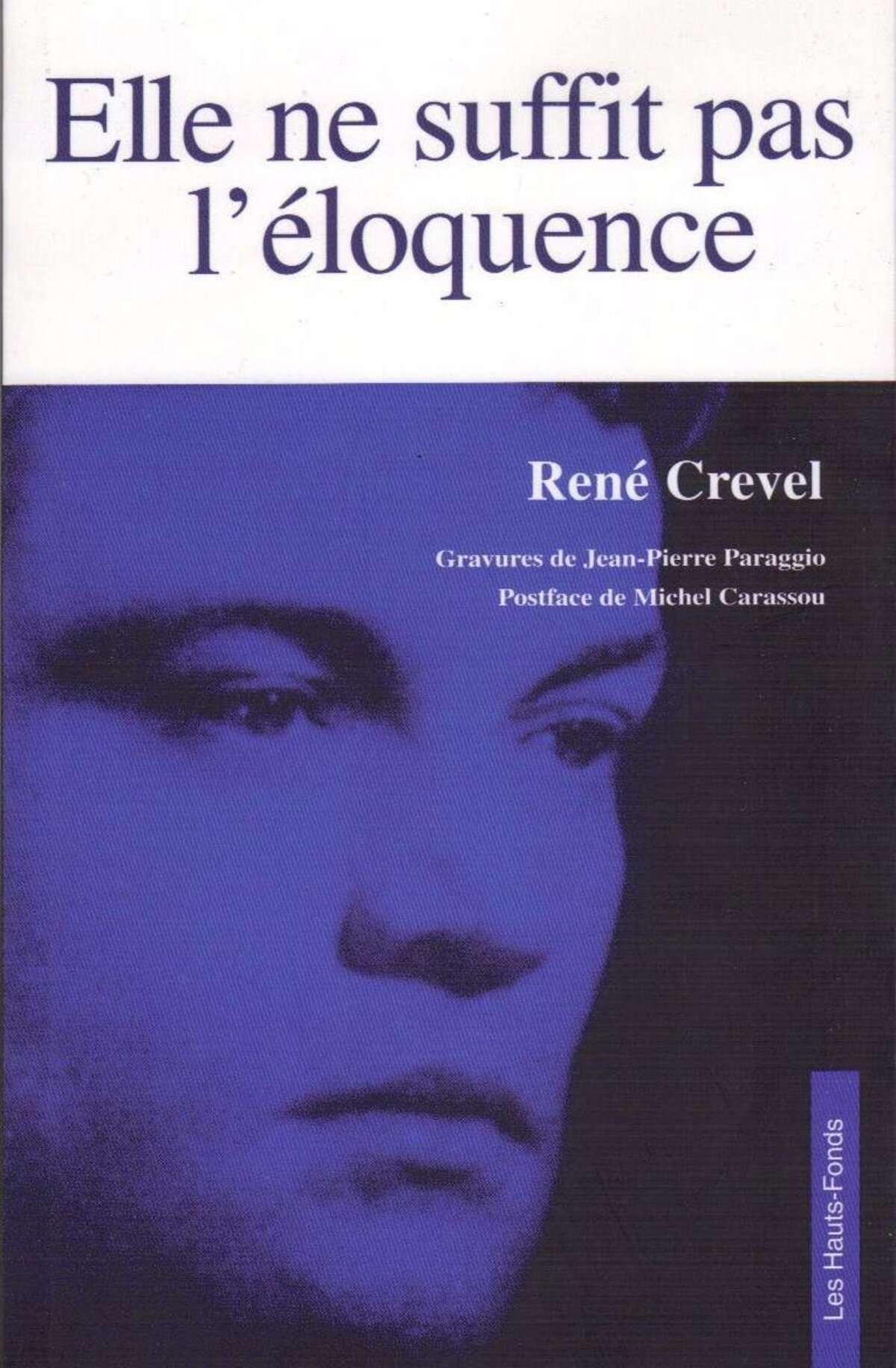
Agrandissement : Illustration 1

Il est un passant traversé, un jeune homme en désordre mais aux traits lisses et réguliers.
René Crevel écrit, traversant comme la lumière de certaines maisons, il publie des livres bien sûr, mais il distribue des mots, des textes brefs dans des revues, poèmes et plus souvent prose instable, arrachage de l’instant, logique convaincante du rêve, sensualité, et cette langue. Fluide, souple, déliée-concentrée.
René Crevel est pressé et il a raison. Le 17 juin 1935, atteint de désespoirs multiples, il se suicide.

Aujourd’hui, les éditions Les Hauts-Fonds[1], sises à Brest, publient, en 70 pages, quelques-uns de ces textes et poèmes, récup’ littéraire souvent choisie dans des revues, années 20 années 30 : L’éloquence ne suffit pas, c’est le titre d’un poème.
« Pitié pour l’homme qui passe ,
L’homme qui mord sa lèvre,
Dans ces lèvres,
Car il a peur d’oublier le goût de bouche ».
Et dans cette éloquence là, ceux qui sont familiers de l’œuvre [2] trouveront le texte rare, le poème enlevé d’un livre, le fragment dans sa perfection, le plaisir, si présent, ceux qui ne connaissent pas pourront y entrer de plain-pied , en intimité.
Quoique plutôt épris du dadaïsme et de Tristan Tzara, René Crevel passe par le surréalisme, ou plutôt, le surréalisme passe par lui.
Il est alors très jeune, un air d’adolescence : à deux ou trois années près, ses aînés auront connu la guerre, lui est gueule cassée du désastre familial. Suicide du père pour ses quatorze ans, haine passionnée de la mère. (« …être tenté de m’asseoir sur les genoux d’une femme qui, elle-même, n’avait recours aux chaises que pour donner un double specimen de l’angle droit »).
Il est beau, homosexuel ( ou plutôt bisexuel), dérangeant, il entraîne le groupe dans des expériences d’hypnose, lesquelles s’interrompront assez rapidement, lorsque Crevel propose le suicide collectif, et que Desnos manque poignarder Eluard.
Breton – étanche à l’hypnose, lui - sera impressionné par l’« éloquence » du jeune homme en transe et regrettera que ces moments ne se soient inscrits que dans les mémoires du groupe.
Tout ne s’est pas perdu : La négresse aux bas blancs, un des plus beaux textesdu livre, (« Samedi 7 octobre. Parlé »), débute dans l’étrange familiarité du rêve, se poursuit avec raréfaction de la virgule et du point, pas de souffle à reprendre, échappée en accélération.
Jamais André Breton, qui n’aura pas lésiné sur l’exclusion et sur trouver les mots durs, ne condamnera tout à fait Crevel. On n’écrit pas le surréalisme, on le vit, celui-là justement vit intensément.
Pourtant, à l’aune du groupe surréaliste, il pèche, et pas qu’un peu. Trop mondain, trop séducteur, et s’adonnant à un genre condamné, le roman. Roman du moi, fragmenté, insouciant du narratif, prose poétique, roman en hallu, fouillant d’abord dans l’histoire familiale, une autofiction qui n’oublierai pas de voir le monde et fait de lui tout autre chose que le héros fitzgeraldien, héraut du mal de vivre, qu’on se plait alors à voir en lui. De l’influence d’un beau visage sur une réputation. Mon corps et moi, La mort difficile, Etes-vous fous ?
Car, bien plus encore que dans ses poèmes, René Crevel est dans sa prose, peut-être. Il y met un souffle, un abandon, un désir, défini dans cette autobiographie-éclair qui figure sur la jaquette du livre : « Voudrait bien pour des romans futurs retrouver des personnages aussi nus, aussi vivants que les couteaux et les fourchettes qui figuraient les hommes et les femmes dans les histoires destinées à demeurer inédites qu’il se racontait enfant ».
Et il y a de cet inédit enfantin, dès le premier récit , Lettre pour Arabelle, miracle en deux pages, moment saisi sur « le grand divan - l’inévitable divan – de votre boudoir bleu et or » où balance, au crépuscule, le désir et une amitié amoureuse qu’un rire enferme.
« Si mes amis, chaque année, consentaient à mourir collectivement, la vie serait à la fois plus simple et plus diverse » : il y a aussi, dans cette prose, l’insolence adolescente qui ne le quittera jamais vraiment.
Autre chose le traverse, le perfore, même : la tuberculose. « L’homme qui ne savait même pas respirer ». La Grave, Leysin, les séjours au bon air l’expédient régulièrement loin des hôtels nocturnes ou du Berlin que les nazis débutants qualifient de décadent. Un de ses amis sera Klaus Mann, son amour Mopsa Sternheim [3]: ces jeunes gens qui passeront de dandysme cocaïné à la plus âpre résistance au nazisme.

Monde surréel, monde réel, René Crevel revient vers Breton… via Trotski exilé, via surtout, l’urgence historique et son désir d’engagement total. Il s’en éloignera de nouveau, sans rupture fracassante, pour lutter auprès des communistes. Homme du pas de côté, il n’adhère pas au Parti. Ce qu’il écrit devient pamphlet, pamphlet parfois bien décalé comme en atteste un Post-Scriptum en fin de volume, ou parfois éclatante réaffirmation de l’imaginaire, tel La grande mannequin cherche et trouve sa peau, le texte qui clôt le volume.
L’éloquence ne suffit pas, non, Crevel à hauteur de la grande mannequin (1934) se bat au sein de l’AEAR ( Association des écrivains et artistes révolutionnaires), prépare fébrilement le Congrès international des écrivains.
L’Europe littéraire, sens large, y compris un ou deux écrivains soviétiques soutirés de justesse à Staline, va s’y réunir face au fascisme grandissant.
Mais pas les surréalistes, privés de parole… ( ou de micro, ce qui revient au même..) René Crevel en est très atteint. Le totalitarisme avance, y compris chez les proches. Et ce Congrès, qui devait être un début, ressemble à une fin.
« A travers tout cela, c’est l’angoisse qui domine », dira plus tard Breton. Crevel apprend alors que la tuberculose, dont il se croyait guéri, mine ses reins, commentera ultérieurement Aragon.
« Une tisane sur le fourneau à gaz, la fenêtre bien close, j’ouvre le robinet d’arrivée, j’oublie de mettre l’allumette », écrivait René Crevel des années plus tôt. Ce qui fut fait, le 17 juin 1935.

L’éloquence ne suffit pas, René Crevel, 13 euros
Gravures de Jean-Pierre Paraggio.
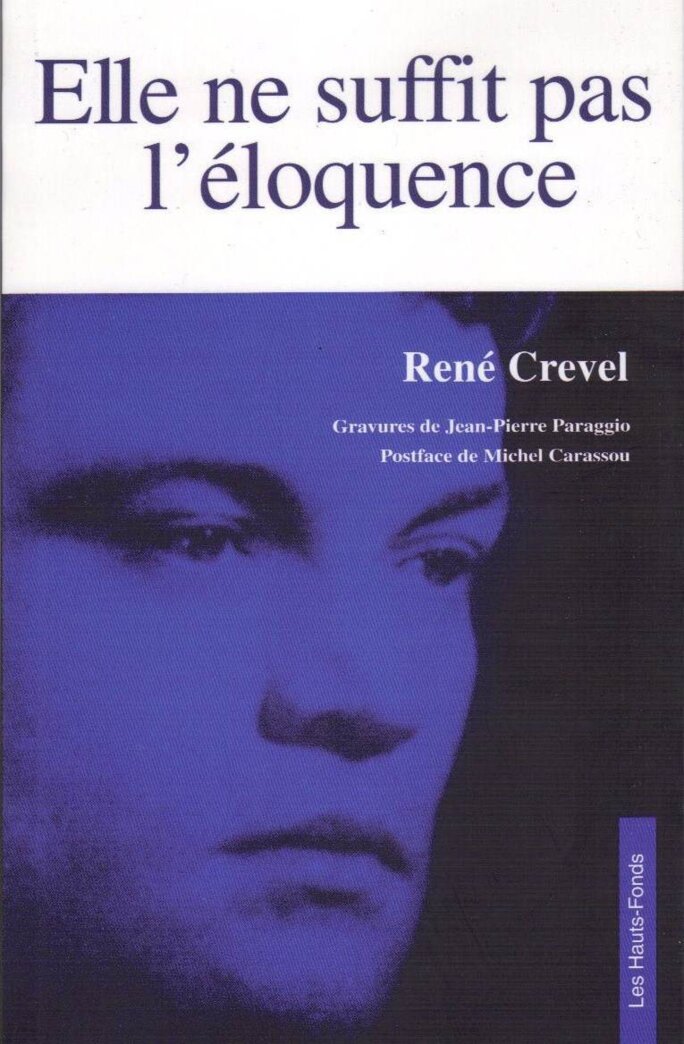
Agrandissement : Illustration 5

Postface de Michel Carassou, qui est également l’auteur d’une biographie de René Crevel ( Fayard).
Editions les Hauts-Fonds. Le livre ne se trouvant pas dans toutes les librairies, même bonnes, on peut le commander ici.
Légendes photos: René Crevel
2/ Mopsa Sternheim ( site dévolu à René Crevel)
3/ La jongleuse, de Paul Nougé
[1] Un court avertissement, qui a plutôt des allures d’invitation, en début de volume, est signé de l’éditeur Alain Le Saux, et d’un certain PB.
[2] Les romans de René Crevel ont tous été réédités en Poche ces dernières années.
[3] Mopsa Sternheim, fille de l’écrivain Carl Sternheim, amie des Mann, décoratrice de théatre et bien plus que cela. Résistante antinazie, elle sera arrêtée, toturée et déportée à ravensbruck d’où elle reviendra pour vivre, pauvrement, à Paris. Elle y meurt au début des années cinquante. Sa rencontre avec René Crevel est relatée dans « Etes-vous fous ? ». Leur correspondance a été publiée ( éditions Paris Mediterranée)



