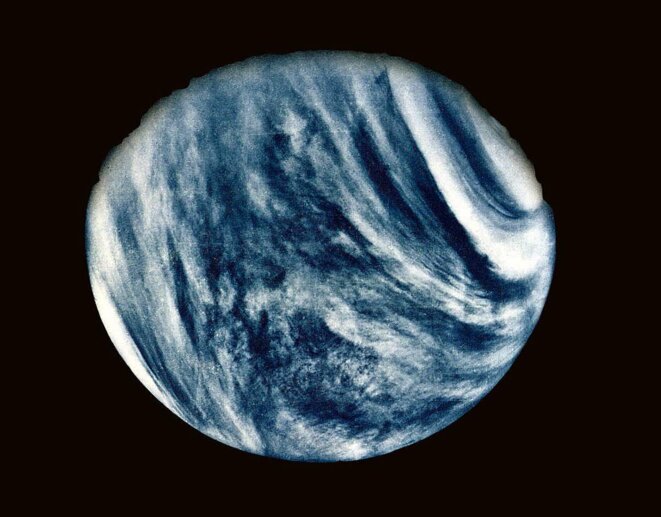On confond souvent utopie et fantasme. Certains la définissent comme un “idéal (...) qui ne tient pas compte de la réalité”. Pour d'autres, c'est une “construction imaginaire et rigoureuse d'une société, qui constitue un idéal, par rapport à celui qui la réalise”, ce qui me semble déjà plus tangible. Certes, un festival en ville où l’on s’offre quelques verres entre deux écoutes religieuses d’artistes de haut vol n’est pas franchement une micro-société anarchiste, libérée de relations marchandes, ni de contrariétés. Mais ce qui compte c’est le chemin, pas la destination. Il ne m’aura fallu que 24 heures aux Suds à Arles pour retrouver ces frissons qui donnent l’envie. L’envie que les silences s’étirent entre les polyphonies catalanes de Tarta Relana au Museon Arlaten tant ces secondes suspendues laissaient à peine à son petit public de veinard·e·s le temps d’avaler son émotion. Une création inédite dont la puissance donne la pell de gallina, et dont la beauté tire les larmes.

Agrandissement : Illustration 1

Plus tard, l’envie de se donner la main, et la joie de voir toutes ces silhouettes, petites et grandes, touristes, festivalières ou arlésiennes, sur la bien trop petite place Voltaire aux mains du Mange Bal. Nils Kassap à la clarinette pourra se targuer d’avoir fait couler… notre sueur cette fois-ci, pour sa dernière représentation au sein du duo, après 4 ans de parcours aux côtés de Théodore Lefeuvre. C’est désormais avec Loïc Vergnaux que l’accordéoniste, maître de cérémonie, composera de concert en concert ces bulles désirables.
Théodore : On fait découvrir cette forme de bal au public, à travers nos concerts ou des stages, et comme on joue un peu partout, que ce soit pour la fête nationale, des fêtes de village ou des lieux alternatifs comme à Notre-Dame-des-Landes, on fait découvrir tout ça à un public très large. Folk c’est le peuple, c’est populaire et c’est censé être accessible et joué partout. J’aimerais qu’on tende toujours plus dans ce genre de dates découvertes pour le public, et les inviter à entrer dans la danse s’ils en ont envie, sinon ils pourront toujours profiter du spectacle.
Et quel spectacle ! À mesure que la danse contagieuse déborde du moindre espace piétinable au devant de la scène, une foule spectatrice braque tant bien que mal téléphones et objectifs afin de capturer, en vain, l’instant. À ce moment, quelque chose d’autre prend vie, j’en suis témoin. Ça sautille, ça tournoie, ça se respecte et ça fabrique ensemble, non plus poussé par la peur, mais attiré par la joie. C’est grâce à un travail de fond sur la convivialité et l’inclusivité que le Mange Bal crée des moments comme celui-ci, en effritant – par exemple – la domination masculine qui intoxique tant d’espaces festifs.

Agrandissement : Illustration 2

Théodore : Le bal folk est un milieu qui essaie d’avancer sur cette question. Il y a le collectif matière vivante par exemple qui fait de la prévention en bal sur les VHSS (violences et harcèlement sexistes et sexuels). On essaye de notre côté de dé-genrer la pratique en parlant de la personne qui mène ou qui suit, plutôt que du rôle présupposé de “l’homme” et de “la femme” dans les danses à deux. On ne vit pas dans un monde de Bisounours donc c’est une remise en question constante. Ça passe aussi, chez les organisateur·rices par une recherche de parité comme avec Modal Media (qui propose un annuaire de musiciennes·x pour favoriser la diversité dans les programmations).
Traversé par ces questions, j'atterris mardi matin sur les bancs d’un amphi (moi qui n'ai jamais mis les pieds à la fac), pour passer de la pratique à la théorie lors d’une rencontre censée réenchanter mes imaginaires. Les intervenant·es s’y accordent sur un triste constat : nous nous enfonçons chaque jour un peu plus dans une bonne grosse dystopie. Il suffit d’allumer les infos pour s’en convaincre. Un point de vue partagé par le directeur du Festival.
Stéphane Krasniewski : J'ai choisi ce thème avec mon complice Alban Cogrel de la FAMDT (Fédération des acteur·ices des musiques et danses traditionnelles) qui trouve le temps de lire tous les livres que je ne lirai sans doute jamais. Mais aussi Eric Fourreau (éditions de l’Attribut), le SMA et le réseau Zone Franche. Cette rencontre s’est imposée après 10 ans de questionnements sur nos métiers, sur des questions économiques, de “concentration vs coopération”. Depuis 2 ans, je souhaite que ces rencontres accueillent le public le plus large possible parce qu'elles concernent l’ensemble de la société et pas seulement les professionnel·les. Elle s’est imposée parce qu'on traverse une période de régression qui va à l’encontre de toutes les valeurs qu’on prône et qu’on défend.
Mais si la dystopie est un récit, c’est donc une fiction, que les apôtres de “l’illimitisme”, du pouvoir et de la prédation forgent depuis les années 70 et jusqu’à aujourd’hui, grâce à la puissance médiatique et financière qu’on leur connaît. Tandis que notre sidération se mue en morosité, en fatalisme , il est vital d’éprouver ensemble ces joies collectives, comme on le fait ici aux Suds à Arles, et dans bien d’autres festivals, maisons de quartier, associations, clubs de sport, et j’en passe. Il est plus facile de faire éclore ces minutes d’allégresse que de renverser notre réalité : et si nous commencions par ça ?

Agrandissement : Illustration 3

Stéphane Krasniewski : La musique vivante a cette capacité de créer des émotions partagées, et la force d’un festival est de pouvoir se laisser surprendre par des propositions qu’on n’est pas nécessairement venu voir et qui ont amené des publics et des communautés différentes. Les croisements esthétiques de notre programmation permettent de voir l'existence de ces communautés, de s’ouvrir et se reconnecter les uns aux autres. On a la chance à Arles d’avoir un festival qui permet encore d’investir l’espace public comme avec ce bal de lancement qui a envahi la place Voltaire. C’est de plus en plus difficile de le faire car la musique dans l’espace public est plus souvent vécue comme une nuisance que comme une chance. Mais aussi parce que l’été, dans une ville comme Arles, les places publiques se transforment en terrasses géantes.
Donnons-nous la force et l’envie de bâtir ces bulles de partage et d'empathie, de bonheur et de justice, de les faire se toucher, se voir, se parler et fusionner pour rétablir, pas à pas, un futur qui nous fait rêver. Un imaginaire décolonial, féministe et écologiste puisqu’ “il n’y a pas de hiérarchie dans l’oppression”, nous dit la poétesse américaine Audrey Lorde.
Stéphane Krasniewski : J’ai envie de croire qu’on assiste à la fin d’un monde. À regarder la manière dont la jeunesse aujourd’hui s’empare de la question de l’identité ou du genre. C’est tellement plus ouvert, plus évident. Nous assistons simplement au sursaut (réactionnaire) d’un monde qui meurt. La nouvelle société qui va advenir sera plus ouverte et tolérante et les Suds y trouveront encore plus leur place.
Pour renverser le récit moderne paralysant, branché sur mégaphones par les médias privés de quelques milliardaires qui en font leur roux (puisqu’on a ici la farine ET le beurre), il faudra s’accorder sur les manières de réveiller les imaginaires. Tout un programme (politique ?) dans des discussions encore parasitées – ici aussi – par des rapports de domination. Entre pragmatisme, optimisme et alarmisme, les pistes peinent à converger mais pour reprendre la formule de l’enthousiaste Samuel Grzybowski : “Ne confondons pas altérité et adversité, différences et oppositions.” J’ai le reste de la semaine pour guetter ici et là ces bulles inspirantes, et m’y engouffrer. Même si certaines – si fragiles – explosent bien vite, elles nous disent qu’il existe autre chose que le dépit et prouve que le plaisir est plus fort, lorsqu’il est partagé.

Agrandissement : Illustration 4