Il y aura très peu de films latinos à Cannes cette année (à peine quatre titres, sauf erreur, toutes sections confondues - et un seul en officielle, chilien) - raison de plus pour se ruer en salles, ce mercredi, découvrir L'œil invisible, essai foucaldien sur la dernière dictature argentine (1976-1983), sélectionné l'an dernier à la Quinzaine des réalisateurs.
Diego Lerman, révélé par le lesbien Tan de Repente (2002), devenu l'un des repères multiprimés du nouveau ciné argentin, signe ici son troisième film, adaptation blafarde d'un roman, Sciences morales, de Martin Kohan (publié en 2007 à Buenos Aires, traduit en France au Seuil, en 2010). Dans un entretien au Pagina 12, le Libé argentin, Lerman donne l'une des clés du récit: «C'est une métonymie: raconter la partie pour voir le tout (...), pour décrire avec une grande efficacité ce qu'il se passe de l'autre côté des murs».
Les murs en question sont ceux du prestigieux Colegio nacional de Buenos Aires, entre lesquels se déroule la quasi-totalité de L'œil invisible. Année 1982. A quelques jours du déclenchement de la guerre des Malouines, dernier coup désespéré des militaires pour tenter de se maintenir au pouvoir, en jouant sur la fibre nationaliste du peuple argentin. La dictature n'est plus aussi meurtrière qu'en ses premières années, et son effondrement est proche. Ambiance de fin de règne, peu fréquentée jusqu'à présent par le nuevo cine, qui s'est davantage concentré sur les «disparitions» sanglantes des années 1970.
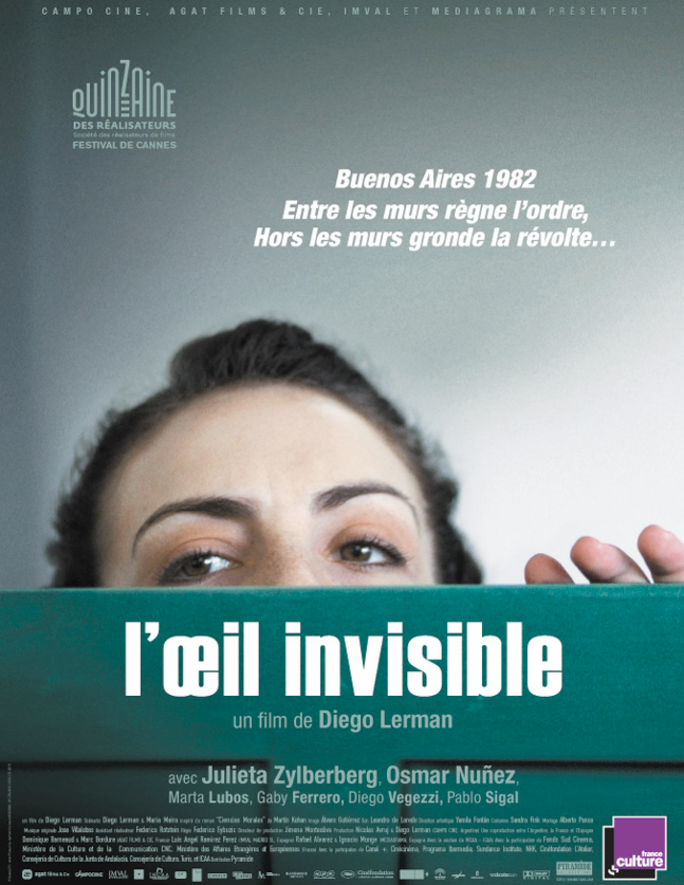
Agrandissement : Illustration 2
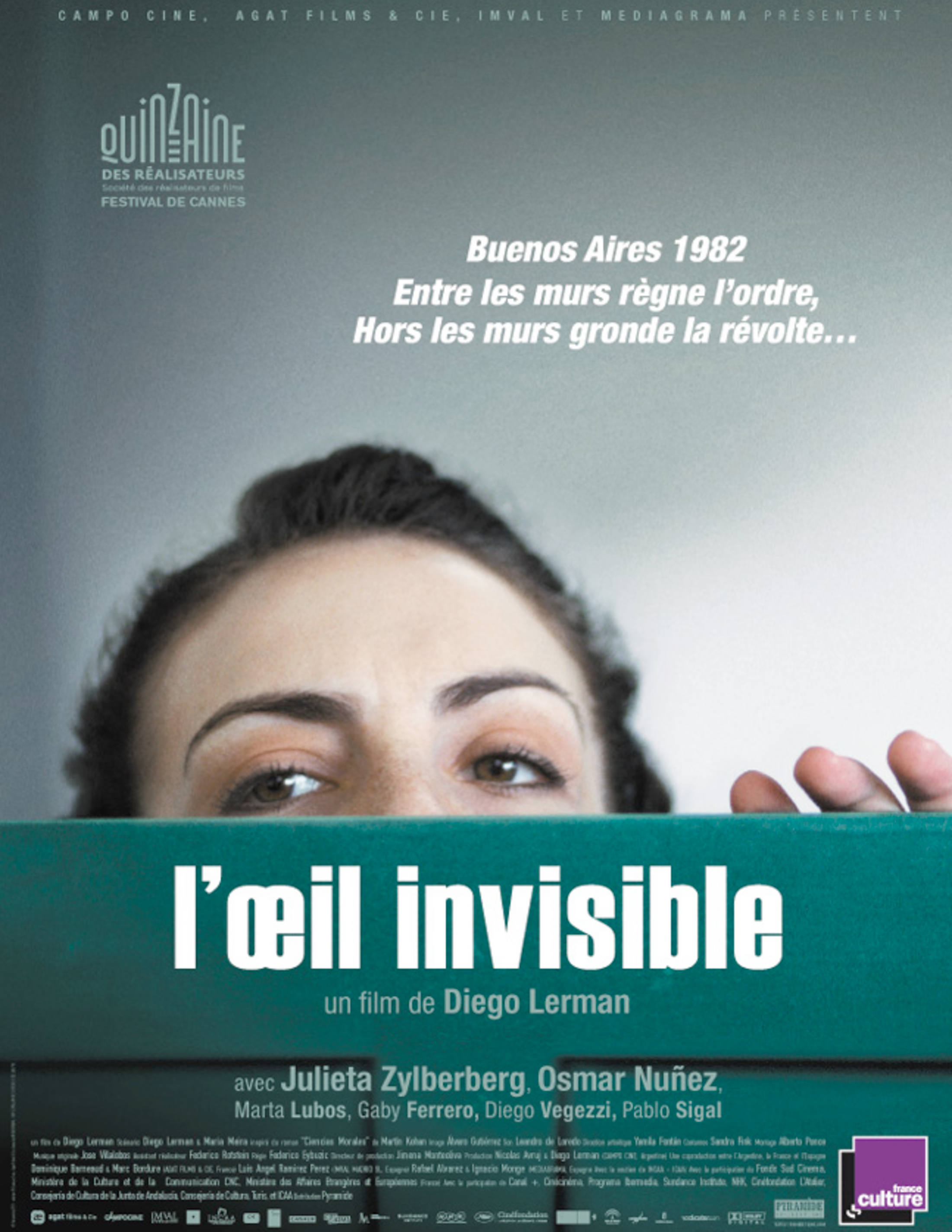
Maria Teresa, 23 ans, est surveillante dans ce lycée hyper-autoritaire, et voulant bien faire, pousse le zèle jusqu'à espionner les élèves, surtout les garçons, dans tous les recoins de l'établissement. Elle devient l'œil invisible. «Fumer au lycée est le cancer de la subversion», lui explique son supérieur. Ce huis-clos raconte comment l'on dresse et surveille les corps, surtout lorsqu'ils sont jeunes et encore malléables. Comment cette sophistication perverse des techniques de surveillance reflète une idéologie meurtrière. Comment le totalitarisme à l'extérieur du lycée pèse sur les gestes au quotidien, pourrit les règles de l'institution scolaire, complique les pulsions sexuelles.
Le film se termine sur un double drame (que l'on taira), rendu par des partis pris de mise en scène astucieusement opposés - le premier est montré plein cadre, de manière très graphique, tandis que l'autre est laissé hors champ. De l'un à l'autre, la même comédienne, Julieta Zylberberg, déjà repérée chez Lucrecia Martel et Albertina Carri, est passionnante à suivre, tout à tour rigide, aérienne, perdue, en opératrice du régime qui finit par s'en détourner. La blancheur de sa peau donne sa couleur au film, et Lerman la poursuit, guidé par la même obsession malsaine qui avait conduit Aronofsky à filmer de manière quasi-documentaire Nathalie Portman, cygne blanc/noir, dans son Black Swan.
Pour poursuivre, le site Universciné a réalisé un entretien avec Diego Lerman, de passage à Paris:



