Le plus beau film projeté aux 22e Rencontres Cinémas d'Amérique latine, qui se clôturent dimanche à Toulouse, ne nous rajeunit pas: c'est un classique vénézuélien, 30 ans d'âge, autour de l'incontournable figure du Libertador Simon Bolivar. Signé Diego Risquez, Bolivar, Sinfonia tropikal, biopic expérimental et méconnu, est l'une des discrètes pépites de la programmation consacrée cette année aux 200 ans des indépendances latinos (même si elle n'intervint, dans le cas du Venezuela, qu'en 1811). Succession de tableaux bruts, sans dialogue, comme autant de vignettes romantiques de la guerre d'indépendance, le film n'a pas vieilli d'un poil.
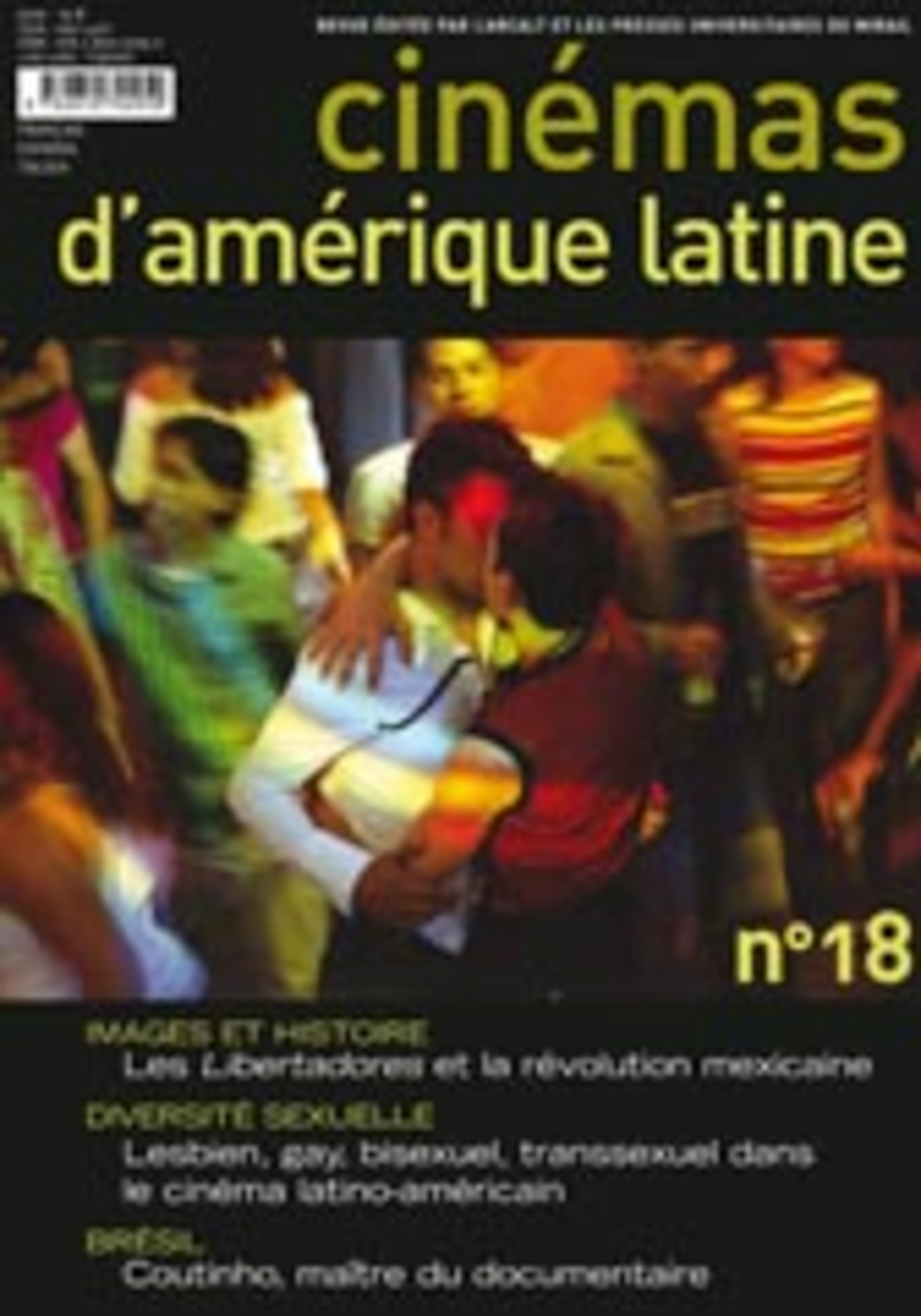
D'abord tourné en super 8, puis gonflé en 35, pour sa projection cannoise (La quinzaine des réalisateurs, 1980), il tente une mise en images du récit national vénézuélien. A l'écran, une Histoire en transe se déchaîne, des Andes au littoral, peuplée de grands hommes dans la brume, tout droit sortis des fresques peintes des musées. Une version de l'indépendance tirée vers l'abstraction, sans le peuple, qui a pu en gêner certains (voir l'article critique «La force des héros», dans le dernier numéro de la revue Cinémas d'Amérique latine). Mais les fulgurances de ce film tourné en 1979 rappellent aussi et surtout, en creux, la pauvreté du cinéma vénézuélien (et souvent chaviste) d'aujourd'hui. Les films récents du même Risquez ne sont pas non plus convaincants.

La compétition toulousaine a par ailleurs apporté son lot de films «mondialisés», co-productions entre l'Amérique latine et l'Europe, dont le nombre grimpe chaque année un peu plus, pour des résultats inégaux. Ces mécanismes de financement de plus en plus sophistiqués ne produisent pas à tous les coups, loin de là, du neuf à l'écran. On pense en particulier à Agua fria del mar (photo), de la costaricaine Paz Fabrega, premier long métrage primé à Rotterdam, sur le papier une vraie curiosité, co-financée par des Français et des Néerlandais. Mais le film, léché et sûr de lui, échoue à proposer quoi que ce soit de neuf. Plus convaincant, Los condenados, d'Isaki Lacuesta, valeur montante du cinéma espagnol, co-production avec l'Argentine, déjoue les pièges de l'académisme sur un sujet pourtant plombant (un ancien activiste exilé en Espagne revient sur les lieux des combats d'alors, et retrouve ses ex-camarades de lutte). Bande-annonce:
Au-delà de la poussée de ces films apatrides, la géographie du cinéma latino n'a semble-t-il pas bougé d'un iota. Les armadas argentin et mexicain continuent de tenir le continent en tenailles, et c'est à peine si quelques cinématographies plus discrètes osent bousculer par instants l'ordre établi (cf. l'Uruguay avec l'inégal mais séduisant Hiroshima). L'Argentine reste donc le principal fournisseur en curiosités, dix ans après la percée internationale de cinéastes devenus majeurs (Martel, Alonso, Llinas) - on est encore là, mais l'on ne va pas se plaindre pour autant.

Agrandissement : Illustration 4

Le cover-boy argentin de l'année s'appelle Marco Berger, qui réussit, avec son Plan B, à surprendre avec de vieilles trames de boulevard. Le «plan» en question, déjà remarqué au dernier festival de Buenos Aires: pour récupérer son ex-copine, un trentenaire décide de séduire son propre remplaçant, avant d'en tomber amoureux. Le film, dans la droite ligne des premiers courts-métrages de Berger, marche à plein à la frustration, à force de suggérer avec l'air de ne pas y toucher, les désirs sexuels de ses personnages - les deux garçons vont-ils finir par se taire et s'embrasser pour de bon? Berger scande l'ensemble de vues d'un Buenos Aires désert et anguleux, façades découpées et quartiers méconnaissables, autant de virgules pour reprendre son souffle, miroirs de la solitude des héros (façon John Ford et ses paysages de campagne tourmentés). En attendant de trouver un distributeur français, bande-annonce:



