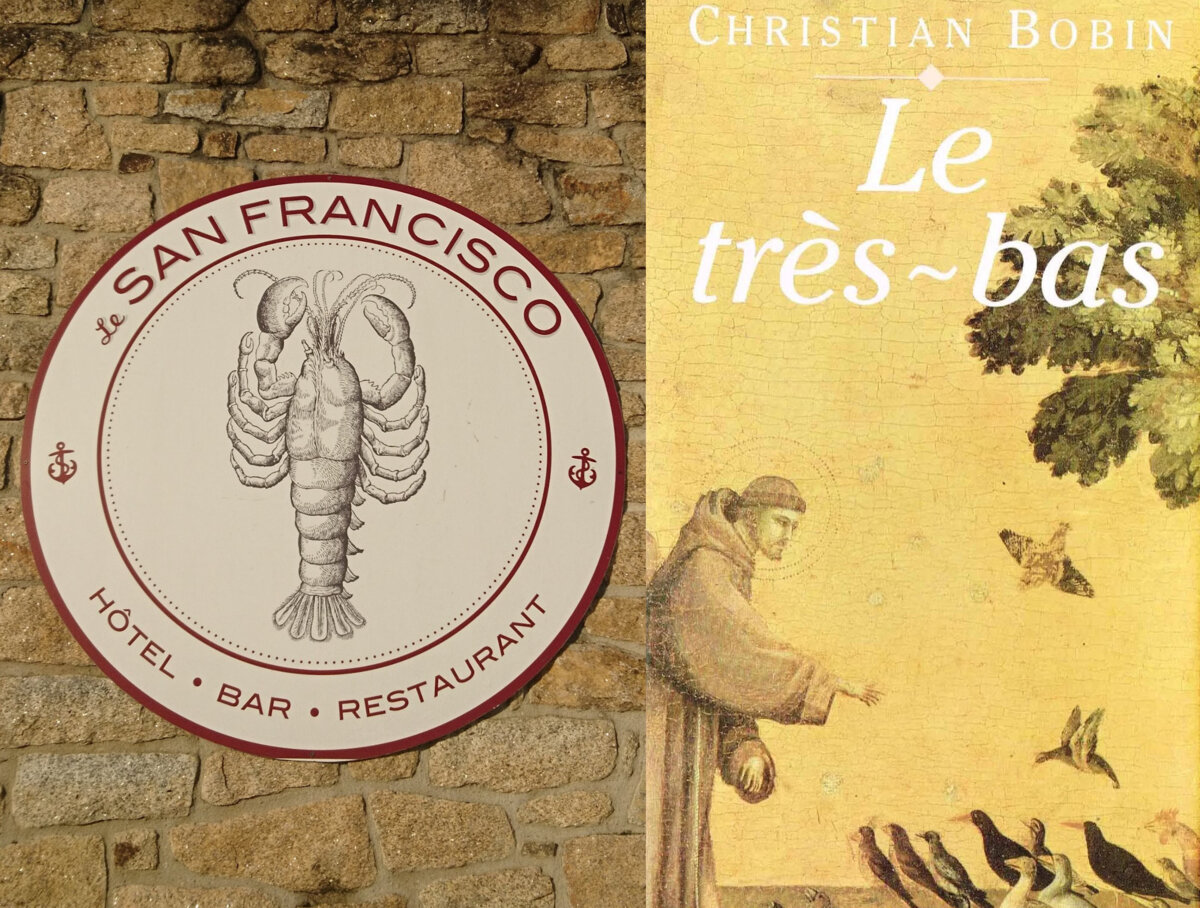
Agrandissement : Illustration 1
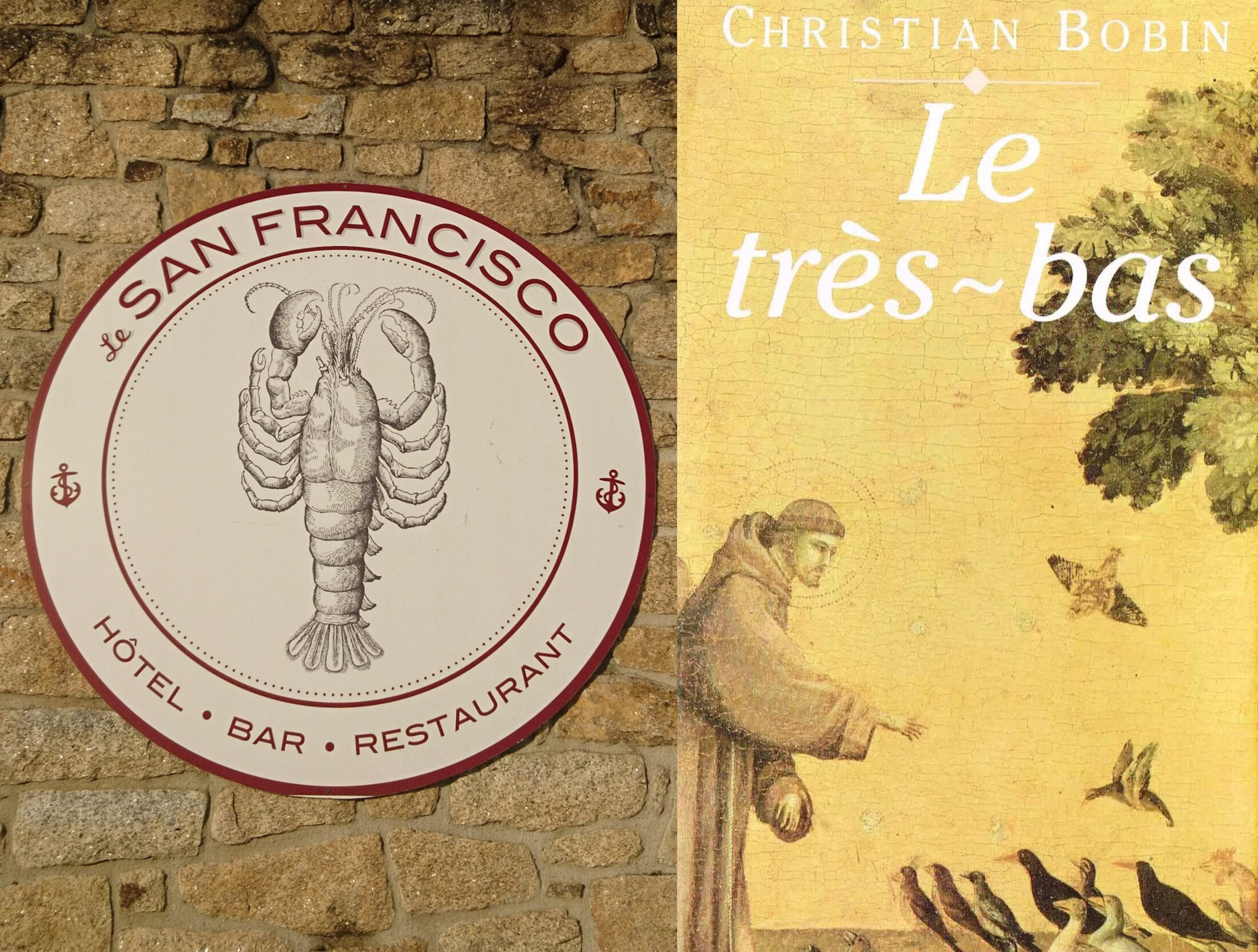
C'est par un ironique tourbillon d'événements et de symboles dont l'histoire a, sinon le secret, le goût, immémoriel, rappelant le fracas des vagues contre la coque autant que le cri des Peaux-Rouges rimbaldiens, que San Francisco, la ville de la ruée vers l'or, aujourd'hui du silicon et de l'intelligence artificielle tient son nom de saint François, « époux de dame Pauvreté », né Giovanni à Assise 600 ans avant elle et devenu peu après Francesco, hisse et ho.
L'enfant s'apelle d'abord Jean. C'est le vœu de la mère, c'est son choix. C'est sous ce nom qu'il est baptisé, en l'absence du père, de nouveau en France pour ses affaires. À son retour il enlève ce prénom comme une mauvaise herbe, il l'efface pour le recouvrir d'un autre : François. Deux noms, l'un dessus l'autre. Deux vies, l'une dessous l'autre. Le premier nom vient droit de la Bible. Il ouvre le Nouveau Testament et il le clôt. C'est Jean le Baptiste qui annonce la venue du Christ, qui prend l'eau des fleuves dans le creux de ses mains pour donner l'avant-goût d'une fraîcheur insensée, d'une ondée d'amour fou. Et c'est Jean l'Évangéliste qui écrit ce qui s'est passé et comment ce qui est passé demeure dans le passage. Jean des sources et Jean des encres. La mère a voulu ce prénom. Ce qu'une mère veut dans un prénom, elle le glisse entre le corps et l'âme de son enfant, là, bien enfoui, comme un sachet de lavande entre deux draps. Jean main d'eau, Jean bouche d'or. Et par-dessus, l'autre prénom, l'autre vie. François de France. François cœur d'air, sang de Provence. Par le nom de famille, un enfant rejoint l'amoncellement des morts en arrière des parents. Par le prénom il rejoint l'immensité fertile du vivant, tout le champ du possible : louer l'amour fort – comme un évangéliste. Ou caresser la vie faible – comme un troubadour. Et, pourquoi pas, faire les deux choses, être les deux : l'évangéliste et le troubadour, l'apôtre et l'amant. – Le Très-Bas, Christian Bobin
Ce ressac, cet encastrement de prénoms, de noms et de sons dans d'autres noms se retrouve autant dans le vocabulaire breton que dans la culture de l'Île-aux-Moines, qui de longue date a le goût du jeu des noms et des mots :
Une des spécificités de la langue îloise était l'usage des surnoms. Dans l'acte d'érection en trève de l'Île-aux-Moines, en 1543, apparaissent déjà sept surnoms. À la fin du XIXe siècle, beaucoup étaient issus de l'enfance : Mahé « Parate » aimait à faire défiler ses soldats de plomb ; Mathurin « Tatahi » parlait volontiers de l'Océanie ; « Turlututu » avait une trompette ; « Charlemagne » portait une cape rouge. – L'Île-aux-Moines au plaisir de la mer, Thierry Sarmant
Le San Francisco lui-même, surnommé Le Frisco, avec sa terminaison en o ne jure pas parmi les patronymes bretons, à la fois proche et lointain écho aux Bellego, Cadio, et autres Gouvello, et à tous les marins au long cours ayant manœuvré loin des côtes îloises sans avoir toujours eu la chance d'y retrouver un jour leurs aimés.
Le presidio de San Francisco est fondé en 1776 par des Espagnols, sur cette côte pacifique avant eux longée par le capitaine Francis Drake et son équipage à la fin du XVIe siècle, capitaine qui allait devenir le premier à ramener son vaisseau à bon port après une circumnavigation complète. Des habitations sont construites sous souveraineté mexicaine dans un endroit de la baie nommé Yerba Buena (« la bonne herbe ») en référence à une plante vernaculaire. Bien avant, la région avait été peuplée par les Ohlones, les Pomo, les Wintun, les Yokut, les Miwoks… San Francisco connaîtra un essor fulgurant avec la ruée vers l'or de 1848, attirant via son Golden Gate des aventuriers du monde entier s'y bousculant enfiévrés.
San Francisco. C'est là que tu lisais l'histoire du général Suter qui a conquis la Californie aux États-Unis et qui, milliardaire, a été ruiné par la découverte des mines d'or sur ses terres… – Le Panama ou les Aventures de mes sept oncles, Blaise Cendrars
Les discours se succèdent. Le général Suter est absent, perdu dans sa rêverie. Des tonnerres d'applaudissements ébranlent les voûtes de l'immense salle de spectacle. 10 000 voix clament son nom. Suter n'entend pas. Il joue nerveusement avec l'anneau qu'il porte au doigt, le tourne, le change de doigt et se répète à mi-voix l'inscription qu'il y a fait graver : - LE PREMIER OR - DÉCOUVERT EN JANVIER 1848 – L'Or, Blaise Cendrars
La voie par laquelle s'effectue habituellement la montée souvent non sans trouble non plus à bord d'Izenah (contraction d'Enez Manac'h, « île au moine », ainsi nommée car au Moyen-Âge, le roi de Bretagne Erispoë en fit don à l’abbaye de Redon, sans toutefois susciter un réel intérêt auprès des dits moines) est la pointe de Toulindag et son port du Lério, où, depuis la fin du XIXe siècle, les passeurs de l'Île se relaient à la barre d'abord de la Marie Ange, puis du Saint-Michel, du Bengali II, du Stiren er mor, de l'Ursule, de La Vague.
Le passage définit à la fois l'action de passer et le lieu où l'on passe. En breton, le passage « an treh », d'où la « pointe du Trech » que l'on trouve aussi orthographié Trec'h : c'est entre cette pointe au nord de l'Île-aux-Moines et la pointe d'Arradon que le passage s'effectuait principalement, jadis. [...] À partir de 1920, beaucoup d'Îlois et de continentaux désirant traverser préféraient déjà user des services de François Mandart et de sa « Marie Ange », au départ de Port-Blanc, sur la commune de Baden. – Le Passage de l'Île-aux-Moines, Guillaume Moingeon
Mon père a failli mourir avec beaucoup de ses camarades mais le destin en a décidé autrement. Il devait embarquer sur le navire du commandant Corno, le mari de la propriétaire du restaurant La Brise et de l'hôtel San Francisco. L'équipage était constitué d'Îlois. Au dernier moment il s'est désisté parce que ma mère s'apprêtait à donner naissance à ma sœur Michelle… et le bateau a sombré à Madagascar pris dans un cyclone. – Le Passage de l'Île-aux-Moines, chapitre écrit par Gildas Le Mentec, passeur de 1956 à 1957 puis de 1963 à 1980
Depuis le port, un escalier conduit au Frisco, juché sur un promontoire qui, quoique modeste de prime abord, projette au ciel et dans la mer.
Tout songeur a en lui ce monde imaginaire. Cette cime du rêve est sous le crâne de tout poëte comme la montagne sous le ciel. C’est un vague royaume plein du mouvement inexprimable de la chimère. Là on vit de la vie étrange de la nuée. Il y a dans tout de l’errant et du flottant. La forme dénouée ondule mêlée à l’idée. L’âme est presque chair, le corps est presque esprit. On pousse la réalité jusqu’à dire, le cas échéant, le mot de Cambronne, et l’on s’y appelle crûment Bottom. – Le Promontoire du songe, Victor Hugo
En vieux breton le promontoire se dit « ros » (la hauteur, le coteau) qui a donné penros, « le bout du promontoire » et de là le perros de Perros-Guirec comme celui de Georges Perros qui, dans ses Notes sur l'aphorisme enchassées au début des Papiers collés écrit que « le cerveau travaille comme les intestins ». D'autres espaces au monde existent-ils honorant davantage ces deux organes et avec eux tous les autres que le Frisco ? Georges Perros invitant lui aussi à plonger dans l'évangile de la mer et dans le ciel du troubadour, et inversement :
Le véritable aphorisme, c'est mort et vie, endroit-envers, forme et fond défigurés. L'aphorisme est positivement fou comme peut être folle, quant à la mer qui n'y comprend rien, la baleine. Folle sans faire de mal, ou de bien, à son soutien, son support qui reste intact. L'aphorisme est propre. Nu. – Papiers collés, Georges Perros
Un peu plus haut sur le grand estran de l'histoire, les drisses et ajuts reliant les terres du Morbihan à celles de la baie de San Francisco, tel un chalut jeté dans le tohu-bohu des existences attrapant ici des dates, là des noms, tiennent dans leur filet agité, peinture folle imitant aussi bien Jérôme Bosch que Salvador Dalí et Georges Mathieu, ralentissant rarement à très rarement pour un Rembrandt, la trajectoire d'un autre météore : Joseph Yves Limantour. Parti en 1831 de la commune de Keryado (devenu depuis un quartier de Lorient) sur un navire de la marchine marchande, celui-ci rejoint Vera Cruz puis passe le Cap Horn avant que sa goëlette L’Ayacucho ne s’échoue sur une plage du nord de la Californie, à laquelle il donnera plus tard son nom – la Limantour Beach –, ayant entre temps acquis la moitié des terres du San Francisco de l'époque.
La Californie devient le 31e état des États-Unis le 9 septembre 1850. La guerre s’est achevée en 1848, avec la signature du traité de Guadaloupe Hidalgo, selon lequel les Américains s’engagent à maintenir les droits de propriété acquis du temps du Mexique. [...] Le Breton fait un retour pour le moins remarqué dans la ville américaine, en 1853. « Devant la Commission des terrains, mise en place par le gouvernement américain et chargée de valider tous les titres de propriété, Limantour va revendiquer une grande partie de San Francisco et les îles de la baie, comme Alcatraz, Yerba Buena, les îles Farallon, la péninsule Tiburon », énumère Gilles Lorand. Avec, à l’appui, les titres de propriété accordés par Manuel Micheltorena, que la Commission des terrains va valider. – Il y a 200 ans, la moitié de San Francisco appartenait à un Breton, Léa Viriet, Ouest-France
Par un coup de bôme n'ayant curieusement pas laissé de cernes très marqués semble-t-il dans le bois de la mémoire collective quant à ses circonstances exactes, la bâtisse îloise du San Francisco prend son nom actuel à la fin du XIXe siècle dans les années 1930 lorsqu'elle devient le refuge de sœurs franciscaines succédant à d'autres, carmélites, iconoclastes et de plain-pied avec l'histoire, dont Suzanne Foccart mère de Jacques Foccart, Monsieur Afrique sous de Gaulle.
Suzanne Foccart avait été jadis, supérieure d’un couvent de carmélites à Laval. Dans les couloirs de ce couvent, un jour, un charmant bambin apparut, courant et jouant, mettant la gaité en ces lieux de réputation austère… On le disait « filleul » de la supérieure. Le petit Jacques, c’était son nom, était en fait, le fils que cette supérieure avait eu avec l’évêque de Laval… L’on menait joyeuse vie, en ce couvent ! Il paraît que l’archevêque de Lyon y venait aussi en visite. On ne prête qu’aux riches… Le scandale finit par éclater, les sœurs furent dispersées. Suzanne Foccart, son amie mademoiselle Ventrion, ainsi que la petite sœur servante, dont le sort avait provoqué l’ire du chanoine Collet, vinrent se réfugier en notre île, à San Francisco. Un livre est paru sur ces évènements, « La vie de monseigneur Geay »… (L’évêque à Laval)… [...] On disait aussi – que ne disait-on pas ! – qu’à San Francisco, un prêtre venait célébrer le culte de la « Vierge enfant », la Santissima Bambina, autour d’un baigneur en celluloïd qui serait maintenant dans une propriété de l’île… Mademoiselle Ventrion a survécu à Suzanne Foccart, elle habitait le Trech dans la grande maison de madame Mottis, élevait des chèvres et vivait de leçons de latin et de français. Elle écrivait des romans « à l’eau de rose » sous le nom de XXX… – Autour d'une tombe, d'après les souvenirs d'une Îloise, PCC Jeanne Michel-David, Gazette de l'Île-aux-Moines n°19
Un tout autre Breton se trouve enserré dans les épissures morbifriscoesques, accroché lui moins par les liens du sol que par ceux de l'onomastique : André Breton, quoique rapidement rattrapé par la double marée îloise et californienne lui-aussi puisqu'il est indirectement à l'origine de la maison d'édition Au sans pareil à laquelle l'écrivain et résistant îlois Louis Martin-Chauffier, qui fut rédacteur en chef de du journal clandestin Libération de 1942 à 1944, a activement participé, y publiant des auteurs avant-gardistes dont un certain Blaise Cendrars.
Sur la terrasse du Frisco, surplombant le golfe, à une bordée de l'île d'Arz et d'une pléïade d'autres îlots, dans une atmosphère de sororité qui, des sœurs Foccart et Ventrion aux sœurs Corno puis aux sœurs Vermynck aujourd'hui, se perpétue à la barbe du patriarcat et de la mort, près d'une chapelle prolongeant le chemin de saint François dont Christian Bobin dit qu'il passait « tout son temps dans la compagnie futile des enfants, des chiens et des ânes », et qui surnommait la grande faucheuse « sœur mort », les apprentis matelots feuilletant un homard comme ils mangeraient un roman (tchin tchin Marcel Proust), succomberaient à l'ivresse de l'enfance et des flots s'ils n'étaient repêchés par Rimbaud qui déjà a raconté cela, il y a 150 ans, avant de s'en aller sans orietur au levant, dans le soleil et dans la mer :
J’aurais voulu montrer aux enfants ces dorades
Du flot bleu, ces poissons d’or, ces poissons chantants.
Des écumes de fleurs ont béni mes dérades
Et d’ineffables vents m’ont ailé par instants.
– Extrait du Bateau ivre, Arthur Rimbaud
Dix-huit nœuds, quatre cents tonneaux, du rhum à tribar, la bordée poursuit son cap dans une écume de prénoms et de noms qui, parfois, auront l'heur de se mouvoir encore, dans le métier à tisser de la littérature et de l'histoire, par l'entremise des mains, des lèvres (levr = livre en breton) d'écrivains, de lecteurs, de pères et de mères :
Je lui ai demandé si le général de Gaulle était toujours aussi inflexible qu'il le racontait dans sa lettre. Réponse : oui, royal. Mais la majesté n'empêchait pas un opportunisme ironique. Il l’avait enseigné lui-même à Blaise : « Un jour, à Londres, j’ai visité avec lui la résidence où vivait Talleyrand quand il était ambassadeur de France. Au mur, ils ont gravé un de ses refrains : “Il n’y a pas de principes, il n’y a que des événements ; il n’y a pas de lois, il n’y a que des circonstances”. Tu sais ce qu’a dit le Général quand on a lu cette phrase ? Juste ces mots : “C’est bien vrai. Dire que j’ai donné à mon fils le prénom de Philippe ! Les circonstances conseillaient alors de plaire à un homme que les principes imposent aujourd’hui de combattre.” » – La Femme qui dit non, Gilles Martin-Chauffier
San Francisco et le Frisco : deux points sur la terre, juxtaposés loin l'un de l'autre, tel un tréma enjambant très haut et très bas les océans. En breton, tréma – du grec ancien τρῆμα, trễma (« trou ») – se dit daouboent, de daou (« deux ») et de poent (« point »). Sur un clavier AZERTY moderne, le tréma se situe entre le P de Ponant et le $ de $an Francisco.
- Le tréma est un diacritique de l'alphabet latin, généralement placé au-dessus d'une lettre ( ¨ ), il peut aussi être souscrit, c'est-à-dire placé au-dessous d'une lettre.
- Tréma est un label de musique.
- Trema est un genre de plante.
- Trema est une localité de Croatie située dans la municipalité de Sveti Ivan Žabno, comitat de Koprivnica-Križevci.
- Tréma est le réseau d'autobus de Mâcon.
- Le tréma (en allemand et anglais « umlaut ») sert également en mathématiques et en physique pour noter une dérivée seconde par rapport au temps.
– Tréma, Wikipédia
« Ne faote ket dein lar doh eh oen men ur roue, ged an eun mar ho-poe ket me miret en hoti ». Kontet ged Luco; taillour a 'n Izenah. – Joseph Loth « Le Breton de l'Île-aux-Moines », Patrick Le Besco
Benigit, va Doue, ar pred a roit d’ho pugale karet. Evit ma c’helint a-hed o buhez. Ho servijin gant karentez. – Bénédicité breton, cité dans La Femme qui dit non
Salut à toi, vieille Izenah
Degemer mat, Yerba Buena
Irmat Yerc'h mad a Bambina
Ilienor Escoët
Le Frisco, été MMXX



