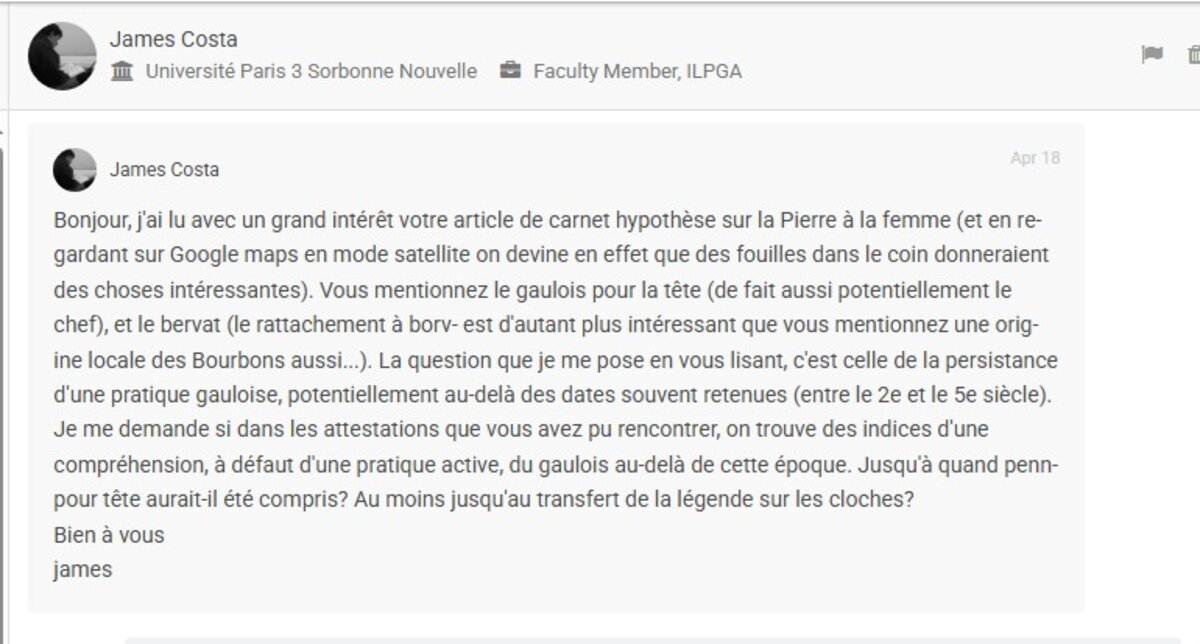
Agrandissement : Illustration 1
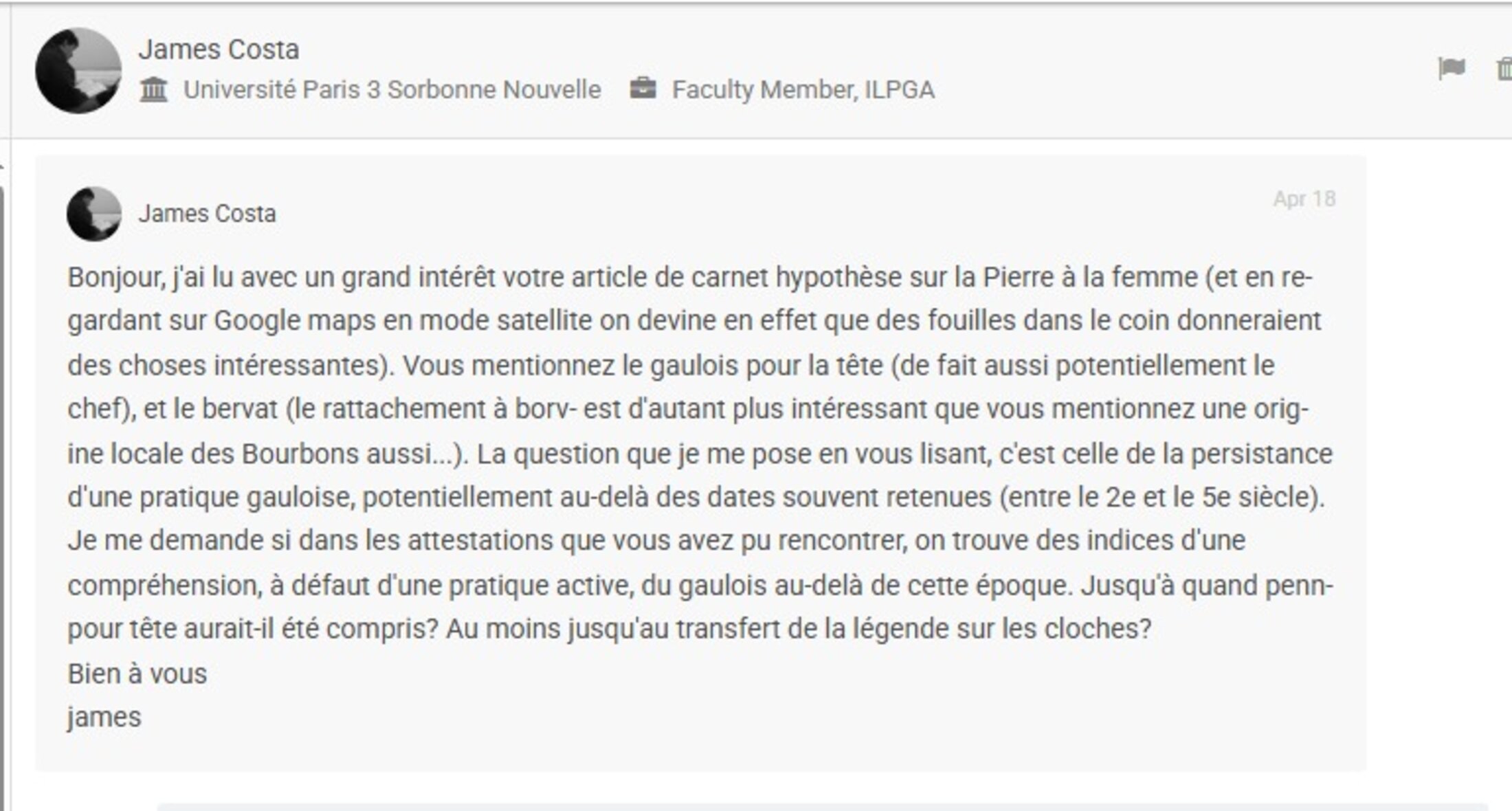
James Costa, professeur à la Sorbonne Nouvelle et directeur de l’Institut de linguistique et phonétique générale et appliquée, m’écrit, à propos de mon petit essai sur la Pierre à la femme, qu'il a "lu avec un grand intérêt", pour obtenir des renseignements sur la survivance du gaulois en Berry au Moyen Âge. Pour des raisons que j'ai clairement détaillées ici, d'intérêt général, mais aussi d'intérêt privé, j'ai choisi de rendre ma réponse publique. Et comme l'audience d'un "carnet Hypothèses" est à peu près inexistante, je la reproduis sur Mediapart.
1. MEMOIRE DU SENS N'EST PAS SURVIE DE LA LANGUE
Nul ne conteste la persistance du gaulois en Gaule durant les trois premiers siècles de notre ère; cependant, cette langue disparaît rapidement au cours du IVe siècle. En Armorique, elle s’éteint manifestement avant l’arrivée des Bretons, ce qui suggère une disparition également datable du IVe siècle, à l’instar de ce qui s’observe en Helvétie, où le gaulois s'efface avant l’installation des Burgondes [1]. Il n’existe donc aucun fondement sérieux pour supposer que cette langue ait pu subsister en quelque région de la Gaule au-delà du Ve siècle, bien que, dans une zone marginale, reculée et peu hospitalière comme les confins marécageux et peu peuplés du Berry — alors refuge des bagaudes — une telle survivance apparaisse comme relativement moins improbable.
En revanche, il est manifeste que le gaulois a continué d’exercer une influence notable sur la toponymie, en contribuant à la formation de nombreux noms de lieux, et ce même après sa disparition en tant que langue parlée. Cette influence s’est notamment perpétuée à travers certains usages onomastiques, tels que la formation de noms de domaines en –acum, de marchés en –magus ou de forteresses en –dunum. Ainsi, bien que le gaulois ne soit plus en usage au début du Moyen Âge, le sens des éléments lexicaux entrant dans la composition des toponymes demeure encore compris.
Lorsque Grégoire de Tours (v. 538–594) fait référence à la “lingua gallica“, il emploie ce terme exclusivement dans le cadre d’étymologies savantes. Celles-ci sont encore intelligibles pour Heiric d’Auxerre (841–v. 876), et même, au début du Moyen Âge central, pour le moine flamand Sigebert de Gembloux († 1112).
2. CONNAISSANCE LARGEMENT ATTESTEE DE LA SIGNIFICATION DU THEME PENNO
Au VIe siècle, Grégoire de Tours témoigne du fait que le gaulois était encore suffisamment compris pour être traduit en latin. Il en donne un exemple avec Briva Curretia (< gaulois briva, “pont” + hydronyme), toponyme à l’origine de Brive-la-Gaillarde (Corrèze) [2][3].
Le même constat s’applique au thème penno, dont la connaissance est solidement attestée en Gaule. Ainsi, le terme pennum figure dans un graffite en langue gauloise découvert à proximité du territoire biturige et conservé au musée Bargoin de Clermont-Ferrand [4]. Ce thème entre également dans la composition de plusieurs anthroponymes — par exemple Pennoovindos (“Tête-Blanche”) — et de nombreux toponymes associés à des hauteurs. Parmi ceux-ci, on peut citer Pavant, dans l’Aisne, documenté au début du VIIe siècle sous la forme Pinnevindo, puis en 855 sous celle de Penvenno [5].
D’autres occurrences notables incluent Pennomagus, à l’origine de Panon, commune située dans l’ancien Maine saosnois (actuelle Sarthe), ainsi que Pennobrias vico, mentionné sur une monnaie mérovingienne de la collection Alfred Manuel (Nevers), correspondant à l’actuelle commune de Beneuvre, localisée à la frontière sud du territoire des Lingons, au carrefour d’axes protohistoriques reliant notamment la route de l’étain à celle entre Alésia et Langres [6].
Le sens du terme pennum s’est conservé dans l’Antiquité tardive et au haut Moyen Âge, comme en témoignent les gloses latines, qui le traduisent par caput (“tête”) [7].
3. LE TERRITOIRE BITURIGE ET LA SURVIVANCE DE LA LANGUE GAULOISE
Contrairement à une idée reçue que pourraient entretenir des esprits peu rigoureux, enclins à des conclusions hâtives, je ne suis ni un historien “régionaliste”, ni particulièrement attaché au Berry. J’éprouve même une profonde aversion pour les études régionalistes lorsqu’elles se caractérisent par un chauvinisme excessif ou des spéculations infondées. Il va donc de soi que je n’accorde au Berry aucun statut privilégié a priori en tant que possible foyer d’une survivance, aussi hypothétique soit-elle, du gaulois parlé au-delà du IIIe siècle.
Cela étant posé, il convient de souligner que les travaux les plus récents et les plus fiables s’accordent à reconnaître le maintien de filiations, de pratiques cultuelles et d’une certaine connaissance de la langue gauloise jusqu’au IVe siècle, ce qui constitue une survivance relativement tardive. La grande stèle funéraire et votive de Genouilly, conservée au Musée du Berry à Bourges et datée de la fin du Ier siècle, témoigne de la persistance des divinités gauloises et des lignages — comme en atteste la mention du nom Ligurix — indépendamment de l’évolution des formes scripturaires, marquée notamment par le passage de l’alphabet grec à l’alphabet latin.
De même, le pilier gravé d’Argentomagus, daté du IIe siècle, provient d’un aménagement lié à la fontaine sacrée de Saint-Marcel, dans l’Indre qui, d'après les données numismatiques, a conservé sa fonction religieuse jusqu’au IIIe siècle, voire au-delà.
Toutefois, c’est l’étude paléographique de l’inscription découverte en 1848 sur un vase mis au jour à Séraucourt, près de Bourges, qui constitue l’élément le plus déterminant : elle a permis de dater cette dédicace rédigée en langue gauloise du début du IVe siècle.
En raison du caractère formel du texte, son interprétation est largement admise :
buscilla sosio legasit in alixie magalu (“Buscilla a offert ceci à Magalos dans Alixion”).
L’inscription découverte à Bourges constitue vraisemblablement l’un des derniers témoignages de l’usage de la langue vernaculaire gauloise au cours des décennies suivant l’an 300 de notre ère. Comme pour tout instrumentum, il convient de tenir compte des phénomènes de déplacement, ici suggérés par la mention d’Alixion. Toutefois, l’hypothèse la plus plausible est que cet objet ait été rapporté puis conservé à Bourges par une personne en mesure d’en comprendre le sens, condition nécessaire à sa présence dans un contexte funéraire.
Par ailleurs, une seconde inscription datant également du IVe siècle a été mise au jour en Berry. Il s’agit d’un texte peint sur un vase en céramique, découvert en février 1949 dans une nécropole gallo-romaine située au lieu-dit Bussiou, le long de la route reliant Étréchy à Jalognes.
L’interprétation de cette inscription gauloise reste sujette à débat. En tout état de cause, sa morphologie est latine:
“etiona carantanae isosae gnato hidvae mercvri[o] m[-?-]ortivmni“.
Elle constitue donc un témoignage non de la survivance du gaulois au-delà du IVe siècle, mais de son crépuscule en Berry à cette époque.
4. SAINT ESPIN, MARTYR IMAGINAIRE DU IVe SIECLE et LA VILLA GERMANIACO
Le nom Expennus, à l’origine des formes Espin ou Epain, a été rattaché par nous au thème penno, que les gloses latines traduisent par caput (“tête”) ou eminentia (“hauteur”), selon qu’il apparaît dans un anthroponyme ou un toponyme. Partout, le martyre de saint Espin — présenté comme une décapitation infligée par des “païens”, suivie de l’apparition d’une source miraculeuse — est traditionnellement daté du IVe siècle. Cette datation concorde de manière significative non seulement avec les premières phases de l’évangélisation et les stratégies pastorales de substitution, mais aussi avec l’extinction progressive de la pratique orale du gaulois — phénomène qui, loin d’être une conséquence directe de l’évangélisation, en constitue plutôt un préalable et un facteur facilitateur.
Le nom d’Expennus apparaît dès le haut Moyen Âge à Germigny, localité d’une villa wisigothique, puis mérovingienne dépendant de l’Église d’Orléans. L’Ecclesia Aurelianensis, en effet, s’est organisée dès le IVe siècle, une centaine d’années environ avant l’établissement d’un archevêché biturige : Declopetus, évêque d’Orléans, siège au concile de Sardique en 343, tandis que l’Église de Bourges ne fait l’objet d’une mention explicite qu’à partir de Léon, son premier métropolitain attesté, présent au concile d’Angers en 453. Etant donné ce contexte, il ne fait guère de doute que le culte d’Expennus est une importation en provenance de l’Ouest.
La référence à la tête suggère un lien symbolique entre le thème penno et la décapitation de ce saint fictif. Chez les populations gallo-romaines récemment christianisées, le souvenir des exécutions païennes par décollation demeure vivace. Bernard Dedet en fournit plusieurs exemples, évoquant notamment des représentations sculptées de têtes coupées sur des stèles, la persistance de ces motifs dans des temples transformés en églises, ainsi que des trophées crâniens momifiés, ultérieurement reconvertis en reliques, ou encore l’absence de crânes dans certaine sépultures religieuses du nord de la France.
Sur ce dernier point, un élément particulièrement remarquable mérite d’être signalé :au cours d’excavations sans rapport avec l’archéologie effectuées à l’emplacement du parvis de l’église Notre-Dame de Germigny, un sarcophage de pierre contenant un squelette dépourvu de crâne aurait été mis au jour, selon le témoignage direct d’un observateur ayant assisté à la découverte. Pour éviter des complications administratives, m’expliqua le bedeau de l’époque (un certain Groux), la découverte fut étouffée.
5. PERSISTANCE DU PAGANISME ET ISOLEMENT DE LA VALLEE DE GERMIGNY
Il convient de mentionner ici l’hypothèse développée il y a quelques années par Nathalie Le Luel, selon laquelle le personnage d’Ursin, saint fondateur imaginaire du siège épiscopal de Bourges, aurait été inventé afin d’effacer la mémoire d’un ancien culte païen de l’ours en Berry. Cette théorie - très spéculative, voire improbable - a été accueillie avec ironie par les quelques spécialistes à qui j’ai eu l’occasion de l’exposer. Néanmoins, elle présente l’intérêt de souligner que le contexte historique et religieux du Berry peut effectivement se prêter à ce type d’interprétation.
Jusqu’à la fin du IVe siècle, les cultes païens demeurent particulièrement vivaces dans cette région, attestant ainsi la diffusion encore limitée du christianisme. En 386, lors de son passage par le Berry pour se rendre à Vienne, dans la vallée du Rhône, afin de rencontrer Paulin de Nole, saint Martin constate à Levroux l’intensité du culte rendu dans un “riche temple païen”. Il fait alors appel à la légion impériale pour contraindre la population à en assurer le démantèlement. Le récit de cet épisode, rapporté par Sulpice Sévère, bien qu’atténué par une rhétorique édifiante, ne laisse guère de doute quant à la brutalité toute militaire de l’opération.
L'anecdote révèle en outre un point qui n'est jamais soulevé: du point de vue chrétien, le Berry se situe alors dans la sphère d’influence culturelle de la Touraine, d’où, précisément, la légende de saint Epain est originaire. Enfin, s’il est une région où les pratiques religieuses païennes et la langue gauloise ont pu perdurer plus longtemps qu’ailleurs, la vallée de Germigny, avec son sol hostile, noyée dans les marécages et envahie de taillis inhospitaliers, en offre un exemple particulièrement plausible. Éloignée du chef-lieu de cité, à l’écart des grands axes de communication, cette zone périphérique, difficile d’accès, se caractérise au IVe siècle par des terres peu fertiles, une culture incertaine et un habitat rare et modeste.


6. LE BOURBONNAIS EST EN BERRY
Il devrait être superflu de rappeler que le Bourbonnais et le Haut-Berry, dans une certaine mesure, relèvent d’un même ensemble historique. L’actuel Bourbonnais, ramené artificiellement aux dimensions du département de l’Allier, constituait en réalité une fraction de l’ancienne cité des Bituriges. La très ancienne famille autochtone des Bourbons, connue dès le haut Moyen Âge comme “chevaliers du Berry”, reçoit dans les premières années du Xe siècle, de la part des Guilhemides, une série de vigueries situées en Haut-Berry. Ces possessions formeront le noyau initial de leur future principauté.
L’extinction de la dynastie des Guilhemides, survenue à la fin du premier tiers du Xe siècle, offre aux sires de Bourbon l’occasion d’étendre leur influence. Ils tirent parti de l’appel lancé par l’évêque de Bourges, Dagbert — lui-même issu de la famille des Bourbons —, pour défendre le diocèse contre les ambitions territoriales de Landry, comte de Nevers. C’est armés de ce prétexte qu’ils investissent le sud-ouest de l’actuel département du Cher, qu’ils finissent par intégrer à leur principauté.
Voici pourquoi, bien que les dénominations utilisées soient historiquement anachroniques, on observe dans la région du “Bourbonnais”, qui relie la Champagne berrichonne aux contreforts volcaniques de l’Auvergne, la présence de divinités gauloises associées aux sources thermales et particulièrement vénérées des Bituriges. Parmi elles figurent Nérius, divinité tutélaire de Néris-les-Bains (Neriis Aquis, “aux eaux de Nérius”), ou encore Borvo, dieu des eaux bouillonnantes, dont le culte est attesté à Bourbon-l’Archambault.
Pour nous, comme nous l’avons déjà signalé, il ne fait guère de doute que le personnage du “bervat” englouti par une source ou une fondrière bouillonnante se rattache à la même racine étymologique.
7. BOURBIERS ET FONDRIERES: DE LA BOUE QUI GUERIT A LA BOUE QUI PUNIT
Il est parfaitement documenté, depuis très longtemps, que les fontaines bouillonnantes et les bourbiers ont la même racine étymologique, ce qui se comprend parfaitement quand on fréquente physiquement les terrains des sources naturelles. La bourbe désigne en langue gauloise une "boue noire comme celle des marais, des étangs" (FEW 1 , 442b). C'est un "lieu boueux où l'on s'enlise" (Pierrette Dubuisson, Atlas linguistique et ethnographique du Centre, t . I , 37, 1971). On connaît, en Berry, les Bourbiers, ruisseau de Santranges, dans le Pays Fort qui constitue la partie supérieure du quart nord-est du département du Cher, immédiatement au nord de la Vallée de Germigny, ou, toujours en Berry, les Bourbiers sur la commune de Cléré, les Bourbiers, sur la commune de Diou, le Champ du Bourbier, sur la commune de Heugnes, le Pré des Bourbiers, sur la commune de Buzançais, le Champ Bourbé, sur la commune de Montgivray (voir, pour un inventaire, Stéphane Gendron, spécialiste de la toponymie, dans Les Noms de lieux de l'Indre, Centre de recherches, d'études et documentation de l'Indre, 2004). On trouve également "Borboux" à Liège où il signifie, dans le dialecte wallon borboû un "bourbier dangereux , une fondrière" (Jules Herbillon et Jean Germain, Dictionnaire des noms de famille en Belgique romane et dans les régions limitrophes, Crédit Communal, 1996).
Si le gaulois "borvo" est à l'origine de plusieurs noms de lieux liés à des sources thermales, telles que Bourbon-Lancy et Bourbonne-les-Bains, où des boues médicinales étaient utilisées de toute antiquité, il est aussi à l'origine du bourbier qui a certainement – forcément ? – pris dès le départ un sens figuré péjoratif en parallèle. Ainsi, le mot "bourbier" a acquis très tôt un sens abstrait en français: au XVIᵉ siècle, par exemple, Pierre de l'Estoile (1546-1611) définit "bourbier" dans son Journal du règne de Henri IV comme une "situation infâme, une infamie, une abjection". La Renaissance, d'ailleurs, n'ignore rien des étymologies comparées à ce sujet. Elle sait que le grec βορβόρος signifie "fange, bourbier, cloaque, ordure". Selon le lexique de Maine et Chéradame, βορβόρος se traduit par "cænum, cloaca"; Conrad Gessner (1516-1565) confirme: "cænum, lutum, limum, cloaca". C'est au point que les étymologistes du XVIᵉ s. proposent tous de rattacher au sens connu en grec celui du mot hérité du gaulois: selon Guillaume Postel, "βορβόρος, bourbe, cænum"; pour Joachim Périon, "βορβόρος, lutum, cænum, Gal. borbier". Comme le signale Pierre Costes dans sa thèse d'Etat sur Martigues, "le débouché vaseux de l'étang de Caronte" tirait son nom de caenum, équivalent de βορβόρος, parce que c'était un bourbier. Tous ces mots ont, soit en grec, soit en latin, un sens figuré péjoratif qui ne pouvait pas faire défaut au gaulois. La punition par le bourbier, qui peut aussi bien fournir la matière première aux illutations curatives qu'engloutir un être maudit dans sa souillure sacrilège, trouve sa synthèse dans l'idée même de sacré. Mais nous n'allons pas paraphraser ici les travaux de psychologie historique de Vernant auxquels nous renvoyons.
8. SURVIVANCES DU GAULOIS ET PATOIS BERRICHON
Une fois écarté le dialecte occitan du Croissant, dont la situation linguistique est spécifique, il est permis d’affirmer que le parler berrichon ne constitue qu’une variante du dialecte du Bassin parisien, sans caractéristiques remarquables ni singularités notables. Il n’y subsiste pas davantage de traces de la langue gauloise qu’ailleurs en domaine d’oïl, c’est-à-dire pratiquement aucune.
Pour avoir passé une partie de mon enfance au contact de paysans âgés dans l’Orne, je n’ai rencontré aucune difficulté à comprendre ceux du Berry, ce qui donne la mesure de la faible originalité linguistique de cette région. Les enregistrements effectués en 1966 à Épineuil-le-Fleuriel (Cher) par Jean-Gabriel Albicocco, dans le cadre de l’adaptation cinématographique du Grand Meaulnes, illustrent parfaitement cette réalité : le parler y apparaît comme une forme de français tout à fait standard, simplement teinté d’un accent rural.
Deux éléments supplémentaires méritent d’être soulignés. D’une part, ce parler n’a pas donné lieu à une tradition littéraire significative : il ne possède ni corpus, ni auteurs reconnus. D’autre part, on observe en Berry, paradoxalement, une grande élégance de la langue ordinaire, fruit d’une histoire profondément marquée par la culture lettrée.
En effet, le Berry n'a jamais été une province. Intégré précocement au domaine capétien, dès le règne de Philippe Ier, il est devenu, pendant plusieurs siècles, un creuset de fusion des influences les plus civilisées d’Europe. Le duc de Berry, notamment, fit venir dans la région les plus grands artistes européens dans l’ambition de transformer son duché en véritable foyer de rayonnement artistique et intellectuel, et plus tard, l’Université de Bourges, qui joua un rôle majeur dans la renaissance du droit, attira des étudiants et des professeurs venus d’Écosse, d’Allemagne, de Suisse et d’Italie.
Dans ces conditions, il serait vain de rechercher, à quelque époque que ce soit, une langue régionale spécifiquement “berrichonne”. La preuve formelle de cette absence d’originalité linguistique est administrée au XIXe siècle par la baronne Dudevant — alias “George Sand” —, figure emblématique d’un certain parisianisme néo-rural, qui dut inventer de toutes pièces une langue pseudo-paysanne, largement artificielle, pour ses personnages, dans un but de pittoresque destiné aux salons mondains. Ce recours à une fiction linguistique en dit long évidemment sur la totale indifférence de la baronne Dudevant pour le Berry réel, mais surtout sur l’inexistence d’un dialecte berrichon original.
CONCLUSION
En résumé, la survivance d'une pratique de la langue gauloise au-delà de l’an 500 est pour moi tout à fait exclue. En revanche, il ne fait guère de doute que le gaulois a été parlé et compris jusqu’au IVe siècle, en particulier dans des zones marginales et reculées du Berry, telles que la vallée de Germigny — époque qui correspond vraisemblablement à l’importation de la légende de saint Espin. Il est plus que probable, en effet, qu’à cette période, non seulement la villa Germaniaco appartenait déjà à l’Église d’Orléans, mais encore, comme le montre l’intervention de Martin de Tours à Levroux, que la région était dans la zone d’influence culturelle de Tours.
Par ailleurs, il est établi que le terme penno était parfaitement identifié par les glosateurs latins et demeura intelligible pour les clercs au moins jusqu’à l’époque carolingienne, voire jusqu’au Moyen Âge central, comme le suggèrent certains cas, notamment celui du moine flamand Sigebert de Gembloux († 1112).
Dans ce contexte, rien ne s’oppose à l’hypothèse d’un transfert symbolique ou narratif de la légende primitive vers celle des cloches. Enfin, comme cela a été précisé, le mot bervat ne relève en rien d’un prétendu “vocabulaire berrichon” ; il n’existe pas de dialecte autonome en Berry. Avec “bervat”, nous tenons très clairement un vestige lexical d’origine gauloise, dont le sens peut être éclairé à travers l’analyse conjointe de la mythologie comparée et du contexte géotechnique.
NOTES (LES NOTES NE SONT PAS PUBLIQUEMENT VISIBLES – ELLES SERONT PUBLIEES DANS UN OUVRAGE A VENIR)
BIBLIOGRAPHIE
Emmanuel Legeard, Histoire du Berry, Gisserot, coll. Histoire, 2024.



