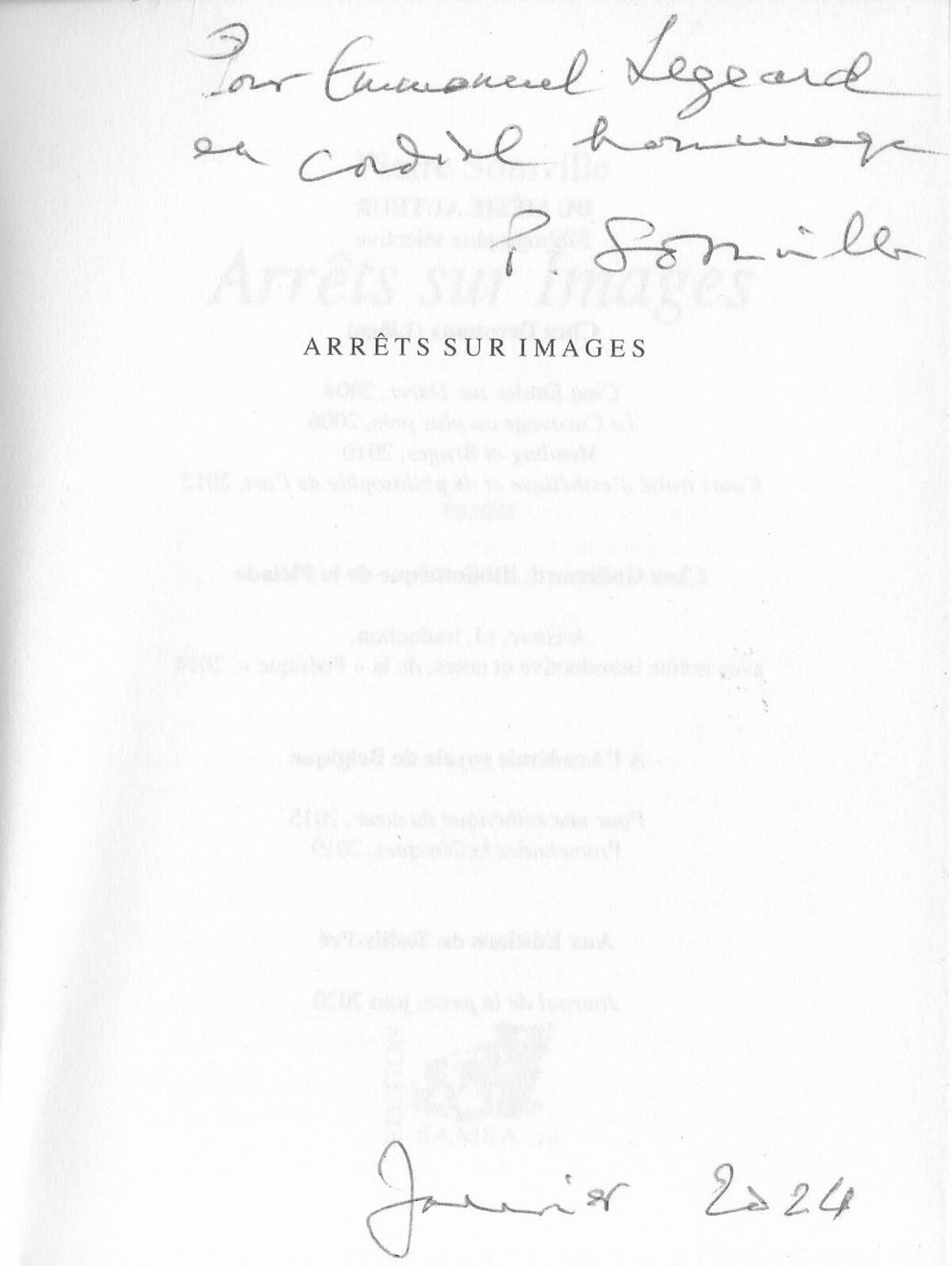
Agrandissement : Illustration 1
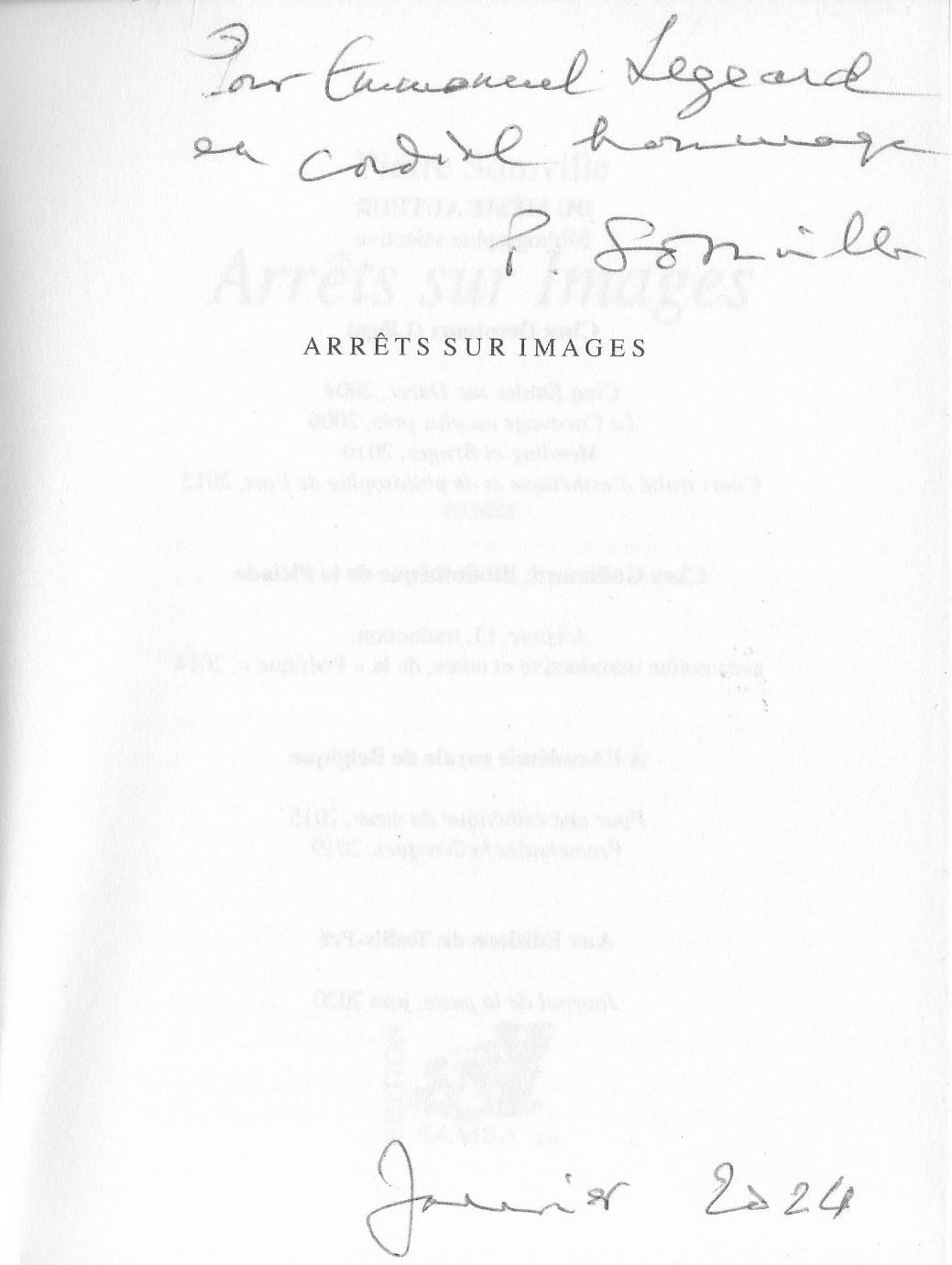
Chez Pierre Somville, tout se ramène toujours au ciel, au soleil, à la mer, mais ceux-là ne se séparent jamais de l'irréductible altérité qui les accompagne, de cette mystérieuse puissance de transfiguration à l'œuvre dans "l'insondable renaissance des formes". Des falaises du golfe de Salerne à celles de Rügen, des raz-de-marée de la Crète aux tsunamis du Japon, la mer est cette immensité dont les vagues nous submergent et qui ouvre aux plongeurs mystiques ses gouffres vers l'outre-monde. L'hippocampe d'une stèle étrusque, l'horizon vaporeux de la Baltique suggèrent ce mystérieux passage maritime vers l'au-delà, tandis que nous poursuivons, roulant vers l'Orient ou rampant sous les terrasses évacuées des villes du grand Sud, les soleils noirs qui hantent les labyrinthes de la Crète et irradient les auberges de la vallée d'Ajalon. Osiris ou Dionysos démembrés, fusion des crépuscules, les soleils spirituels de l'outre-monde terrassent nos ombres et nous frappent, proprement, de sidération; telle est la condition de l'émotion véritable, celle non d'une agitation, mais au contraire d'une suspension du mouvement capable d'ouvrir la relation de l'être au monde. Car il y a un grand abîme. Cur est magnum chaos.
Tout se passe en effet comme si, chez Pierre Somville, le monde était sous-tendu par quelque chose de semblable au Néant d'étant de Heidegger ou au néant mystique des théologies négatives, à ce Tout-Autre antérieur à toute détermination qui se confond aussi avec l'apeiron de Parménide et le Chaos primordial d'Hésiode. Implacablement, inexorablement, c'est à notre finitude tragique que nous renvoient chez Somville le ciel, le soleil et la mer. Le plongeur de Paestum ne remontera pas des abysses, l'Icare de Brueghel s'est abîmé dans les flots avec le soleil qu'il poursuivait, quant au blond fantôme de bénédictin de Caspar David Friedrich, sanglé dans sa tunique noire et tout droit surgi des ruines gothiques de l'abbaye de Greifswald, il campe face à la mer toujours recommencée la vanité de toute réflexion sur l'au-delà: "Vergeblichkeit des Nachsinnens über das Jenseits"! Le dernier ouvrage de Pierre Somville, Arrêts sur images, ne déroge pas à la règle. L'Auteur a recueilli en une séquence apparemment arbitraire des notes éparses sur des images disparates qui vont d'un bas-relief funéraire d'Etrurie aux peintures de Magritte en passant par les paysages du peintre de Rügen. Et cependant, pour les familiers de P. Somville, ces fragments sont secrètement reliés par des lignes de force qui commandent le développement de sa pensée. Ils sont semblables à ces perles de verre qu'il passait, enfant malade, sur un fil pour se distraire. Nous ne retiendrons ici qu'une petite sélection de ces "arrêts sur image" particulièrement évocateurs.
Dans "Contre-jour à l'auberge" (p.56), Pierre Somville analyse la fameuse huile sur panneau des Pèlerins d'Emmaüs exécutée vers 1628 par Rembrandt et conservée aujourd'hui au musée Jacquemart-André. L'interprétation toute personnelle de l'Auteur est d'autant plus intéressante que je ne la partage pas du tout, ce qui me permet de soustraire de la description les éléments constitutifs d'une émotion proprement "somvillienne". Ainsi P. Somville voit-il une échelle là où je vois une chaise à trois pieds, tandis qu'il affirme l'absence du second pèlerin, que je distingue nettement quant à moi, prosterné dans les ténèbres du premier plan aux pieds du Christ ressuscité: il embrasse les plis de sa tunique.[1] C'est bien ce disciple qui, se jetant à terre sous l'effet de la fraction du pain et de la parole prononcée, a renversé sa chaise. Prosaïquement, j'imagine une lampe posée sur la table derrière le Christ qui nous le fait apparaître sous la forme d'une ombre, désincarné donc, ayant rejoint l'unité glorieuse avec le Père. Mais Pierre Somville ne considère pas du tout les choses de cette façon. Pour lui, le Christ est une figuration du "soleil noir" "sécrétant autour de lui sa propre auréole", d'où l'aura de l'œuvre, pour parler comme Walter Benjamin, qui nous ferait ressentir avec une acuité prononcée notre exclusion de ce monde sacré, pour nous inhabitable, la "proximité d'un inaccessible lointain". Visiblement, l'Auteur éprouve le même sentiment que devant un Magritte ("Sur un Magritte et un Dali", p.181) qui "peut aussi atteindre à la véritable angoisse métaphysique: l'incommunicabilité qui s'installe entre l'œil et l'objet représenté, parfaitement clos et inaccessible (vraiment "ceci n'est pas une pomme" puisqu'on ne peut y puisqu'on ne peut y habiter)" et "la perfection figurative des fragments de réalité représentés sur la toile, alliés à l'éloignement qui nous les rend inaccessibles sous leur vernis", constituent pour lui un "sommet de voyeurisme et d'irréparable frustration".[2] Face à Rembrandt, et par contraste avec Cléopas (et non Cléophas), le disciple frappé de stupeur, Pierre Somville s'identifie ainsi au pèlerin "sans nom", donc "sans place" dans cet au-delà transcendant d'Emmaüs. Sans doute, si l'Evangile ne cite que le nom de Cléopas, l'autre n'est pas précisément un "anonyme" pour la plus antique tradition de l'Eglise, celle qui très visiblement remonte à la secte judéo-chrétienne des Nazôréens, et qui a, depuis peut-être deux millénaires, identifié son compagnon à saint Luc. Mais cela importe peu, car P. Somville veut nous faire comprendre autre chose qui finalement est sans rapport avec le christianisme: c'est que nous n'habitons que le monde où nous avons un nom.
Dans "Encore une Chute d'Icare" (p.161), la question du nom revient avec celle, implicite, du soleil noir. P. Somville tient absolument à ce que Brueghel le Vieux (1525–1569) soit l'auteur de cette huile sur toile (la Chute d'Icare), attribution périlleuse car rien n'est moins assuré, et un critique malgracieux pourrait même affirmer que tout indique le contraire. Mais qu'à cela ne tienne. Encore une fois, qu'elle soit de Brueghel importe peu. Ce qui compte, c'est comment Pierre Somville métabolise cette œuvre pour l'incorporer à sa propre substance, quelquefois - comme avec Rembrandt - avec une désinvolture toute aristocratique envers de vulgaires scolies qu'il rejette hors de ses préoccupations, surtout celle formulée par Léopold Kockaert, pourtant le plus fervent partisan de la paternité breughélienne, qui rappelle que le soleil à l'horizon, produit d'un "repeint grossier", est "une anomalie dérangeante". Reconstituant le contexte, Pierre Somville commence par évoquer le cadre ovidien: Dédale et Icare se sont évadés à tire-d'aile du labyrinthe de Cnossos. Icare, négligeant les avertissements de Dédale qui l'invite à respecter une voie aérienne à mi-distance du soleil et de la mer, voit fondre la cire de ses ailes et tombe dans l'océan. L'analyse prend une tournure intéressante quand l'Auteur établit une analogie entre le coucher du soleil sous l'horizon de la mer Egée et le plongeon d'Icare "dans une gerbe de plumes et d'écume". Il est curieux même qu'à ce propos il n'évoque pas, lui le nietzschéen, deux ou trois des phrases du prologue de Zarathoustra que nous sommes nombreux à connaître par cœur:
"Dazu muss ich in die Tiefe steigen: wie du des Abends tust, wenn du hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt Licht bringst, du überreiches Gestirn! Ich muss, gleich dir, "untergehen", wie die Menschen es nennen, zu denen ich hinab will." [3]
Avec l'observation que le pêcheur, le berger, le laboureur sont des témoins manqués de la Chute d'Icare, le commentaire de P. Somville se précise. Ces figurants sont exclusivement absorbés dans la médiocrité de leurs tâches utilitaires, en tout cas aveugles à l'exploit surhumain comme à sa punition divine. Aveugles, ils le sont en effet, le regard tourné vers le sol, ou le nez en l'air, mais l'air absent. Aveugles comme la cuisinière d'Emmaüs, affairée devant ses fourneaux, qui tourne le dos à la vraie lumière. N'est-ce pas le thème de la caverne de Platon qui se profile ici? A moins d'être un saint ou un héros, capable de regarder un instant la lumière en face, un tropisme antisolaire nous oblige à tourner le dos à la source qui pourtant éclaire le monde devant nous. Caspar David Friedrich en a conscience qui nous montre invariablement de dos ses spectateurs de la nature, comme nous regardons l'Esprit se projeter sur ses toiles dans un instant éternellement suspendu. Le labyrinthe de Crète et la caverne de Platon ont une parenté lointaine. Dans le temps cyclique des Grecs qui ignore l'extase temporelle, eschatologique, des chrétiens, l'évasion du labyrinthe symbolise l'extase spatiale, l'ouverture sur l'Ailleurs absolu où l'intuition du Tout-Autre est donnée à l'homme. Le taureau au centre du labyrinthe est "comme un emblème de force vitale ou une incarnation solaire (de soleil noir). Parèdre mâle de la Grande-Déesse ou double sombre, figuration du Zeus préhellénique ou de ce Dionysos primitif signalé dans les tablettes mycéniennes en linéaire B, et dont se souviendront encore les Bacchantes d'Euripide, le taureau crétois doit avoir revêtu maints aspects." [4] Le fait est qu'il y a deux moyens de sortir du labyrinthe. Celui qu'emploie Thésée, le héros civilisateur, et celui de Dédale, le thaumaturge qui par sa maîtrise technique proprement humaine défie les lois de la nature et s'attribue les privilèges des dieux - en l'occurrence, se libérer de la pesanteur. Bref, deux moyens: en liant ou en déliant - par le retour à la vie ou par une issue fatale. Icare a payé l'hubris de son père en y ajoutant l'audace de l'irréflexion. Mais, comme le suggère P. Somville, le XVIe siècle basculant dans l'idéal faustien pourrait bien voir dans cette chute d'Icare attribuée à Brueghel le symbole admirable de l'homme animé du désir de comprendre et de transformer le monde. Après tout, c'est à la même date exactement que Christopher Marlowe publie sa Tragicall History of the Life and Death of Doctor Faustus où l'Angleterre élisabéthaine s'accorde à reconnaître le vieux mythe d'Icare.
Le dernier arrêt sur image, "Caspar David Friedrich, peintre de l'infini", donne à la couverture son illustration: il s'agit des célèbres "Kreidefelsen auf Rügen", un choix nécessairement révélateur où nous retrouvons encore l'idée de plongeon. Deux détails au moins, qui ne sont pas relevés par l'Auteur, doivent être évoqués. D'abord l'aspect pariétal du cadre, qui précisément nous ramène à la caverne. Ensuite, les trois personnages sont absorbés dans trois différents types de visions qui présentent une parenté saisissante avec ce que dit Pierre Somville des personnages de la Chute d'Icare. Mais laissons pour aujourd'hui ce sujet en suspens et concentrons-nous sur Caspar David Friedrich. Friedrich s'est opposé au rationalisme profane - et vivement ressenti comme profanateur - des philosophes des Lumières qui prétendaient éclairer scientifiquement le monde en le réduisant à une vaste mécanique d'objets sans âme. Mais il s'oppose de même à l'alibi stérile de la transcendance: "Vergeblichkeit des Nachsinnens über das Jenseits"! Pour lui, le divin est immanent au cosmos et à la psyché créatrice de l'artiste, ce qui signifie aussi que l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est à l'artiste que revient la tâche d'éclairer le monde grâce à son génie, c'est-à-dire à l'intuition divinatrice, seule capable de jeter dans l'âme la vraie lumière. C'est pourquoi il n'y aurait aucun sens, pour Friedrich, à planter son chevalet dans la nature comme les peintres de Barbizon. La mimésis n'entre que secondairement en jeu ici; c'est de méthexis qu'il s'agit, d'une participation de l'art à l'essence divine. Car si la nature est une révélation, l'art est un phénomène parallèle: l'artiste agit à la manière de la nature. Visionnaire, il capte l'inspiration créatrice qui va révéler par l'image l'Esprit à l'œuvre dans l'intimité de la nature vivante, le souffle vital qui communique au paysage son aura de sacré. Quand Friedrich déclare que "Le divin est partout, même dans le grain de sable" et qu'il "l'a montré une fois dans les roseaux", il rappelle assez que son ambition n'est pas de représenter des formes, mais le divin qui est un principe immanent - et non transcendant - à la Nature ("Das Göttliche ist überall, auch im Sandkorn, da habe ich es einmal im Schilfe dargestellt"). Le sacerdoce du peintre, Friedrich en énonce clairement les termes: "l'homme noble reconnaît Dieu en toute chose, tandis que l'homme commun ne voit que la forme et non l'esprit". C'est par une vision spirituelle, les yeux clos, les yeux grand fermés, que Friedrich reçoit l'image de son tableau: "Sentir l'esprit de la nature, le pénétrer, le recueillir, le restituer du plus profond du cœur et du "Gemüt", voilà le rôle d'une œuvre d'art."
Dans une forêt, un horizon marin de Friedrich, P. Somville décèle par intuition la nature du sacré. Il écrit ailleurs, de façon plus générale: "On croit toucher un instant l'infini, voir apparaître un dieu, immanent ou transcendant […] le monde et l'homme restent le lieu ou les lieux de cette épiphanie." Face à la finitude du mortel et à son insignifiance dans l'univers, à cette "dérision" de nos vies, l'art nous donne des images assez fortes pour nier notre néant. "Image circulaire", "horizon diamétral", "ouverture de l'espace", "nuit transfigurée", "illimité": à propos des Kreidefelsen, Pierre Somville a recours à tout un vocabulaire suggestif évoquant avec force le Chaos d'Hésiode ou l'apeiron - où Pierre Somville, à l'instar de Castoriadis, voit une rationalisation du Chaos d'Hésiode - comme principe de spatialisation de l'intime, cet illimité, "Néant d'étant" en deçà de toute détermination. Il écrit, page 206:
"C'est la ligne d'horizon qui est le point le plus sensible de la composition. Ici elle est très haute, aux trois quarts de l'image circulaire, comme un tremblé diamétral. Nous sommes dans l'ombre, nous nous perdons et nous retrouvons dans la vibration lumineuse d'une ligne d'horizon qui ouvre l'espace vers un tremblé de nuit transfigurée. Si le regard et l'âme touchent à cet illimité, etc."
L'horizon annonce le Chaos, cet "entre-deux", ce "between" comme l'écrit Drew Hyland [5], première dimension de l'étendue. Image de l'infini, l'horizon est la ligne qu'on peut indéfiniment prolonger dans les deux sens, ligne indéfinissable en perpétuel retrait, ligne à la fois de séparation et de jonction, de fermeture et d'ouverture, horizon de l'avenir irréductiblement différé qui ouvre l'abîme du temps et suscite l'attente et l'attention, symbole enfin de l'infini au sens d'inachevé, car tout peut surgir sur cette ligne qui est à la fois suture et béance. L'horizon est ce rien d'espace mitoyen sur fond de quoi les couples de contraires de la théogonie d'Hésiode peuvent se déployer. C'est le mystérieux "pli dans l'espace" auquel Jean Ray, le maître belge du "fantastique réel", attribue l'épiphanie d'épouvante de ses revenants de l'Olympe. Or c'est précisément à cette idée de Chaos que se rattache le motif du Wanderer dont parle Pierre Somville puisque que tout Wanderer est, par usage et vocation, un "Wanderer-zwischen", un solitaire condamné à l'errance de l'entre-deux: entre deux mondes, entre deux réalités, entre deux soleils. De Beowulf, le chevalier errant, au Vaisseau fantôme de Wagner qui accoste dans la baie d'une côte hérissée de falaises à la Rügen, du Golem de Prague au monstre de Frankenstein - autant de "Wanderer": l'homme-ours, entre paganisme et christianisme, tiraillé entre ses deux natures, le mort-vivant, la créature révoltée arrachée au soleil noir de la prima materia… L'Ombre du Wanderer ou le spectre du revenant sont à l'image de notre échec devant l'infini: "das ist unser Los, an der Unendlichkeit zu scheitern" déclare Nietzsche par allusion à ces rivages de l'Inde où Colomb n'est jamais arrivé. Le moine de Friedrich n'est pas loin: "Vergeblichkeit des Nachsinnens über das Jenseits !"
C'est la grande leçon de l'Antiquité que les Allemands ont retrouvée; le monde est la seule réalité, il se suffit à lui-même et il suffit aux forts. Le Wanderer est un habitant de la Terre, un "Erdbewohner", dont la vie est traversée par le pli primordial. Il entretient en lui-même un déchirement qui, le reliant à la béance originelle et au Néant, lui ouvre aussi ces portes de la perception par où les "intimités" communiquent. C'est ici que le "Gemüt" joue son rôle de centre intégrateur réalisant malgré tout l'unité vivante de l'homme tel qu'en lui-même, et disposé à l'illumination intérieure. Dans ce contexte, Pierre Somville n'a pas tort d'invoquer Hegel, puisque l'histoire trahit, dans la radiance des événements, dans la "Verklärung", la réalité de la présence à travers la représentation.[6] C'est toujours, en effet, au prix d'un retrait de l'Être qui est flamboiement et combustion instantanés que l'image acquiert sa singularité rayonnante et son caractère suggestif d'un Ailleurs absolu. L'événement a lieu, et cet avoir-lieu est, comme son nom l'indique, une appropriation de l'espace vécu: le lieu fait lien.
Nous voici maintenant plus proches encore de l'aspect "érotique" de la théogonie d'Hésiode que de la Phénoménologie de l'Esprit. Evidemment, l'Eros dont il est ici question est sans aucun rapport avec le désolant réductionnisme des freudiens et leur pansexualisme incestueux. Ce n'est pas Eros qui est une allégorie de l'activité sexuelle, mais au contraire l'activité sexuelle qui est une métaphore, et une métaphore réductrice de l'activité d'Eros dont elle n'est qu'une modalité mineure. Etymologiquement, l'Eros renvoie à l'idée de frontière, de découpage, d'appartenance, à l'idée de ce qui nous est imparti, attribué en partage, à ce qui nous fonde en propre. [7] Nous entrons donc dans le registre non seulement de la séparation propre à la pensée théogonique, mais encore de la liaison organique, du liement qui fondamentalement distingue les forces infinies de la nature vivante d'avec le Chaos sans liens: car c'est avec l'émergence de la terre que les liens se nouent. L'ousia qui, à l'origine, ne sépare pas l'être de l'avoir, et définit l'un par l'autre, c'est-à-dire ce qui est par ses propriétés [8], l'ousia ne se manifeste, grâce à l'Eros, qu'en s'opposant au Chaos, "Néant d'étant", en-deçà de toute détermination.
Par l'image, toujours éminemment sacrée, le sculpteur ou le peintre détient une puissance d'émanation, celle susceptible d'invoquer la présence. Mais le sacré exige de pouvoir se tenir dans la clarté du mythe, il faut être soi-même un "Wanderer", comme Nietzsche avec son "oui sacré" (das heilige Ja-sagen), ou comme Friedrich ou, plus proche de nous, comme Michel Butor, avec La Modification ou Le Génie du lieu. [9] Pour le Wanderer de Friedrich, l'horizon de l'immanence contient le monde, au double sens du verbe contenir. Répondant, comme l'apeiron, à la figure du cercle et du lien, cette ligne infranchissable instaure la divine mesure qui donne à l'espace vécu son rythme, c'est-à-dire sa forme distinctive, sa figure proportionnée - rythme spatial qui permet justement de qualifier la composition du cadre tout en entretenant le sentiment, en dehors de la physique et du perceptible, d'un "infini hors cadre" qui déborde l'œuvre admirée: allo ti para tauta, "quelque chose d'autre en dehors de cela". A quoi bon essayer de se hisser à tire-d'aile vers le soleil à l'insoutenable incandescence? Ce n'est pas la voie de l'homme. Il faut, de même, renoncer à méditer sur un horizon qu'on ne peut atteindre. Seuls les dieux ne connaissent pas la finitude parce qu'ils tirent leur pouvoir, justement, du secret consistant, selon le mot de Skythinos de Téos, à relier le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga.
De ses tout premiers travaux philosophiques consacrés à Parménide, Pierre Somville a conservé une défiance marquée envers la critique qui sépare l'homme de la nature et des dieux, condition première de la pensée rationnelle et occasion du dédoublement qui en résulte: le discours se coupe de ce qu'il prétend décrire. A l'Eléate, il imputait la responsabilité d'un premier nominalisme qui serait venu froidement informer le réel. [10] C'est Parménide, en effet, qui à la doublure d'invisible de la nature vénérée, animée par des forces infinies, est venu substituer la pure abstraction où le logos triomphant pouvait réduire les êtres et les choses à de simples objets identiques à eux-mêmes. Il y a pour Pierre Somville, à l'instar de James Joyce, une chute originelle dans le langage qui est ressenti comme une négation et une limitation. Contre ce langage, face à cet art du silence qu'est la peinture, face à l'œuvre du peintre, homme d'avant la chute dans le langage, P. Somville cherche à restaurer la parole muette, celle du mythe, sous la censure permanente du discours rationnel. Pour "nier le Néant", un seul recours: l'image forte. Mais il n'échappe évidemment pas à l'Auteur que "l'homme et le monde sont les lieux de toute épiphanie". [11]
Il n'y a de révélation que pour l'Erdbewohner, celui qui habite la terre et réalise l'assomption de cet "avoir" qui nous enracine dans le monde. Une telle relation à l'espace, relation qualitative puisqu'elle est dictée par les qualités qui nous fondent en propre, est la voie d'une intensification de l'existence susceptible de transformer l'habere en habitare. Or c'est bien cette intensité qui fascine Pierre Somville, intensité incarnée par Icare et qui représente une sorte de revanche sur la brièveté de la vie. L'omniprésence de la mer n'est pas chez lui un hasard, car elle symbolise ce qui dépossède l'homme de tout, elle est l'image triomphante de la mort. La mort seule, la proximité de la mort, la fréquentation de la mort suscite en nous l'intensification de l'existence. Pour les romantiques allemands, cette fréquentation de la mort, naturelle au Wanderer, est compensée chez les "aristocrates de caractère" par une idiosyncrasie susceptible d'unir et de faire converger toutes les ressources de la personnalité grâce au Gemüt qui embrasse et surmonte les contraires: "Die eigentliche Lebenskraft der inneren Schönheit und Vollendung ist das Gemüt", écrit Schlegel. De même, dans un passage que je ne saurais plus situer, P. Somville rappelle que kalos signifie beau dans le sens de réussi. La condition d'une telle réussite, c'est de porter à son paroxysme l'intensité des liens propres qui nous rattachent à cette fraction du réel impartie par la naissance au monde. Qu'il s'agisse de l'Eros d'Hésiode ou de l'Ereignis de Heidegger, l'idée est finalement la même, celle de l'appropriation, acte fondateur qui polarise l'espace et lui donne une signification, et que seul peut assurer le recouvrement de la parole mythique: celle qui a le pouvoir de faire voir l'invisibilité du divin.
NOTES
[1] En 2013, Pierre Somville écrivait pourtant, plus fidèlement quant au nombre des disciples: "Devant les deux disciples ébahis, saisis en pleine lumière, à l'avant-plan règne un Christ d'ombre de qui, paradoxalement, irradie tout le feu, comme d'un terrible soleil noir". In: SOMVILLE, Pierre, "Caravage et caravagisme", in: Bulletins de l'Académie Royale de Belgique, 2013, vol. 24, no 1, p. 51–58.
[2] SOMVILLE, Pierre, Mimesis et art contemporain, Paris, Vrin, 1979, p.27.
[3] NIETZSCHE, Also sprach Zarathustra, Zarathustras Vorrede.
[4] SOMVILLE, Pierre. "L'Abeille et le taureau (ou la vie et la mort dans la Crète minoenne)". Revue de l'histoire des religions, 1978, p. 129–146.
[5] HYLAND, Drew, "First of All Came Chaos", Studies in Continental Thought ; Bloomington : Indiana University Press , 2006.
[6] Nuit transfigurée, certainement - "verklärte Nacht" - , non évidemment par allusion à l'exécrable mirliton qui a inspiré une scie musicale du même nom, mais en référence à la Théogonie d'Hésiode où l'union de la Nuit et des Ténèbres souterraines engendre contre toute attente le Jour (Héméra) et la transparence éclatante des plus hautes régions célestes (Æther).
[7] WEISS, Michael, "Erotica: On the Prehistory of Greek", Harvard Studies in Classical Philology, Vol. 98. (1998), pp. 31–61.
[8] SOMVILLE, Pierre et MOTTE, André, Ousia dans la philosophie grecque des origines à Aristote, Travaux du centre d'études aristotéliciennes de l'université de Liège, Louvain-la-Neuve, Peeters, 2008.
[9] Michel Butor, dans un entretien de 2016, m'avait appris l'existence d'un projet de téléfilm qui n'avait jamais vu le jour, adaptation de La Modification, et qui devait s'appeler : L'Enchantement ou L'Entre-deux. Je renvoie ici à notre entretien: Entretien d'Emmanuel Legeard avec Michel Butor.
[10] SOMVILLE, Pierre, Parménide d'Élée. Son temps et le nôtre, Vrin, 1976.
[11] SOMVILLE, Pierre, Pour une esthétique du cœur, Académie royale de Belgique, 2015.



