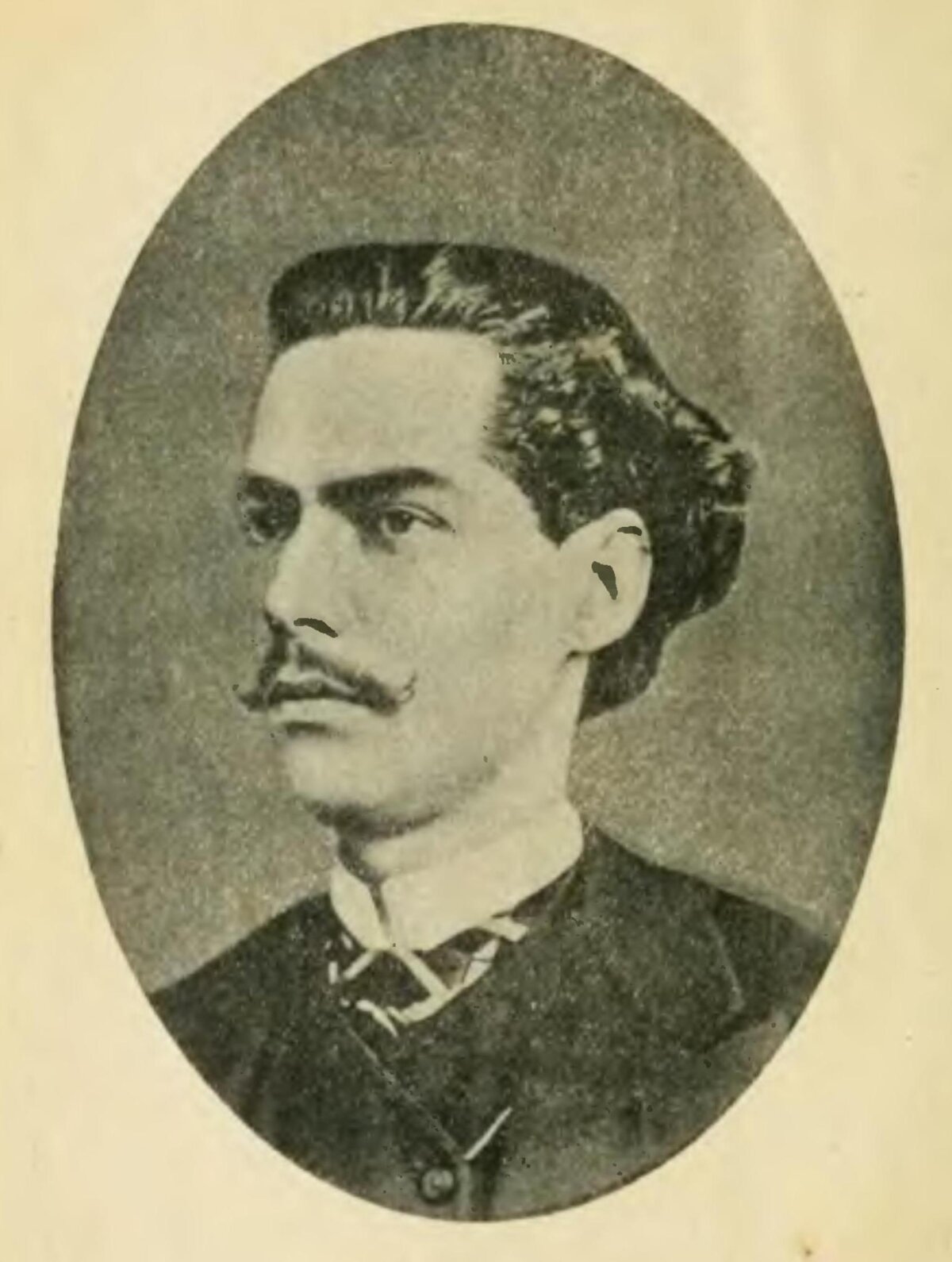
Agrandissement : Illustration 1
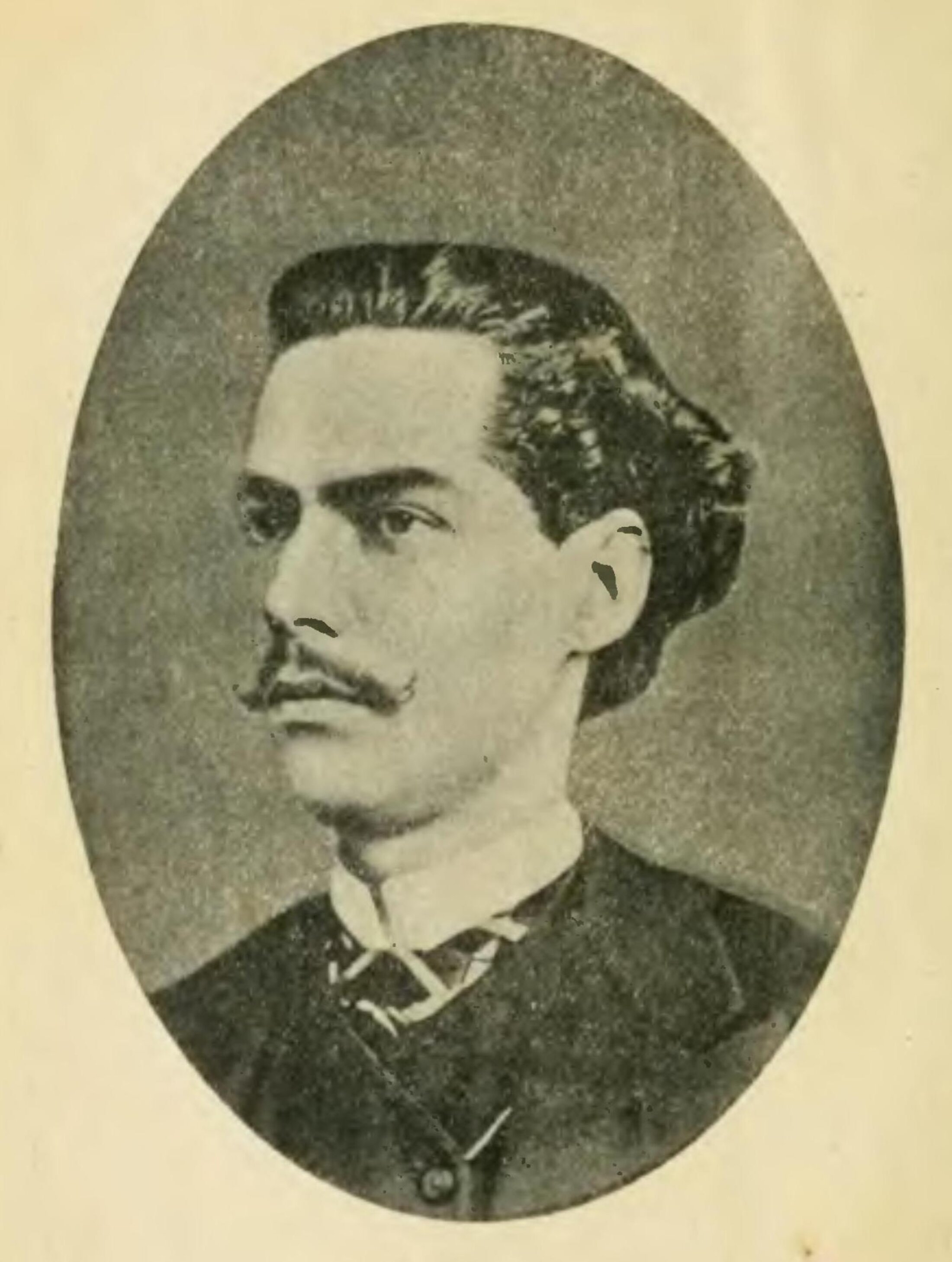
Adieu, mon chant
I.
Adieu mon chant, te faut partir !
L’océan du peuple s’assemble.
Enfant de la tempête et frère du rayon,
Il faut pousser ton cri dans le vent de tourmente
L’hiver tout engoncé dans son manteau de givre
A fait faner la rose
Rapportée de là-bas
La rose de l’amour
Hé, l’oiseau migrateur, vole et viens annoncer
Le printemps cent fois saint de la libération !
Te faut partir dans l’horizon
Faire tonner le cri errant de l’éclaireur
Debout lumière qui es étoile du peuple
Et comète funèbre de la tyrannie !
Adieu mon chant !
Sur la place où l’on se révolte
Résonne le clairon tremblant de la bataille
L’aigle, met-on ton aile en pièce ?
Drapeau, la mitraille qui roule
T’a-t-elle déchiré ?
Mais que t’importe à toi qui n’a point revêtu
Le manteau sybarite aux banquets de ce monde
À toi dont le beau front ignore le laurier
Mais qui as rejeté la couronne orgiaque
À toi qui, l’héritier d’une race affranchie
As revêtu le heaume et la cotte de maille
Et qui sur ton cheval galopant par le val
As guetté la comète qui donne l’alarme.
Il est temps de céder aux appels de la gloire
C’est la lutte, la lutte
C’est la terrible forge
Qui reporte au creuset le bronze des statues
Et qui taille la main des siècles à venir
Va donc mon chant, va donc semer aux quatre vents
Les rejetons de l’âme
Du poète en sa foi !
Debout lumière qui es étoile du peuple
Et comète funèbre de la tyrannie !
Elle accomplit souvent son office infamant
Cette main de la brute amenant au bordel
La vierge à souiller par la natte
Et des têtes chenues s’inclinent
Et des rires d’enfants s’étouffent.
Tu diras à la vierge : « Ô sœur, fais patience
Je vois venir au loin vers toi
La colombe de l’avenir. »
Au vieux tu diras « Père, offre-moi ton fardeau
Ce fardeau contre quoi bute un pas malaisé »
Devant chaque berceau, dépose une espérance
Devant chaque tombeau, fais don de quelque pleur
Berceaux déserts, tombeaux rasés,
C’est là que tu vivras, mon chant
En frère du pauvre vraiment !
Et comme un fil tendu entre deux grands abîmes
Le pied dessus la terre et le front dans l’espace
Apporte à la prison tout l’amour du vrai Dieu
Et destine au vrai Dieu le cri de la prison !
II.
Je sais que par toute la place
Bouillonne l’onde populaire
Et que le plus souvent elle est un pilori
Mais que parfois c’est un autel.
Je sais que l’on se moque
Depuis la palissade
Qu’agitent les souffles du vent
Dans les forêts de l’existence
Je sais que l’on se paie bien méchamment la tête
De l’utopie que veille un oiseau à venir.
Je sais que l’égoïsme et je sais que la haine,
Et l’hypocrise, l’ambition,
Les âmes noires des cavernes
Que pas un rayon ne parcourt
Les cœurs fermés à la conquête
Les yeux fermés à tout regard
Les regards clos à la lumière
Lapident le calvaire et flétrissent la croix
Du poète en sa solitude !
Je sais que la race impudente
Du docteur et du pharisien
Qui fait la croix plantée du Christ
Et le bûcher de Galilée
C’est la fumée de l’ample flamme,
C’est l’ombre que le siècle
Traîne à son pied, noire et difforme,
Racines dans l’enfer,
Et qui va, serpentant, éternelle et secrète
De siècle en siècle et d’âge en âge
On les entend qui disent,
Ceux-là qui se prélassent
Aux agapes de Balthazar
« Ils nous ennuie, celui qui chante
En sanglotant près de l’Euphrate !
Qu’on fiche donc sa lyre aux branches d’un grand saule
À ce fastidieux Cassandre
Ou bien qu’il ceigne une couronne
De roses anacréontiques
Pour nous chanter l’amour ou bien la création… »
Ah ça… chanter les bois et chanter la campagne
Le soir, l’ombre ou bien la lumière
Donner toute son âme à des papillons bleus ;
Écouter le vent qui gémit
Sentir la feuille trembloter
Comme une poitrine qui bat
Dans les détours de la forêt
Croiser l’antre farouche où passa le jaguar
C’est bien beau et combien de fois
N’ai-je pas salué la terre
Le ciel et l’univers
Cette Bible que Dieu traça dans les espaces ?
Combien de fois mon chant n’a-t-il couru les monts
Et le clapotis des ruisseaux
À l’écoute des vents et de leurs prophéties
Vagues et tristes plaintes dans l’obscurité ?
J’ai déjà eu mon lot d’amour
Pour les femmes et les fleurs et les soleils levants
Pour les cloches sonnant dans la tiédeur des jours
J’ai écouté cette guitare
Qui console le paysan
Auprès de l’âtre des maisons
J’ai aimé tout mon soûl la jolie paysanne
Qui chante un fandango languide
À tous les clairs de lune !
Et puis l’enfance passe et tout change alentour.
Et voici qu’un beau jour elle passe en mon âme
Cette rumeur des villes.
L’idée résonne et le maillet
C’est le Cyclope du travail
Qui prépare en ses ciels le rayon du soleil.
Et puis il y a le peuple
Cette marée violente
Qui a la pensée pour toute arme
Et la vérité pour tout phare.
Et il y a l’homme, cette vague
Dans l’immense océan du peuple
Qui doit invoquer les esprits
Trouver la côte.
Alors maudit soit le poète
Celui qui fuit, le faux poète,
Le jour de la preuve donnée
Celui qui confond l’iambe pur
Et le dithyrambe empourpré
Quand il doit chanter l’affliction !
« Travaillez ! » gronde de son ombre
La voix immense du vrai Dieu
Je vous ai fait des bras dirigés vers la terre
Et des fronts vers les ciels !
Poète, sage et toi, sauvage,
Vous êtes le saint équipage
De l’arche civilisation !
Marin, monte à ton mât
Pilote, étudie bien tes astres
Vigie, gare à l’obscurité
Une noire tourmente geint
Dans la mâture et les filins.
Et geignent sur les ponts
Des otages qu’on a privés de tout sommeil
J’ai vu ceux-là de l’équipage
Livrés à la terreur
Secouer encor leur frère
Comme il était figé dans l’horreur de la mort.
Et j’ai crié : « vole, mon chant
Terre au loin ! Terre en proue !
Je vois la terre du futur ! »
III.
Compagnon de nuit d’insomnie
Que Jeunesse veille, songeuse
Prime feuille d ‘arbre de vie.
Étoile annonciatrice
Du bel or d’un matin
Note perdue je ne sais où
Par la harpe de mon amour
Rosée qui s’échappe du sein
Il est temps de prendre ta route
Vole, mon chant,
Toi qui as reçu si souvent
La rosée de mes pleurs.
Tu es l’étoile vespérale
Qui éclaire l’escarpement
Pour les bergers de l’Arcadie !
Petit oiseau que réchauffaient
Les secrets de mon sein, peut-être,
C’est aujourd’hui qu’une tempête
Mugit par la forêt, rugit par les falaises
Que, tel un grand condor perdu, battant de l’aile
Je te livre au grand vent de la grande infortune.
Car c’est ainsi que je te veux.
Je veux que ton fardeau, ce soit d’être le frère
De l’esclave à la peine
Je veux que ce soit de pleurer
Près de la croix de son calvaire
Que ce soit de gronder devant la bacchanale
De son maître et seigneur
Si Dieu veut bien te prêter vie.
Mais si tu gagnes le linceul
Enfant fauve de la forêt
Tu auras tes beaux hymnes entre éclair et tonnerre.
Quand la caravane perdue
La pieuse et la pélerine
Cherche en la terre musulmane
Les vastes restes nus du sépulcre de Dieu,
Elle observe un soleil tapi dans la savane
Elle pense à Jérusalem
À la cité toujours divine
Et elle meurt heureuse ainsi
Bornant la piste d’un ossuaire.
Ainsi, si cette multitude,
Cette humanité terrifiante,
Hypocrite infidèle et bacchante souillée
Parvient à ce que ploie ton grand front de géant
Parvient à traverser la maille de ta cotte
Tu laisseras en lice
Encor ce gant de fer
Que devra relever la jeunesse qui vient
Mais chasse ces pensées, crois en ton avenir
Et crois en ta jeunesse
Soleil brillant au ciel de la libération !
Chante, l’enfant du jour du pays radieux
De ces mornes superbes
De ces mornes rebelles !
Et souffle aussi dans ton tuba
Ce tuba où tu as appris
À hurler ta révolte
Et souffles-y bien lugubre et souffles-y strident
Fais-toi jour au présent de vice
Fais-toi jour au passé de mort,
Voix d’airain, de fer ou d’acier !
Viens réveiller les âmes fortes
Depuis le nord jusques au sud
Depuis l’Océan jusqu’aux Andes !
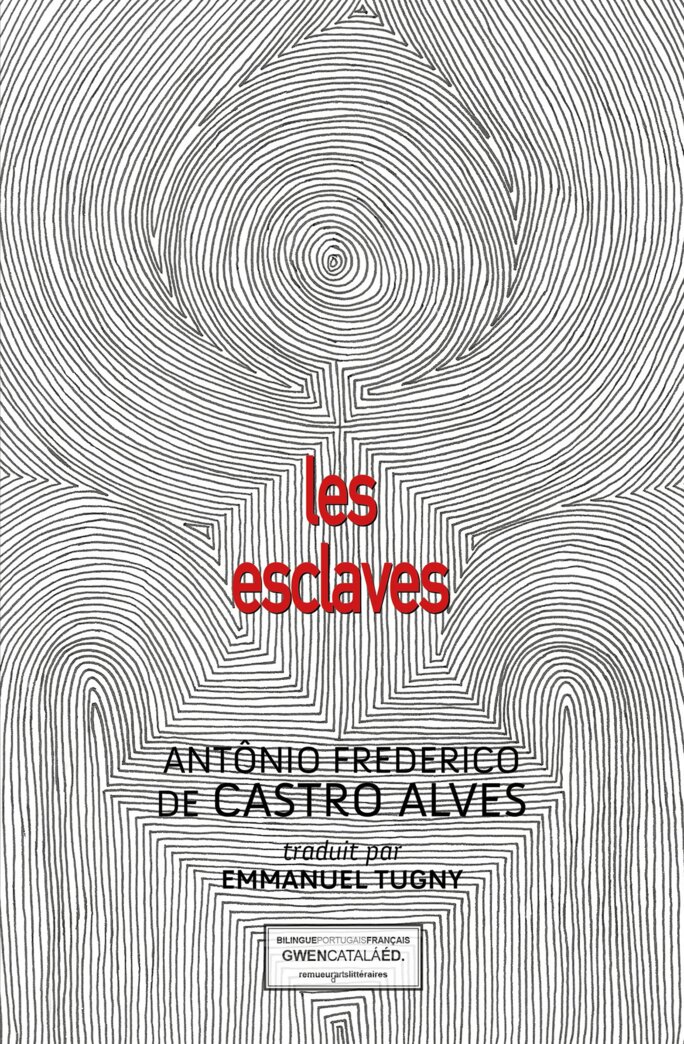
Agrandissement : Illustration 2
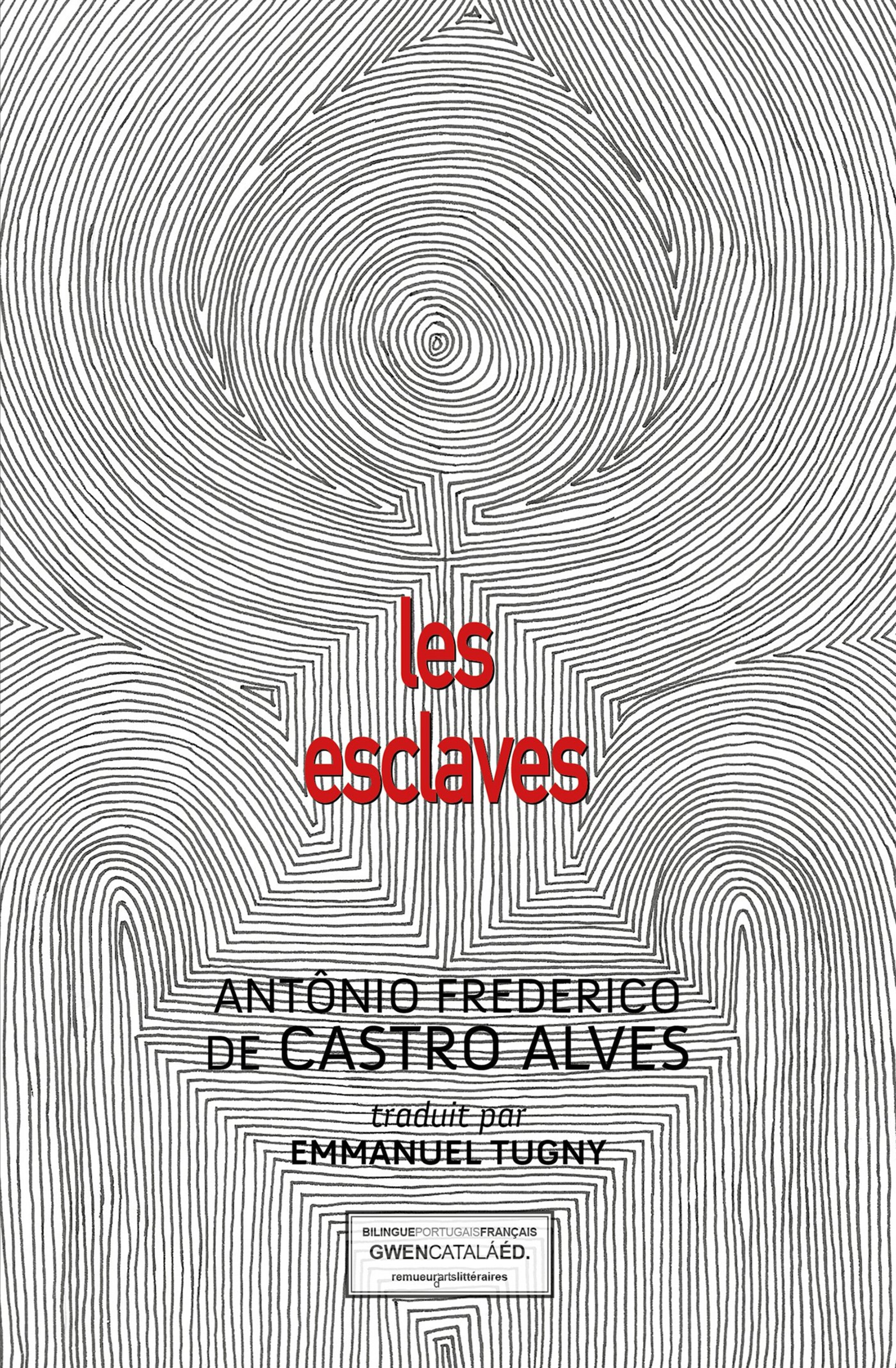
https://www.amazon.fr/esclaves-Ant%C3%B4nio-Frederico-Castro-Alves/dp/2376410746/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1525947684&sr=8-1&keywords=castro+tugny



