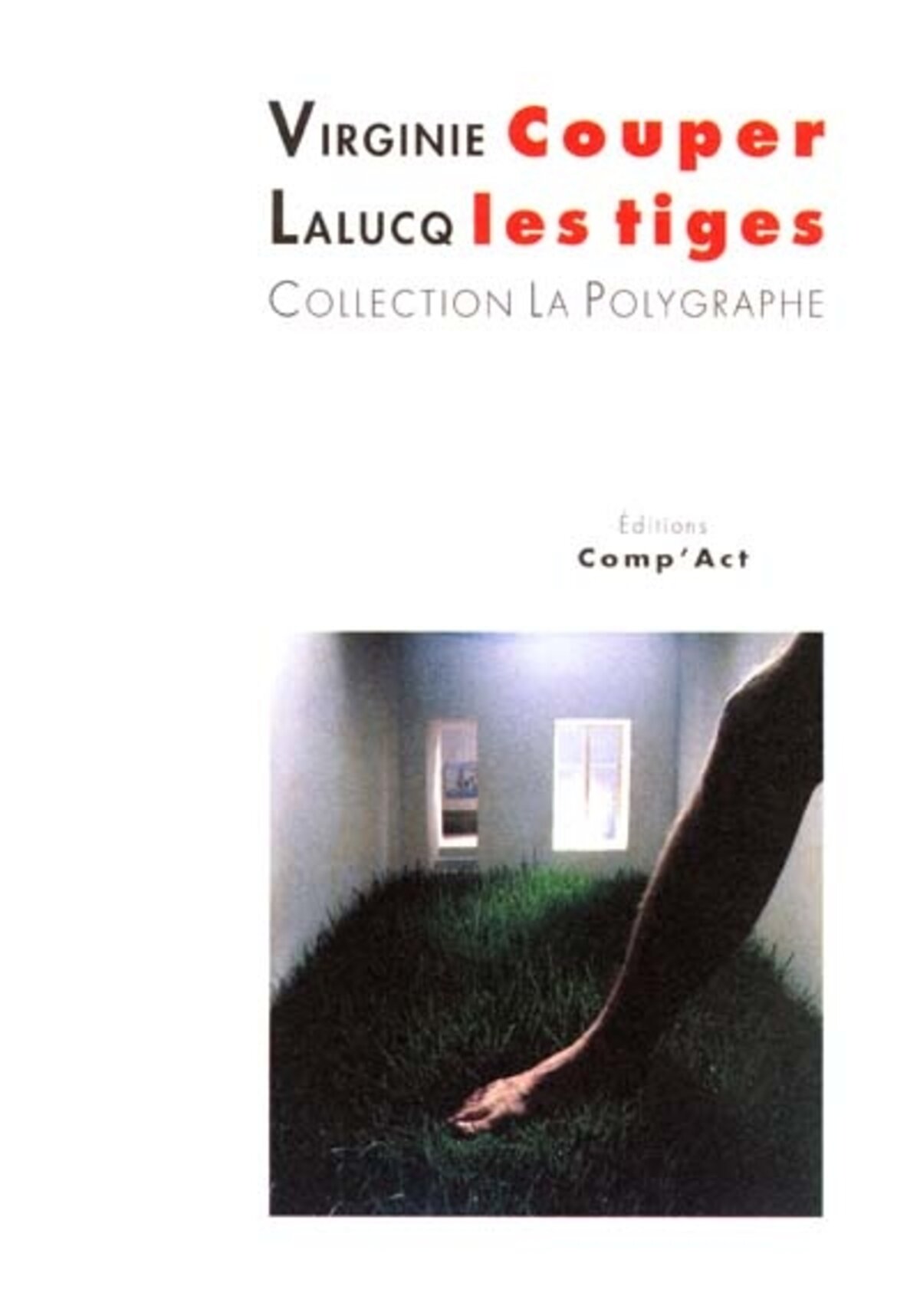
On sait la passion vouée par Blaise Cendrars, non tant à l’homme Gustave le Rouge, dont il fit un sujet littéraire dans L’Homme foudroyé[1], qu’à son écriture, qu’il honora dans Kodak[2], en la découpant en lambeaux, sur le modèle séminal du « cut-up », au service de son attique et vertigineux recueil, cet emblème allègre de la littérature futuriste.
Lisons-le, définissant, après Apollinaire et mieux, l’exigence nouvelle dont le Rouge illustra, de roman en roman, les impératifs :
« (…) détruire l’image, ne pas suggérer, châtrer le verbe, ne pas faire style, dire des faits, rien que des faits, le plus de choses avec le moins de mots possible ».
Si Gustave le Rouge, cet artisan-limite de l’évacuation du littéraire du littéraire, cet humble corps glorieux « revenu » de la rencontre avec l’esthétique nouvelle, débarrassée des oripeaux du lyrisme affété de la littérature exténuée par les siècles d’écart élitaire, mérite, selon son émule en tabacomanie, la qualification de « grand poète antipoétique », que dire de Virginie Lalucq ?
Son recueil de jeunesse Couper les tiges, dont le titre atteste la portée programmatique, ne se développe pas autrement qu’en vertu de l’ambition des deux cheminées complices du début du XXème siècle, qu’en vertu de l’énergie qu’elles employèrent à doter le siècle à son orée d’une littérature émondée, arasée, ramenée à sa bouture, enfin congruente à un temps de résurgence de l’acte pur sinon gratuit, d’une littérature dégagée de cette gangue de critique, de réflexivité immanente qui, la rendant volubile à l’excès, en souligne l’incapacité tragique, l’impuissance jacassière à s’observer du dedans, c’est-à-dire à définir son objet « in litteras », en un mot, à être brillamment ce qu’elle est : une présence singulière lancée dans le devenir et dont les expansions critiques internes dissolvent la puissance évocatrice « ipse » en y appliquant le vice corrosif des vapeurs critiques de la littérature « qui en est ».
Il faut en effet à la littérature qui entend devenir des œuvres telles que celle de Virginie Lalucq, de ces œuvres qui, « brisant le verre » de l’encyclopédisme littéraire importun afin « qu’éclate un rire », délivrent la beauté du poème de cette « poésie », de cet apparat satisfait dont il n’a que faire pour être poème.
En effet, si le poème est un « titre », une qualification préalable du poème qui, par tous les pores de sa matière de poème, lui pèse, alors vraiment, qu’en reste-t-il qui persiste au temps comme poème qui n’ait été suffoqué, épuisé, par cette qualification antérieure à sa fabrique propre ?
Qu’est-ce qu’un objet dont toute la vertu consisterait en sa qualification préalable sinon cette qualification préalable même, qui « s’en passe » ?
Qu’est-ce qu’un « poème poétique » sinon une contingence aussi mort-née que le rejeton mort-né, chlorotique, d’une lignée qu’il flétrit en dépit de soi de suffocation en suffocation ?
Couper les tiges adresse, après le Rouge, après Cendrars, après le grand Apollinaire, après Jarry, l’affreux rire de l’idiot rédempteur au « poème de poésie » ; il l’adresse aussi à cette pensée littéraire académique qui prend à sa gorge qui veut battre la pensée toujours encore impensée du lecteur au travail vrai.
C’est là sa haute vertu, sa haute puissance comique : elle est un plateau où quelque chose d’un bourgeonnement veut vivre à l’entier détriment de ce qui, l’intégrant, la digérant hors de soi, en obère la capacité à être au temps.
Couper les tiges constitue une tentative d’orphelinat volontaire, une tentative à la fois irrésistiblement farcesque et poignante de l’écriture de s’affranchir de l’écriture, de ne pas confire en tautologie chic, d’être de l’écriture en tant que l’écriture lui « lâche la grappe ».
Poings aux hanches, pouce sur le nez, le livre de Virginie Lalucq œuvre à ne point être « ce que c’est » avant que d’être, à extirper un « sui generis » hors du genre, de son Histoire, de ses ors, de ses dignités et de leurs métastases en l’objet littéraire.
Il veut être, cet objet, son objet, sa culture, ses vertus, sa stature, son « image » propres : il gifle pères et pairs, il intime silence aux voix du dehors de cette esthétique historisée dont il est l’enfant insolent ; il est l’adolescent qui veut faire justice de tout sang reçu, il s’émancipe en brute, il est seul et veut être seul, il prétend être ce qu’il est sur les cendres de ce qu’on fut, de ce qu’on fit pour lui et qui « bavarde », au fond de son petit monde solitaire et singulier, comme la pollution du cancre « au radiateur ».
Oui, la littérature et le poème sont les cancres paradoxaux, les cancres savants, de Virginie Lalucq ; leur polyphonie, leur babil, leur jactance est une nuisance dont la conception d’une voix doit à tout prix faire justice pour opérer au livre.
Le livre à venir, en somme, est, avant que d’être, autodafé de l’idée de livre, nous hurle Couper les tiges.
On lira ici un grand premier livre, un livre vraiment, un livre contre le livre, un livre contre la pensée du livre ; on le lira comme on entend le bon rire, franc, généreux, impitoyable, obtus, libre, d’un être et d’une écriture voués, c’est à dire radicalement, exclusivement, absolument subordonnés à leur devenir.
[1] : 1945.
[2] : 1924.



