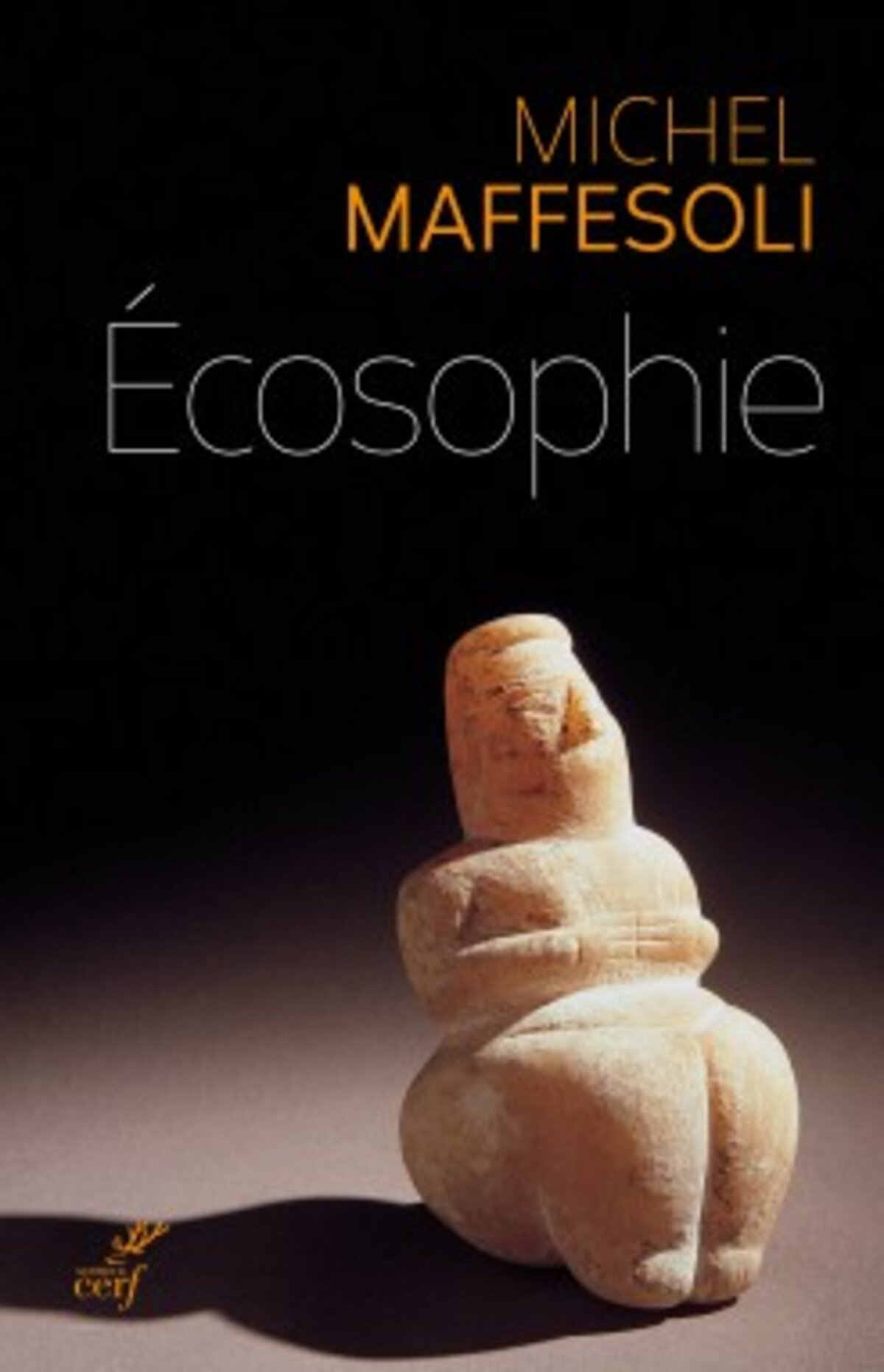
E.T. — Cher Michel Maffesoli, celui qui verrait un événement dans le fait que vous consacriez un ouvrage à la pensée de l’écologie vous aurait peu lu : elle faufile votre bibliographie. C’est davantage l’apparition d’une monographie qui marque l’amateur de votre jardin : pourquoi avoir décidé de dédier un livre à cette question “éclatée” dans tout votre travail ?
M.M. — En effet, une des idées obsédantes de tout mon travail consiste à rendre attentif à ce que j’ai nommé, en 1978, la puissance. Je traduisais par là l’antique notion grecque de « phusis » qui est, on le sait, la force primordiale à l’œuvre dans tout le donné mondain. C’est ce qu’après les Latins ont traduit par la notion de natura : ce qui est, ce qui est à venir. Par là, je voulais rendre attentif au fait qu’à l’opposé d’une conception quelque peu paranoïaque ayant marqué la tradition occidentale, la sagesse immémoriale, celle de l’ordre des choses, rendait attentif à la nécessité de s’ajuster, de s’accommoder, d’accepter les limites imposées par le destin.
C’est cela que je résume dans ce livre Écosophie, qui fait suite à un petit opuscule aux éditions du CNRS, il y a quelques années : Matrimonium.
Je préfère ce terme d’écosophie à celui d’écologie, compte tenu de l’aspect par trop politique qu’a pris, en particulier en France, le terme d’écologie. Et l’on voit la déshérence de ces divers partis écologiques qui ont oublié qu’elle était, justement, l’importance de la natura rerum !
Puis-je également préciser que cette « écosophie » est une manière de préciser ce qui est en jeu dans la postmodernité naissante, où le rationalisme, ce que je nomme dans ce livre idéosophie, c’est-à-dire la construction du monde à partir d’une idée abstraite laisse la place au sensualisme ou au naturalisme, reconnaissant, tout simplement que l’animal humain est aussi un animal. C’est cette animalité qui est, en quelque sorte le fil rouge parcourant tout ce livre et rappelant que la raison ne peut exister que si elle est fondée sur le sensible. Je rappelle que c’est bien cela que précisaient tout à la fois Saint Thomas d’Aquin et Joseph de Maistre, montrant, chacun à leur manière, l’interaction existant entre la conscience et les sens.
E.T. — Et Gassendi…
Cette incontestable fortune historico-idéologique de l’idée « d’inanimalité » de l’humain qui, en effet, fonde le Moderne, à quoi l’attribuez-vous ? Pur Ubris ? Dénégation peureuse ? Réaction à telle aporie dans le cheminement de mesure de soi ? On voit à quelle maladie infantile répond votre écosophie, mais l’on voudrait être au clair sur sa « nosologie » !
M.M. — Il est en effet aisé de reconnaître que le fondement même de la Modernité est la progressive négation, voire dénégation de la part animale de l’humain.
Alors que la pensée traditionnelle et donc la vie sociale qui en était le corollaire d’Aristote à Saint Thomas d’Aquin reposait sur l’étroite liaison existant entre le sensible et la raison, à partir du XVIIe siècle et bien sûr, l’œuvre de Descartes en témoigne, une distinction s’est progressivement imposée entre le corps et l’esprit. Dichotomisation qui va aboutir à la relativisation du fondement matériel ou corporel. C’est en ce sens que « l’humanisme » moderne est essentiellement « idéosophique ». C’est exactement une telle généalogie que j’essaye de faire dans mon Écosophie.
Très précisément en rappelant que la construction individuelle, tout comme les représentations collectives, repose sur ce que Heidegger nommait le « prétentieux ‘Je pense’ » de la tradition cartésienne.
On peut dire, d’une manière quelque peu ironique, que ce « je pense », ce que j’appelle idéosophie, est la forme profane du « créationisme » religieux. C’est-à-dire, Dieu créant à partir de ce qu’il a nommé. Et de la même manière, la paranoïa moderne, en niant le substrat matériel, c’est-à-dire, l’animalité de l’humain, pense pouvoir créer l’individu, la société, la nature ex nihilo.
Dans mon livre, je rends attentif, au contraire, au fait que quelque chose ne peut exister qu’à partir de son substrat matériel. En utilisant, à ma manière, l’expression du philosophe catholique Jacques Maritain, je dirais qu’après la parenthèse moderne, on est en train de retrouver ce qui était le fondement de la pensée traditionnelle, à savoir « un humanisme intégral ». Qu’est-ce à dire sinon le fait qu’on ne peut comprendre l’humain qu’en référence à l’humus et pour rester dans une chaîne sémantique, cela a pour cause et pour effet, une indéniable « humilité ».
C’est ainsi que l’on peut dépasser, sinon la maladie infantile du moins la parenthèse moderne, en retrouvant une conception « holistique », c’est-à-dire de l’entièreté de l’être individuel et collectif.
E.T. — Je vous entends bien mais comment, à l’instar de Bacon, ne pas interroger la capacité de « l’idéosophie », constituée telle par le devenir du donné et composante de la nature d’homme depuis un cogito à double fond inconscient et social et son effort herméneutique, à accéder à un degré de conscience de ce qui constitue l’aporie de cette nature d’homme, de ce qui ne lui est pas réductible, ou plus exactement, de ce qui constitue son « angle aveugle ». Quelle discipline de l’esprit doit-on mobiliser ou démobiliser pour accéder au sentiment de la nature comme distinction et plus particulièrement de la nature en soi ? Ce que vous voyez s’opérer au champ post-moderne n’est-il pas encore signe de l’empire sur le naturel de son double construit, machiné, pensé par un entendement angoissé, complexé, paranoïaque, en lutte avec soi ? Cette écosophie dont vous parlez n’est-elle pas la rédemption par l’idée des choses de l’idée des choses ?
M.M. — Dans cette Écosophie, puis dans mon prochain livre qui paraîtra début 2018 et dont le titre n’est pas encore bien arrêté, ce que je poursuis, c’est cette idée obsédante qui tel un fil rouge parcourt tout mon travail : savoir ce qui est premier dans la nature des choses ? Les choses elles-mêmes ou la manière de les qualifier ? Je rappelle de ce point de vue l’influence qui fut celle de Heidegger, rappelant à propos de Das Ding (la chose) que celle-ci est irréfragable et première. Ainsi il a, commentant telle sculpture de Michel Ange, cette formule à la fois fort simple et instructive : dans cette création « il y a du marbre aussi ! » Cette exclamation traduit bien l’aspect premier de la chose à laquelle on est confronté et que la tradition occidentale s’est employée à gommer. Pour rester dans l’ordre des auteurs qui m’ont influencé, je rappelle qu’il en était de même pour Gilbert Durand, montrant en quoi cet aspect on ne peut plus nébuleux qu’est l’imaginaire est totalement et en totalité tributaire de ce qui lui sert de substrat, à savoir les choses de la vie. Carl Gustav Jung de même, au contraire de Sigumnd Freud s’intéresse dans l’interprétation des rêves non seulement à la signification de la baguette de pain ou du serpent (« le pénis »), mais au choix du signifiant, pourquoi une baguette de pain ou un serpent.
C’est en ce sens que j’ai montré que ce qui avait été, sur la longue durée, la spécificité et disons-le la performativité du modèle occidental était cette pensée du haut qui crée en nommant les choses. Et, en jouant sur les mots, j’avais nommé cela « paranoïa » (para et noïein) c’est-à-dire une pensée surplombante. Dans mon écosophie je traduis cette verticalité du verbe créateur par ce néologisme « d’idéosophie », mettant l’accent sur la primauté de l’acte de nommer. C’est à l’encontre de cela que je parle d’une démarche métanoïaque, c’est-à-dire une pensée de l’accompagnement ou encore épinoïaque, c’est-à-dire une pensée issue de ce qui vient du dessous.
Peu importe les termes employés ou les néologismes que je propose, ce qui est essentiellement en cause est donc cet autre rapport à la nature qui n’est plus simplement un objet à exploiter, mais bien un Réel irréfragable avec lequel il faut compter.
Gilbert Durand encore avait à cet égard, parlé du « trajet anthropologique ». Par là, il signalait qu’on ne pouvait plus se contenter d’un sujet agissant sur un objet inerte, objet (ob-jectum) jeté devant soi et que l’on peut maîtriser, dominer, exploiter à merci. Mais bien et ce serait une spécificité du vivant, avoir une attitude trajective, c’est-à-dire fondée sur la réversibilité, l’interaction, la coopération.
C’est cette trajectivité qui me paraît être en jeu dans la sensibilité écosophique, je dis bien sensibilité en ce que ce n’est pas une conscience assurée d’elle-même, mais bien un sentiment vécu et répandu dans la vie quotidienne.
C’est cela l’idée des choses, c’est cela le naturalisme, qui sans faire abstraction de la capacité de rationalité qui est une des spécificités de notre espèce animale la complète par cette autre capacité qui est celle de sentir et donc d’agir en fonction de ces sensations, cette sensibilité.
En ce sens « la sensibilité écosophique » n’est pas du tout une régression, mais une « ingression » dans ce monde-ci dont nous faisons partie et dont nous ne pouvons plus nous abstraire d’une manière paranoïaque, c’est-à-dire prétentieuse. Dans de nombreuses langues néo-romanes (Italien, Portugais, Espagnol…), existe ce mot : ingresso, que nous n’avons pas en Français et qui traduit cet autre rapport à la nature, non pas dominateur ni dévastateur, mais fait essentiellement de coopération. Je renvoie à cet égard à l’œuvre de celui qui fut un des grands théoriciens de l’anarchie, par ailleurs géographe reconnu et peut-être premier écosophe digne de ce nom, à savoir Élisée Reclus qui le premier et peut-être le seul a utilisé ce terme, « ingrès » pour traduire justement une énergie n’étant pas tournée simplement vers la domination d’un monde futur à venir, mais au contraire (« in »), tributaire de ce monde-ci dans lequel on se situe.
E.T. — Il y a pourtant bien dans l’idée de Reclus (et dans la signification romane du mot « ingresso ») celle d’une traversée des choses, c’est-à-dire à la fois d’une reconnaissance de leur qualité d’objet et, par réversion, de la qualité d’objet de l’objet de celui qui traverse. En quelque manière, la « pensée à venir » que vous promouvez n’est-elle pas une émulation des distinctions, une émulation des arrachements au « naturel » à la chose dont la raison (nil sine ratione) est l’inatteignable d’Heidegger, c’est-à-dire la limite d’un pacte écologique dont le principe et l’horizon semblent bien relever, leibniziens, d’un monisme interdisant quelque traversée que ce soit à raison d’une grande « mêmeté » ?
Ma question revient à celle-ci (je paraphrase Lacan) : la pensée, le langage, sont-ils « adéquats » à l’écosophie ? Celle-ci peut-elle éviter l’abandon sensualiste, la contemplation, une sorte de mystique quiétiste, de résolution (un conatus) à « sentir », en soi et comme soi, l’altérité siamoise du natif ?
M.M. — La notion « d’ingrès », moins dans le sens banal que les diverses langues néoromanes donnent à ingresso que dans son sens métaphysique, recèle moins une idée de traverser que de s’intégrer.
En bref, ce qui est en question dans cette métaphore, c’est le glissement qui parfois s’instaure, dans les diverses histoires humaines, entre le « développementalisme » et ce que je propose de nommer « l’enveloppentalisme ». En laissant filer la métaphore, je rappelle que la sensibilité écosophique exprime un Zeitgeist (esprit du temps, ambiance) ne se projetant pas vers le futur, mais se vivant ici et maintenant, en un présentéisme exacerbé et s’attachant, de fait, à ce monde-ci. On n’est plus, ainsi, dans le « projet spermatique » qui a marqué la grande tradition moderne : le fameux logos spermaticos ou en latin la ratio seminalis, mais bien dans ce que j’ai proposé d’appeler « l’invagination du sens ».
C’est, ne l’oublions pas, fort simplement, ce qu’à sa manière, Heidegger nomme le Dasein qui a pu être traduit en français par « être là » ou mieux, « être le là ». C’est en ce sens que « l’ingression » n’est pas une régression, mais bien une focalisation de l’énergie, individuelle ou collective, dans ce monde-ci où l’on vit avec d’autres. Ce qui me fait dire que dans une telle sensibilité, le « lieu fait lien ».
Du coup, il convient, bien évidemment, d’adapter le langage au changement de paradigme en cours. C’est en ce sens que l’expression « trajet anthropologique » (Gilbert Durand) me semble pertinente, en ce qu’elle met l’accent sur la réversibilité, l’interaction, la coopération, dont on n’a pas encore mesuré tous les effets.
Il faut donc trouver les mots en pertinence avec le temps. Des mots pertinents ne se satisfaisant plus de ceux, impertinents qu’il est fréquent d’utiliser dans l’intelligentsia, la société officielle, ou la pensée propre à l’establishment. Des mots qui, dès lors, deviennent des paroles fondatrices. C’est-à-dire assurant les fondements mêmes de l’être ensemble.
En ce sens la sensibilité écosophique peut s’apparenter à cette tradition apophatique, ne disant pas, avec certitude, ce que sont ou ce que devraient être les choses, mais qui procède par évitement, par prudence, peut-être même faudrait-il dire, par pudeur.
C’est cette humilité de la pensée qui peut être à même de saisir la fécondité de l’humus dont est pétri l’humain. Humilité permettant de redonner ses lettres de noblesse à la nature qui est à la fois la force interne propre à la physis de la philosophie grecque et en même temps ce qui est toujours en devenir, ce que traduit bien le participe futur latin natura du verbe nascor (naître). C’est cette humilité enfin qui pour reprendre une belle expression de Léon Bloy fait que « le prophète est celui qui se souvient de l’avenir ».

Agrandissement : Illustration 2

E.T. — Traversée (je pensais en effet, en évoquant l’in-gradior, à Durand autant qu’à Reclus), trajet, devenir en le là et comme là, apophétie, modalité apophatique : je vous entends (j’entends aussi Bergson et ce qu’y voyait Jankélévitch exhaussant la « manière d’être » comme condition d’un devenir du temps). Mais il faut peut-être, pour vous entendre plus avant, je crois, que vous brossiez, vous qui avez écrit sur le silence, sur le silence à l’écoute, une « dramaturgie » de « l’éthos écosophe ». Quels gestes, quels états de corps et de pensée, vous semblent traduire, au champ contemporain, cette façon de repli dynamique, d’involution dans le devenir ? Je reviens sur cette idée d’apophétie, aussi, de prophétie, de bonne nouvelle de ce qui du devenir eut lieu : si elle est bien « souvenir d’un à venir », n’est-elle pas aussi mélancolie, saudade de son achèvement ? L’écosophie n’est-elle pas convertible en une nostalgie sourde de ce qui adviendra, puisque de l’ordre de l’étant ?
M.M. — On peut comprendre de diverses manières bien évidemment cette « ingression » qui est, disons-le tout net, l’expression des moments fondateurs. On peut, à cet égard, reprendre une distinction propre à la philosophie allemande, et qui fut, en particulier bien développée par Nietzsche entre « culture et civilisation ». La culture mobilise l’énergie créatrice et si on fait référence à son livre fondateur, Naissance de la tragédie, les « figures incisives », c’est à dire ce qui marque en profondeur les formes de l’être ensemble ; la civilisation, elle, se contente de « diluer » ces formes une fois instituées.
En bref, cette « ingrès » met essentiellement l’accent sur ce que l’on peut nommer l’entièreté de l’être individuel et collectif. Pour le dire en un terme un peu plus contemporain (quoiqu’il fut utilisé, à sa manière, par Émile Durkheim), il s’agit là d’un holisme, c’est-à-dire une harmonie, fut-elle conflictuelle entre le corps et l’esprit, la nature et la culture.
Cet holisme, peut être considéré dès lors, et ce en son sens strict, comme un ex-haussement de ce que sont à la fois l’individu, la société et la nature en son entier. Pour utiliser cette figure de rhétorique qu’est l’oxymore, figure propre à la culture pré-moderne comme à celle caractérisant la postmodernité, on peut parler pour bien comprendre cette entièreté, de matérialisme mystique ou de corporéisme spirituel.
C’est cela même qui souligne la conjonction étroite et féconde qui d’Aristote à Saint Thomas d’Aquin caractérise le réalisme donnant à la chose naturelle la vertu (c’est-à-dire la force, virtu) qui lui est propre.
C’est en ayant cela à l’esprit que l’on peut comprendre la procédure apophatique qui caractérise actuellement les attitudes sociétales les plus importantes, en particulier celles qui sont à l’origine de la méfiance face à tous les grands systèmes explicatifs. Ce sont ces procédures apophatiques, que pour ma part, j’ai analysées dans un livre précédent : La parole du silence (Éditions du Cerf, 2016). Il s’agit là d’une expression de ce que j’ai appelé antérieurement l’humilité, ou encore l’attitude épinoïaque qui considère que la matière, la nature est d’abord là et qu’il ne faut pas avoir la prétention de la créer à partir de la parole. En ce sens la sensibilité (l’humilité) écosophique met l’accent non pas sur un étant paranoïaque (l’homme comme maître et possesseur de la nature), mais pointe véritablement l’Être en son entier. Je rappelle à cet égard la distinction proposée par Georges Steiner entre l’Être infinitif, on pourrait dire l’Être indéfini, l’Être englobant et l’Être nominal, c’est-à-dire ce qui a la prétention en nommant d’enfermer dans une figure finie l’aspect indéfini de l’Être. Par exemple la déité, le divin, ce que je nomme actuellement le sacral renvoient à l’Être infinitif, indéfini. Alors que Dieu est une nominalisation de cet Être indéfini, qui met fin à son infinitude.
À la conjonction de cet « ingrès » et de la démarche apophatique, on retrouve cette idée de « saudade » qu’il est difficile de traduire en français, qui renvoie à ce qui est le Heimweh chez Heidegger, soulignant à la fois l’idée de finitude et d’inscription en un lieu donné. C’est cela même que pour ma part je tente d’exprimer au travers de l’expression « enracinement dynamique ».
E.T. — Je reviens sur cette idée de « saudade », qui a tout à avoir avec le regret (« regrès » ?) de l’inadvenu : l’on sent comme d’habitude, à vous lire, un fondement eudémonologique de la pensée œuvrer, votre abord des choses me semble immarcesciblement fondé sur l’appréhension d’un bonheur toujours déjà là, sur un cheminement d’espérant. Dès lors, cette démarche d’indistinction volontaire en cours que vous attribuez à bon droit à l’époque me semble offusquer son revers saturnien : l’impatience, l’irritation, la tristesse, l’ennui, la mélancolie que cela ne soit pas là quand pourtant c’est là. Il y a des écosophes heureux mais que dire de ces « écosisyphes » aux yeux de qui l’avènement du repli de l’être sur l’être fait asymptote ?
M.M. — Partons, pour bien comprendre l’ampleur et l’aspect dynamique induits par la saudade lusitanienne, l’Heimweh du romantisme allemand, repris à nouveau frais par Heidegger, ce qui également constitue, de mon point de vue, le fondement de la sagesse populaire, partons donc de ce que Joseph de Maistre appelait « le bon sens et la droite raison réunis », la vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut la vie. On a là en résumé un vouloir-vivre têtu qui s’accorde tant bien que mal, pour le meilleur et pour le pire, à ce qui est, à ce monde-ci, à cette nature à laquelle il faut s’ajuster ! Il s’agit là, sous ses diverses modulations du cœur battant de ce que j’ai nommé la sensibilité écosophique. On peut dire cela en des termes plus soutenus et rappeler qu’il s’agit là du glissement de l’histoire vers le destin.
En effet, dans le balancement des histoires humaines, il est des époques dans lesquelles ce qui est fondamental est l’Histoire. Cela vient d’ailleurs de la tradition judéo-chrétienne de l’histoire du salut, désignant par là ce long cheminement qu’il convient de faire pour arriver à la salvation individuelle et collective. Par parenthèses, cette histoire du salut devenue Histoire stricto sensu a pour corollaire ce qui était l’économie du salut, devenue également économie en son sens strict. On peut rappeler, de ce point de vue, la formule de Karl Marx dans La Question Juive : « la politique est la forme profane de la religion. »
Dans cette conception politique, l’homme est censé dominer la nature, dominer le social et se dominer lui-même. On peut résumer une telle logique de la domination dans la formule du Cinna de Corneille : « Je suis maître de moi comme de l’univers, je le suis, je veux l’être et le serai encore ! »
C’est une telle conception du monde, renvoyant le bonheur à plus tard qui a été la spécificité de la modernité. La dialectique « thèse, antithèse, synthèse », étant l’instrument achevé de cette recherche de la perfection future, que celle-ci soit individuelle ou collective. C’est stricto sensu une conception dramatique du monde (dramein) reposant sur l’idée que tout a une solution, une résolution, permettant encore une fois d’arriver à un bonheur parfait et lointain.
Tout autre est la conception tragique liée au retour du destin. Dans cette perspective, tout à fait antinomique au drame, il n’y a pas de solution. C’est ce qu’on appelle l’aporie : aporein en grec, sans solution. Il me semble que c’est ce sentiment tragique de l’existence, ayant marqué nombre de sociétés pré-modernes, qui retrouve force et vigueur dans la postmodernité.
Dès lors, il s’agit moins d’arriver à une perfection future que de s’ajuster au monde tel qu’il est et à la nature sous ses diverses formes. Pour le dire en termes imagés et reprenant une expression de Lévi-Strauss, le sentiment tragique de l’existence est corrélatif d’un « bricolage », de sa vie, de la vie en société, de la vie naturelle.
Voilà ce qui me paraît être en jeu dans l’écosophie : ce n’est plus la dimension prométhéenne d’une histoire maîtrisable à loisir, mais un sentiment dionysiaque reposant sur l’acceptation des limites qui, de surcroît, donne à être. C’est le là de l’être-là, c’est l’acceptation de la finitude. Dès lors le régrès n’est pas un regret de quelque chose de passé ou l’attente d’une perfection à venir, mais c’est l’accommodement, l’accommodation à l’Altérité. Que cette altérité soit celle du groupe (la tribu) ou celle du sacral (la déité), le tout enchâssé dans cet autre absolu qu’est la Nature avec laquelle il faut compter.
Je précise que ce « sentiment tragique de l’existence » (Miguel de Unanumo) n’est en rien pessimiste, ne comporte nulle mélancolie et n’a que faire des irritations politiques et sociales. Il est plutôt l’expression d’un vouloir-vivre irrépressible, tel que la philosophie de la vie, de Nietzsche à Bergson en passant par Simmel l’a bien formalisée. Il se trouve que ce vitalisme s’exprime au mieux dans la vitalité des jeunes générations qui ne contestent plus, ne s’opposent plus, ne cherchent pas une société alternative, mais s’ajustent, au coup par coup, à ce qui est.
E.T. — Ce que vous dites ici m’évoque Clément Rosset… je lui emprunte ma dernière question : cette accommodation à ce qui est, ce retour de l’étant à soi-même, en quelque sorte, est le fait d’une génération qui, si elle a, vous avez raison, ostensiblement abdiquée sur le terrain du volontarisme téléologique de la raison pratique, n’est est pas moins, « depuis nature », le siège d’un imaginaire, d’une capacité symbolique native qui du natif fabrique, fût-ce de chic, du « double », de la fiction, de l’aliénation en forme. Qu’est-ce, dans ce cadre neuf que vous présentez le pressentant, qu’une culture, qu’un art, qu’une littérature écosophes ?
M.M. — Puis – je réponds d’une manière lapidaire : on est en train de passer de l’économique à « l’iconomique » !
L’imaginaire, ne l’oublions pas, était, depuis Descartes et Malebranche, considéré comme étant la « folle du logis ». C’est-à-dire ce qui ne permettait pas le bon fonctionnement du cerveau. D’où la prévalence d’un rationalisme qui, à partir du XVIIIe siècle, systématisa la rationalité pour en faire le nec plus ultra de toute attitude individuelle ou collective. Max Weber a parlé, à cet égard, du « désenchantement du monde » corrélatif à la « rationalisation généralisée de l’existence » : tout était soumis à la raison, tout devait donner sa raison.
C’est ce rationalisme triomphant qui est le terreau de l’économique, voire de l’économicisme, propres à la Modernité. C’est ce rationalisme qui est l’outil épistémologique du politique, c’est à dire de l’activisme dans le monde social et naturel.
L’on assiste, de nos jours, en particulier concernant les jeunes générations, à la saturation d’un tel paradigme. La valeur travail ne fait plus recette. Il n’est plus question de perdre sa vie à la gagner. Et faire de sa vie une œuvre d’art est, dans le sens heideggérien du terme, le « souci » principal du vitalisme juvénil.
C’est cela que je nomme « iconomique ». C’est la rébellion de l’imaginaire que l’on peut observer dans les réseaux sociaux, les vidéo-games, et autres manifestations de la cyberculture mettant l’accent sur l’esthétisation de l’existence. D’iconoclaste, la société (re) devient iconophile.
La vie n’est plus, simplement, mesurable par un « principe de réalité », quelque peu rachitique et réduit à la simple dimension économique, sociale ou politique. À la réalité s’oppose le RÉEL, gros de l’irréel. Gros des fantasmes, des rêves, des fantasmagories et autres éléments immatériels. Dans un tel « imaginal », quoi de plus légitime que de voir les choses et les hommes comme ils sont ! Et de les décrire en tant que tels.
Voilà ce qu’est l’accommodement postmoderne. Voilà, également, ce qui génère une littérature, un art, une culture vécus au quotidien et donc ÉCOSOPHES.
En bref, à la « raison pratique » économico-politique succède une « raison sensible » dont j’ai fait l’éloge il y a quelques décennies. Le lâcher-prise généralisé d’obédience dionysiaque ne se satisfaisant plus d’un « étant » actif, mais étant attentif à un « être » beaucoup plus complet (« holiste »), celui du corporéisme mystique, du matérialisme spirituel !
Voilà la méditation que je propose dans mon « ÉCOSOPHIE », et que je vais poursuivre dans mes « Considération sur la postmodernité » ouvrage à paraître en février prochain.
Michel Maffesoli, Écosophie, Éditions du Cerf, 256 pages.



