Frank (Chris Evans), un ancien professeur universitaire de philosophie devenu réparateur de bateau, élève seul Mary (McKenna Grace), sa nièce de sept ans, depuis la mort de sa sœur. Lors de son premier jour d’école primaire, les capacités exceptionnelles de Mary (concernant surtout les mathématiques) seront divulguées au grand jour. Autre complication qui s’ajoutera au tableau : la grand-mère de Mary (Lindsay Duncan) va se lancer dans une procédure juridique pour récupérer la garde de sa petite-fille.
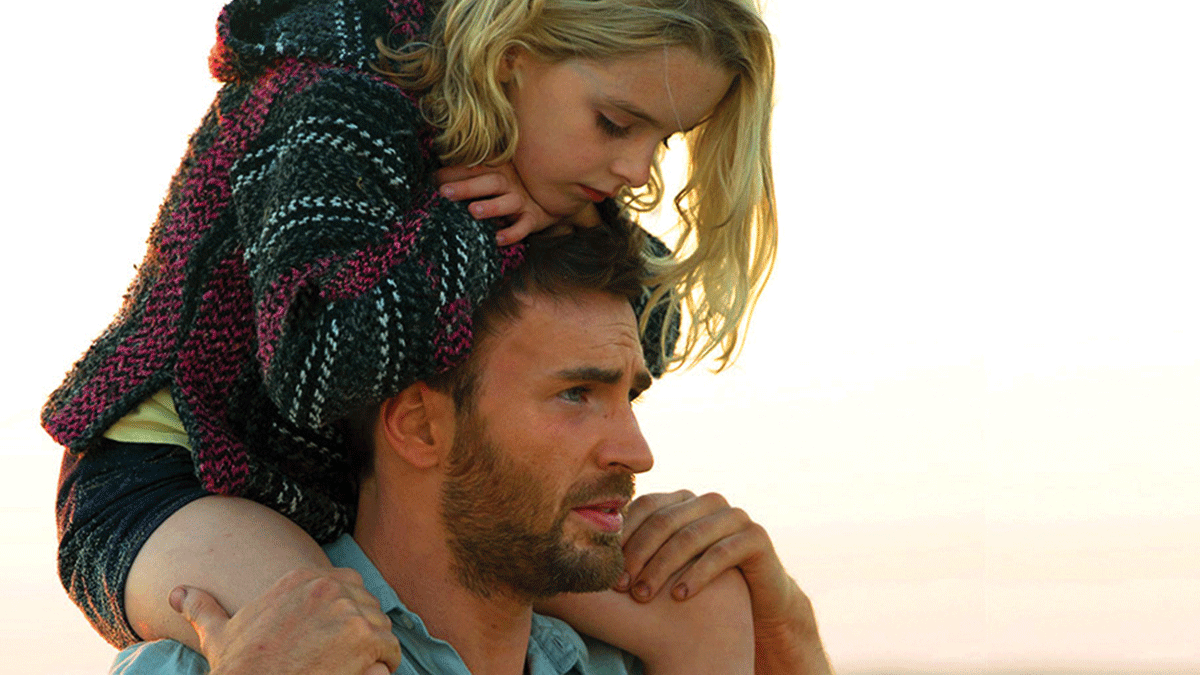
Agrandissement : Illustration 1
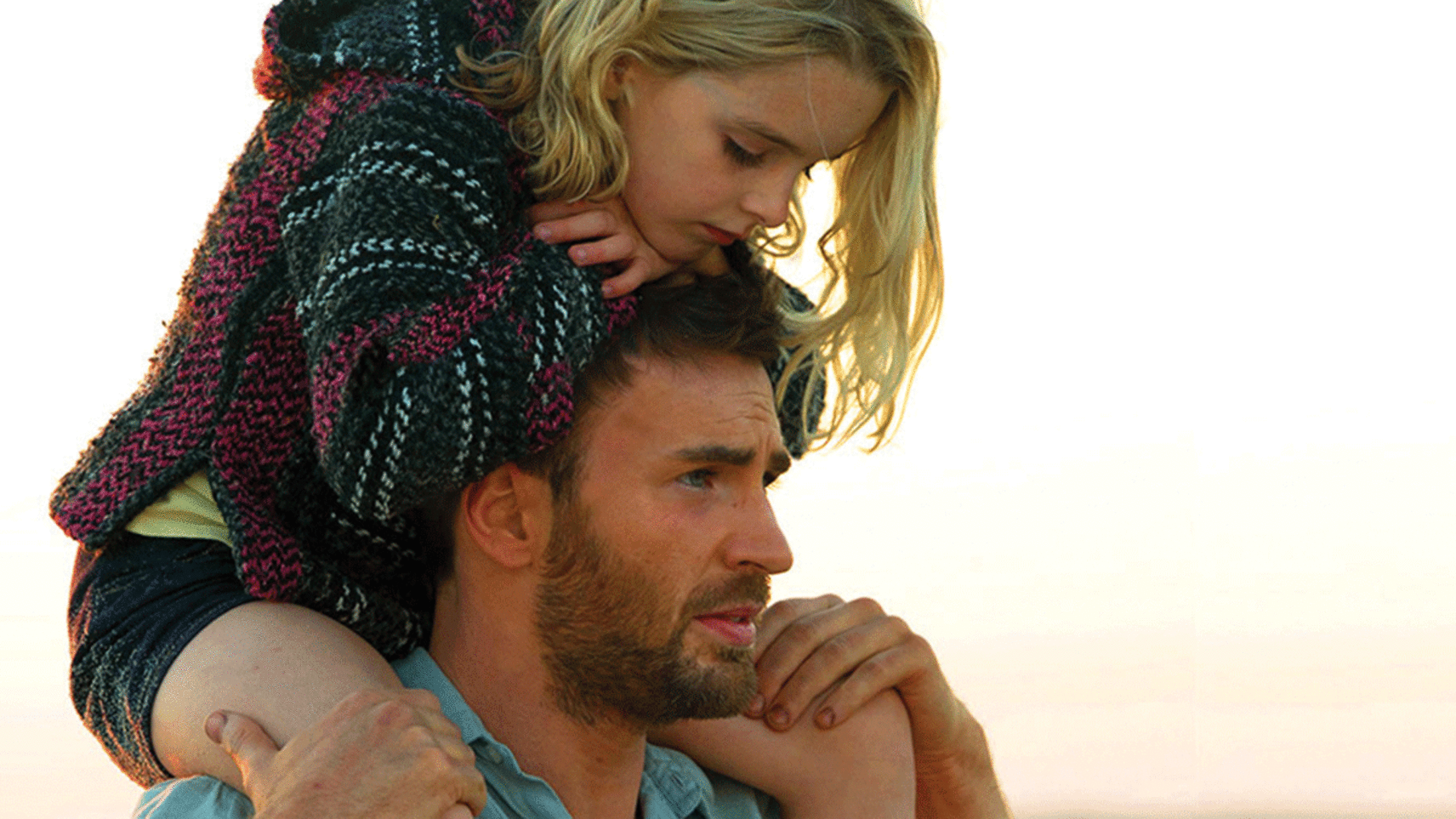
Mary, est, malheureusement un film qui fait ce qu’il dénonce, à savoir, si tout au long du film le réalisateur veut faire comprendre que catégoriser les personnes pour créer des élites est une chose néfaste, comme quand Frank refuse que Mary aille dans un établissement spécialisé, car, selon lui, c’est en séparant les gens qui sont considérés intelligents des autres qu’on crée des politiciens malhonnêtes, on trouve dans Mary une succession de stéréotypes et une vision dualiste bien/mal assez agaçantes : le seul moyen de trouver le bonheur, le vrai, est de fuir son milieu d’origine d’intellectuels WASP arrogants pour vivre dans un préfabriqué et réparer des bateaux au milieu de personnes authentiques, simples et honnêtes, la grand-mère qui, en plus d’adhérer aux valeurs des intellectuels WASP, est anglaise, est, bien sûr, le personnage le plus arrogant du film, les clichés sur les « surdoués » se succèdent tout au long du film (la mère de Mary était une inadaptée sociale et s’est suicidée car son génie l’empêchait d’être heureuse, Mary est toujours montrée comme un petit prodige au sens moral inébranlable, sans jamais que sa personnalité ou ses sentiments soient abordés de manière plus complexe…) et, selon Mary, en bon ambassadeur de l’American Way of Life, un enfant ne peut pas être heureux s’il ne fait pas partie des scouts, ne va pas à son bal de promo et à l’école publique dans un bus jaune avec les autres ( école publique qui dépend des décisions prises par les politiciens malhonnêtes cités précédemment, soit dit en passant). L’accumulation de ces stéréotypes réducteurs est assez gênante dans un film qui se centre sur les personnages et les relations qu’ils entretiennent les uns avec les autres.
Marc Webb semble avoir oublié que l’être humain est un être complexe, qu’il est peu probable qu’aucun adulte, et surtout professeur, ne se sente atteint dans son amour-propre quand il est repris par une petite fille de sept ans, que les autres enfants ne montrent pas plus de réactions face à Mary, que des explications simplistes et niaises suffisent à résoudre tout problème émotionnel en moins de deux minutes…
En continuant dans les stéréotypes, le réalisateur a tenté (de manière un peu trop forcée) d’inclure dans son film des séquences très « cinéma indépendant », comme celle où l’on voit les ombres de Mary et Frank avec un soleil couchant en décor de fond avoir une discussion pseudo-philosophique sur l’existence de Dieu, ce qui rend le film encore plus agaçant.
Si certaines questions intéressantes sont abordées dans Mary : Faut-il donner une éducation spéciale à certains enfants ? Quels sont les effets néfastes quand on catégorise dès l’enfance les individus ? Comment répondre aux besoins spécifiques de chaque enfant ? Quel est le rôle de chacun dans une famille considérée comme « atypique » ? Leur traitement à travers des stéréotypes et des facilités scénaristiques enlève tout intérêt et crédibilité au film.
Erica Farges



