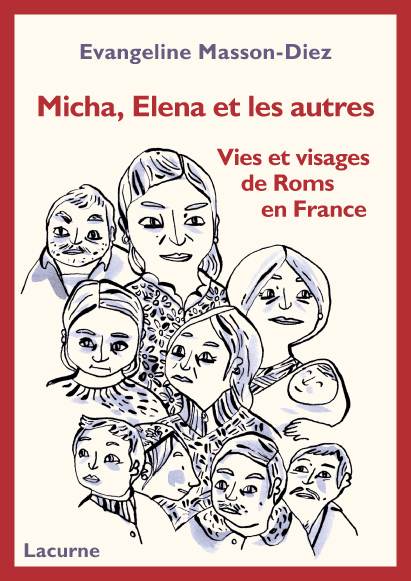Les voitures s’engagent sur la rampe du périphérique et nous frôlent. Le bruit est insoutenable ; amplifié par le tunnel à quelques mètres, le son lourd et nerveux des moteurs est oppressant. Il fait déjà sombre. La nuit ne va pas tarder à s’installer. Je talonne Gabriel en essayant de ne pas songer au danger du chemin qu’il m’indique. Le trottoir que nous descendons longe une sortie du périphérique et un petit parapet de quelques dizaines de centimètres de haut nous sépare des véhicules. Ce boyau de bitume piéton me paraît interminable. J’essaie de rester concentrée pour ne pas marcher sur les bouteilles de verre et éviter les panneaux de signalisation à hauteur de ma tête. La soirée me paraît soudain bien chaude et je n’arrive plus à faire la part entre la température naturelle et la chaleur dégagée par les voitures.
Après quelques longs mètres, nous arrivons sur un renfoncement de pelouse caché derrière quelques buissons décharnés. Deux tentes Igloo rouges sont installées là. Je devine aux alentours de la plus grande tente une chaise, une poussette, quelques sacs, un jerrican d’eau et une marmite sur un petit feu de bois. Le rugissement des voitures qui accèlérent m’empêche d’entendre Gabriel. Je devine que les enfants sont dans les tentes et que sa femme est allée au bar-tabac acheter des cigarettes. Gabriel hausse la voix et me propose de nous parler derrière un buisson : le feuillage estompe le bruit du boulevard périphérique me fait-il comprendre d’un signe. Il me suggère de m’asseoir. Je refuse d’un geste, je préfère rester debout. J’ai besoin de réfléchir. Quelle raison a pu le pousser à s’installer sur cette bande de verdure ? La dernière fois que nous nous sommes vus, il y a deux mois, ses aînés réussissaient au collège, le dernier était régulièrement suivi par un pédiatre en ville et Gabriel, du haut de sa quarantaine, avait trouvé une organisation de travail bien rodée entre la biffe, cette activité des chiffonniers qui consiste à récupérer des objets dans les ordures pour les revendre à la sauvette, les emplois non déclarés sur un chantier et les coups de main contre nourriture dans une petite association. La famille vivait où elle pouvait : après avoir habité pendant l’automne dans un bidonville, elle avait téléphoné durant tout l’hiver au 115 pour obtenir régulièrement une prise en charge hôtelière.
- Pourquoi t’es-tu installé ici ?
Gabriel se tait. Je sais qu’il connaît du monde et des bidonvilles non loin d’ici où il obtiendrait facilement une place. Il détourne la tête et ne répond rien. J’attends et laisse le silence s’installer entre nous. Il parle très bien le français, je sais qu’il a compris ce que je lui ai dit ; je le connais suffisamment bien pour savoir qu’il finira par répondre à ma question. Après quelques longues secondes et le passage d’un camion lourd et bruyant, il murmure qu’il ne veut plus vivre avec d’autres familles de crainte que ses enfants ne fassent de mauvaises rencontres.
- Dans ce cas, ne reste pas là,lui dis-je, va planter tes tentes plus loin, à l’abri des voitures et de la pollution, dans un coin plus calme. Ici c’est dangereux, Gabriel, tu mets en danger tes enfants.
Gabriel me dévisage avec violence. Il fait quelques pas, fait mine de m’ignorer et envoie d’un coup de pied un vieux journal gratuit en direction du périphérique. Je ne comprends pas ce qu’il veut. Pourquoi m’a-t-il fait venir ici ce soir s’il ne veut pas parler avec moi ? J’insiste :
- Gabriel, tu dois aller ailleurs, ne serait-ce qu’un peu plus loin, pour mettre tes enfants à l’abri. Avec le bruit des voitures, vous ne pouvez pas dormir ; avec les gaz d’échappement, tes enfants vont tomber malades. Tu dois les mettre dans un lieu plus sûr, tu dois…
- Tu dois, tu dois… ! Tu crois que je suis fou ? m’interrompt-il soudain d’une voix faible. Tu crois que je ne sais pas que c’est fou de vivre ici. Tu crois que je suis irresponsable et que je n’aime pas mes enfants. Tu ne comprends pas ? Quand j’ai été gentil, personne ne m’a aidé. Quand j’ai appris le français, personne ne m’a embauché. Quand les enfants sont allés à l’école, quand ma femme a été à la PMI, personne ne nous a encouragés. Quand j’ai obéi aux expulsions et aux contrôles d’identité, personne ne m’a tendu la main. Personne ne m’a soutenu. Alors peut-être que si je suis tout en bas, là où personne ne doit vivre, si les enfants ne vont plus à l’école, si on devient tous malades, alors peut-être qu’on nous aidera ? Je ne sais plus quoi faire… Qu’est-ce qui fera que quelqu’un nous regarde et nous tende la main ? Que puis-je faire d’autre ? Dis moi…
Je me tais.
Je suis profondément déstabilisée.
Je regarde Gabriel. Il est sincèrement en colère. Aucune violence ne transparaît dans ses yeux, mais je sens que l’exaspération et l’incompréhension le rongent. Harassé, usé, il ne sait plus quoi faire pour sortir de sa misère. À bout de force, il fait une ultime tentative pour attirer l’attention sur les siens et ne plus demeurer invisible. Il se tient debout face à moi, essoufflé, les bras ballants.
Sans que je m’en aperçoive, le soleil a disparu et l’obscurité nous a enveloppés. Derrière Gabriel, les voitures continuent de se presser sur le périphérique, à pleins phares et pleine vitesse.