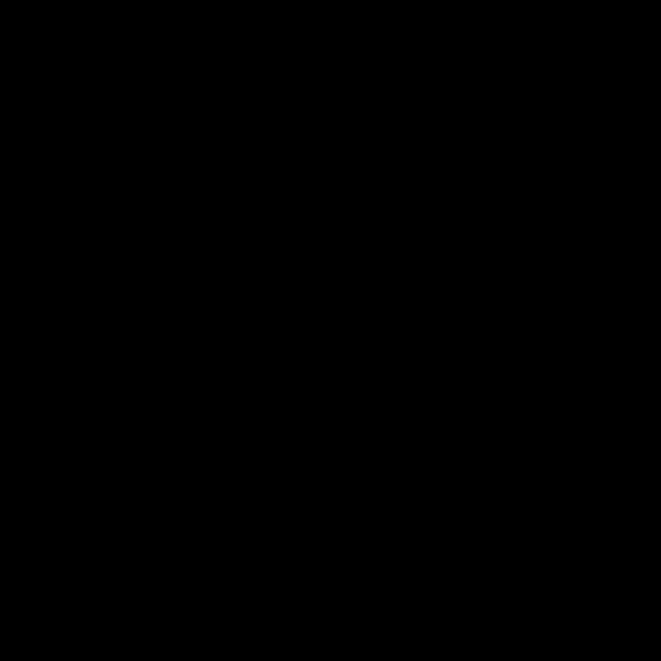Agrandissement : Illustration 1

Le processus de paix au Moyen-Orient n’est plus. Il n’est pas mort : il a été assassiné. Israël continue de se moquer de son parrain américain en installant des colonies de peuplement illégales avec un mépris cynique pour la “feuille de route”. Le président des États-Unis d’Amérique a été réduit au rôle de marionnette de ventriloque et récite pitoyablement le texte du gouvernement israélien : “Tout est la faute d’Arafat.”
Les Israéliens, eux, attendent sombrement le prochain attentat. Les Arabes de Palestine, confinés dans des bantoustans de plus en plus restreints, survivent grâce à l’aide européenne. Dans le paysage jonché de cadavres du Croissant fertile, Ariel Sharon, Yasser Arafat et une poignée de terroristes peuvent tous clamer victoire, et ils le font. Sommes-nous arrivés au bout de la route ? Reste-t-il quelque chose à faire ?
A l’aube du XXe siècle et au crépuscule des grands empires, les peuples soumis à l’Europe rêvaient de former des “États-nations” où les Polonais, les Tchèques, les Serbes, les Arméniens et les autres pourraient vivre libres et être maîtres de leur destinée. Lorsque l’empire des Habsbourg et celui des Romanov se sont effondrés, après la Première Guerre mondiale, leurs leaders ont saisi l’occasion. Une myriade de nouveaux États sont apparus, et la première chose qu’ils ont faite a été d’accorder des privilèges à la majorité nationale ou “ethnique” - définie par la langue, ou la religion, ou l’ancienneté, ou les trois à la fois - aux dépens des minorités locales importunes, reléguées en deuxième classe.
Toutefois, les ambitions de l’un de ces mouvements nationaux, le sionisme, n’ont pu se réaliser : le rêve d’un foyer national juif établi au cœur du défunt Empire ottoman [déclaration Balfour] allait devoir attendre le départ de la Grande-Bretagne impériale, qui n’a eu lieu que trente plus tard et après une seconde guerre mondiale.
Ainsi, ce n’est qu’en 1948 qu’un “État-nation” juif est établi dans l’ancienne Palestine ottomane. Mais ses fondateurs ont été influencés par les mêmes idées et critères que leurs prédécesseurs de la fin du XIXe siècle à Varsovie, à Odessa ou à Bucarest. C’est pourquoi la définition ethnoreligieuse que s’est donnée Israël et sa façon de discriminer ses “étrangers de l’intérieur” ont davantage en commun avec, par exemple, les pratiques en vigueur dans la Roumanie de l’entre-deux-guerres qu’on veut bien l’admettre.
Pour résumer, le problème avec l’État d’Israël n’est pas - comme on l’a parfois laissé entendre - qu’il soit une “enclave” européenne dans le monde arabe, mais plutôt qu’il ait été créé trop tard. Il a importé un projet séparatiste typique de la fin du XIXe siècle dans un monde qui avait évolué, un monde de droits individuels, de frontières ouvertes et de lois internationales.
L’idée même d’un “État juif” - un État dans lequel les Juifs et la religion juive jouissent de privilèges exclusifs que n’auront jamais les citoyens non juifs - est ancrée dans un autre temps et un autre lieu. En un mot comme en cent, l’État d’Israël est un anachronisme.
Israël présente malgré tout une différence capitale avec les micro-Etats instables et sur la défensive qui sont nés de l’effondrement impérial : c’est une démocratie - d’où son dilemme actuel.
Trois solutions peu attrayantes s’offrent aujourd’hui à Israël en ce qui concerne l’occupation des terres conquises en 1967.
- La première consiste à démanteler les colonies juives dans les Territoires occupés et à revenir aux frontières de 1967, à l’intérieur desquelles les Juifs sont une nette majorité, et rester ainsi à la fois un État juif et une démocratie.
- La deuxième est de continuer à occuper la Judée-Samarie [Cisjordanie] et Gaza, où la population arabe, ajoutée à celle que compte Israël à l’heure actuelle, sera démographiquement majoritaire d’ici cinq à huit ans : dans ce cas, Israël sera soit un État juif (avec une majorité croissante de non-Juifs sans droit de vote), soit une démocratie - mais pas les deux.
- Enfin, Israël peut garder le contrôle des Territoires occupés et se débarrasser de l’écrasante majorité que représentent les Arabes, soit en les expulsant par la force, soit en les privant de terres et de moyens de subsistance, ce qui les contraindra à l’exil. Cette solution permettrait certes à Israël de rester à la fois un État juif et un pays ayant au moins un passé démocratique, mais il deviendrait en contrepartie la première démocratie moderne à avoir érigé le nettoyage ethnique massif en projet national.
Quiconque croit que cette troisième option est impensable, surtout pour un État juif, n’a pas vu le nombre croissant de terres qui ont été saisies et de colonies qui se sont installées en Cisjordanie au cours des vingt-cinq dernières années ; ni écouté les généraux et les politiques de la droite israélienne, dont certains sont actuellement au pouvoir. Aujourd’hui, le centre de l’échiquier politique israélien est occupé par le Likoud. Son aile dominante est le Herout, le parti de feu Menahem Begin. Le Herout est l’héritier du mouvement sioniste révisionniste fondé dans l’entre-deux-guerres par Vladimir Jabotinsky, dont l’indifférence implacable pour les subtilités légales et territoriales a jadis été qualifiée de “fasciste” par les sionistes de gauche.
Lorsqu’on entend le vice-Premier ministre israélien, Ehoud Olmert, déclarer fièrement que son pays n’a pas exclu d’assassiner le président élu de l’Autorité palestinienne, il ne fait aucun doute que l’étiquette lui va parfaitement : le meurtre politique est une spécialité des fascistes.
La situation d’Israël n’est pas désespérée, mais presque. Les kamikazes n’abattront jamais l’État d’Israël et ils sont la seule arme des Palestiniens. Il existe certes des Arabes radicaux qui n’auront de cesse que tous les Juifs soient repoussés dans la Méditerranée, mais ils ne représentent pas une menace stratégique pour Israël. Et l’armée israélienne le sait. Bien plus que le Hamas ou la Brigade des martyrs d’Al Aqsa, les Israéliens réalistes craignent l’émergence d’une majorité arabe dans le Grand Israël et, surtout, l’érosion de la culture politique et de la morale civile qui caractérisent leur société.
Si rien ne change, l’État d’Israël ne sera dans cinq ans ni juif ni démocratique. C’est là que les États-Unis entrent dans la danse. Le comportement d’Israël a été désastreux pour la politique étrangère américaine. Avec le soutien des États-Unis, Jérusalem s’est continuellement et clairement moqué des résolutions de l’ONU exigeant son retrait des territoires annexés et occupés pendant la guerre. Israël est le seul pays du Moyen-Orient dont on sait qu’il possède de véritables armes de destruction massive. En fermant les yeux sur cette réalité, les États-Unis ont en fait ruiné leurs propres efforts, de plus en plus frénétiques, pour empêcher des armes de ce type de tomber entre les mains d’autres petits États potentiellement belliqueux. Le soutien inconditionnel que Washington accorde à Israël malgré certaines réserves - passées sous silence - est la raison principale pour laquelle le reste du monde ne croit plus en notre bonne foi.
Les personnes bien informées reconnaissent tacitement aujourd’hui que les motifs pour lesquels l’Amérique voulait déclarer la guerre à l’Irak n’étaient pas nécessairement ceux qui ont été invoqués. Pour une partie de l’actuel gouvernement américain, il était nécessaire, d’un point de vue stratégique, de déstabiliser, puis de reconfigurer le Moyen-Orient, afin que la nouvelle donne soit favorable à Israël. Et ce n’est pas fini.
Aujourd’hui, nos cris de guerre s’adressent à la Syrie. Mais Damas a jusqu’à présent fourni aux États-Unis des informations cruciales sur Al Qaida. A l’instar de l’Iran, une autre vieille cible du courroux d’Israël que nous cherchons activement à nous aliéner, la Syrie, est plus utile aux États-Unis comme amie que comme ennemie.
Quelle guerre menons-nous donc ? Le 16 septembre 2003, les États-Unis ont opposé leur veto à un projet de résolution des Nations unies exigeant qu’Israël revienne sur sa menace de déporter Yasser Arafat. Les officiels américains ont eux-mêmes admis en privé que les termes de la résolution étaient raisonnables. Mais nous nous y sommes quand même opposés, portant un autre coup à notre crédibilité en tant que négociateur impartial dans la région.
Plutôt que d’ouvrir les yeux sur le Moyen-Orient, les dirigeants et les experts américains calomnient leurs alliés européens lorsqu’ils expriment leur désaccord, n’hésitent pas à parler de manière irresponsable d’une résurgence de l’antisémitisme lors qu’Israël est critiqué et fustigent tout personnage public aux États-Unis qui essaierait de se démarquer du consensus.
Mais, au Moyen-Orient, la crise est toujours là. En cette année d’élections, le président Bush va probablement briller par son absence de la mêlée, après en avoir dit juste assez au sujet de la “feuille de route” pour apaiser Tony Blair, au mois de juin dernier. Il va pourtant falloir tôt ou tard qu’un homme d’État américain dise ses quatre vérités à un Premier ministre israélien et trouve un moyen de le forcer à écouter.
Les Israéliens de gauche et les Palestiniens modérés répètent vainement depuis vingt ans que le seul espoir réside dans le démantèlement de la quasi-totalité des colonies et dans le retour aux frontières de 1967 en échange d’une véritable reconnaissance de ces frontières de la part des Arabes et de la création d’un État palestinien stable, sans terroristes soutenus (et freinés) par les organisations occidentales et internationales.
C’est là le compromis traditionnel, qui reste d’actualité, et qui aurait été autrefois une solution juste et possible. Mais je crains qu’il ne soit déjà trop tard pour cela. Il y a trop de colonies, trop de colons juifs, trop de Palestiniens, et ils vivent ensemble, bien que séparés par des fils barbelés et des autorisations de passage. “Feuille de route” ou pas, la vraie carte est celle qui est dessinée sur le sol et c’est elle, comme le disent les Israéliens, qui reflète la réalité. Peut-être, après tout, les 250 000 colons juifs lourdement armés et subventionnés quitteront-ils volontairement la Palestine arabe. Mais je ne connais personne qui y croie. Un grand nombre de ces colons sont prêts à mourir - et à tuer - plutôt que de partir. Le dernier politicien israélien à avoir tué des Juifs pour des raisons de politique nationale est David Ben Gourion, qui a utilisé la force pour désarmer la milice illégale de l’Irgoun en 1948. Mais Ariel Sharon n’est pas Ben Gourion.
L’heure est venue de penser l’impensable. La solution consistant à créer deux États - sur laquelle se fondent le processus d’Oslo et l’actuelle “feuille de route” - est probablement déjà vouée à l’échec.
Le véritable choix du Moyen-Orient dans les années à venir se fera entre un Grand Israël ethniquement pur et un État unique, intégré, binational, constitué de Juifs et d’Arabes, d’Israéliens et de Palestiniens. C’est ainsi en tout cas que les tenants de la ligne dure du gouvernement Sharon voient les choses. Et c’est la raison pour laquelle ils considèrent l’élimination de la population arabe comme une condition indispensable à la survie de l’État juif.
Et si, dans le monde d’aujourd’hui, il n’y avait pas de place pour un État juif ? Et si la solution binationale n’était pas seulement probable, mais souhaitable ? L’idée n’est pas si saugrenue qu’elle en a l’air. La plupart des lecteurs de ce texte vivent dans des États pluralistes qui sont depuis longtemps devenus multiethniques et multiculturels. “L’Europe chrétienne”, n’en déplaise à M. Valéry Giscard d’Estaing, est morte et enterrée. La civilisation occidentale actuelle est une mosaïque de couleurs, de religions et de langues, de chrétiens, de juifs, de musulmans, d’Arabes, d’Indiens et de nombreux autres, comme le sait n’importe qui se rendant à Londres, à Paris ou à Genève.
Israël a également tout d’une société multiculturelle. Mais il se distingue des États démocratiques par son recours à des critères ethnoreligieux pour définir et classer ses habitants. Il fait figure d’excentrique parmi les nations modernes, non pas - comme l’affirment les plus paranoïaques de ses défenseurs - parce que c’est un État juif et que personne ne veut que les Juifs aient un État, mais parce que c’est un État dans lequel une communauté - les Juifs - est placée au-dessus des autres, dans une époque où ce type d’État n’a pas sa place.
Pendant de nombreuses années, Israël a eu une signification particulière pour les Juifs. A partir de 1948, le pays a accueilli des centaines de milliers de survivants qui avaient tout perdu et n’avaient nulle part où aller. Sans Israël, leur situation aurait été des plus critique. Israël avait besoin de Juifs, et les Juifs avaient besoin d’Israël. Les circonstances de sa naissance ont donc lié intimement l’identité du pays à la Shoah, le projet allemand visant à exterminer les Juifs d’Europe. Toute critique contre Israël rappelle donc inévitablement la Shoah, une association que les Américains qui font l’apologie d’Israël sont prompts à exploiter honteusement. Critiquer l’État juif équivaut à penser du mal des Juifs. Le seul fait d’imaginer un visage différent pour le Moyen-Orient revient à se livrer à l’équivalent moral du génocide. Dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les millions de Juifs qui ne vivaient pas en Israël étaient souvent rassurés par sa seule existence, soit parce qu’ils y pensaient comme à une police d’assurance contre une résurgence de l’antisémitisme, soit parce qu’il s’agissait d’une façon de rappeler au monde que les Juifs pouvaient rendre coup pour coup et qu’ils le feraient.
Mais la situation s’est renversée de manière tragique ces dernières années. Aujourd’hui, les Juifs non israéliens ont la sensation d’être à nouveau la cible de critiques et d’attaques pour des choses qu’ils n’ont pas faites. Mais, cette fois, c’est un État juif, et non pas chrétien, qui les garde en otages pour pouvoir agir à sa guise. Les Juifs de la diaspora ne peuvent pas peser sur la politique d’Israël, mais ils sont implicitement assimilés à celle-ci, entre autres à cause de l’insistance et de la constance avec laquelle Israël fait appel à leur allégeance. L’attitude de cet État, qui se décrit lui-même comme un État juif, influe sur la façon dont les Juifs sont vus dans le reste du monde. Les attaques dont sont victimes les Juifs en Europe et ailleurs sont d’abord le résultat d’efforts mal dirigés, souvent de la part de jeunes musulmans, pour se venger d’Israël.
La triste vérité est que le comportement actuel d’Israël n’est pas dangereux seulement pour l’Amérique, ni seulement pour Israël, comme le reconnaissent tacitement de nombreux Israéliens ; la triste vérité est qu’aujourd’hui Israël est dangereux pour les Juifs.
Le monde d’aujourd’hui est un monde où les nations et les populations se mélangent et se marient selon leur gré, où les obstacles culturels et nationaux à la communication ont pratiquement disparu, où nous sommes de plus en plus nombreux à avoir le choix entre plusieurs identités et où nous nous sentirions lésés si nous ne devions répondre qu’à une seule.
Dans un tel monde, Israël est vraiment un anachronisme. Dans le “choc des cultures” qui se produit aujourd’hui entre les démocraties ouvertes et pluralistes et les États ethniques gouvernés par la foi, intolérants jusqu’au bellicisme, Israël risque fort de tomber dans le mauvais camp.
Faire de l’État juif qu’est Israël un État binational n’est pas chose facile, mais ce n’est pas aussi impossible qu’il y paraît : le processus a déjà commencé de facto. Et le changement causerait beaucoup moins de contrariété à la plupart des Juifs et des Arabes que ne le prétendent ses opposants nationalistes et religieux. En tout cas, à ma connaissance, personne n’a de meilleure idée : quiconque pense honnêtement que la clôture électrifiée si décriée qui est construite en ce moment résoudra les problèmes a manqué les cinquante dernières années de l’Histoire. La “clôture” - en réalité, une ligne fortifiée faite de fossés, de barbelés, de capteurs électroniques, de routes de terre (qui permettent de suivre les traces de pas) et d’un mur de presque 9 mètres à certains endroits - occupe, divise et s’approprie les terres cultivées arabes. Elle va détruire des villages, des moyens de subsistance, et tout ce qui reste de communauté arabo-juive. Elle va coûter plus de 1 million de dollars par kilomètre et n’apportera qu’humiliation et souffrance des deux côtés. Comme le mur de Berlin, elle atteste la faillite morale et institutionnelle du régime qu’elle est censée protéger.
La création d’un État binational au Moyen-Orient requiert des États-Unis qu’ils exercent leur autorité de façon courageuse et avec un engagement inébranlable. La sécurité des Juifs et celle des Arabes devra être garantie par une force internationale - quoique les militants de tout poil soient beaucoup plus faciles à surveiller pour un État binational légitimement constitué lorsqu’ils se trouvent sur son territoire que lorsqu’ils peuvent infiltrer le pays depuis l’extérieur et séduire une partie de la population en colère et qui se sent rejetée. La création d’un État binational au Moyen-Orient requiert l’émergence, aussi bien parmi les Juifs que parmi les Arabes, d’une nouvelle classe politique. En elle-même, l’idée est un mélange de réalisme et d’utopie peu prometteur, ce qui n’est pas le meilleur départ que l’on puisse prendre. Mais les autres solutions sont encore pires.
Tony Judt