Les astrologues annonçant l’arrivée de nouveaux Jeux Olympiques à l’été 2020, j’ai consulté quelques devins, adeptes du pendule et autres décrypteurs de marc de café. Ils sont catégoriques : nous devrions prochainement bénéficier d’un nouveau livre de madame Vanoyeke sur le sujet, et par ricochet, nous allons de nouveau la voir et l’entendre à la télévision et à la radio.
Elle ne manquera pas de nous rappeler qu’elle est depuis longtemps une spécialiste incontestable du sport dans l’Antiquité (avant même sa transformation soudaine et miraculeuse en égyptologue -1996), depuis son ouvrage La naissance des Jeux Olympiques et le sport dans l’Antiquité, paru en 1992 aux éditions des Belles Lettres, réédité en 2004 dans la même maison, et toujours disponible. Elle ajoutera que ce livre est régulièrement cité dans les études et les bibliographies ayant trait à l’histoire du sport.
Ce dernier point est malheureusement tout à fait exact.
Les Belles Lettres, maison spécialisée dans l’Antiquité classique, bénéficiant d’une excellente réputation, les ouvrages qu’elle publie sont systématiquement achetés par les bibliothèques, en particulier les bibliothèques universitaires. C’est ainsi que Violaine Vanoyeke est devenue aux yeux de beaucoup une référence incontournable sur le sujet, ce qui lui a valu pendant longtemps de nombreuses invitations dans des médias.
Sur le site Rakuten, le livre fait l’objet d’un commentaire plus qu’élogieux :
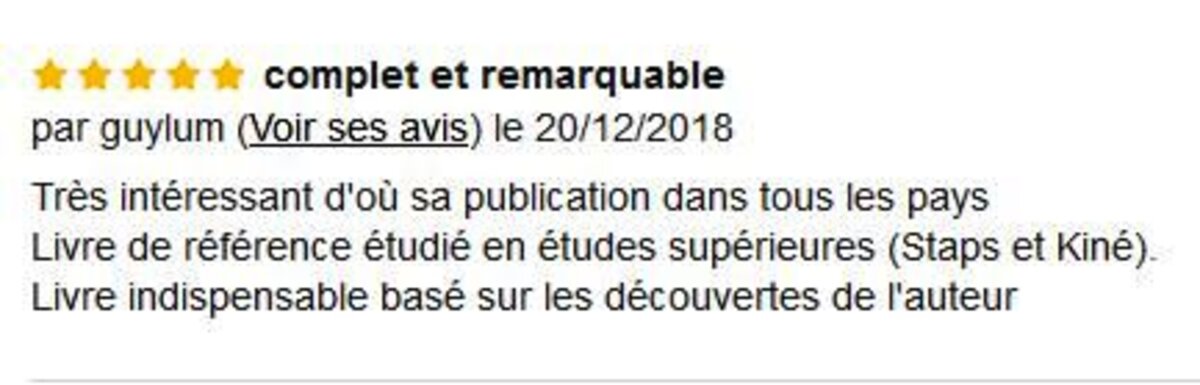
Mais nous savons, car nous l’avons déjà rencontré, qui est « guylum », et son avis manque sans doute d’objectivité[1].
Sur Amazon, l’enthousiasme est plus relatif[2] :

Agrandissement : Illustration 2
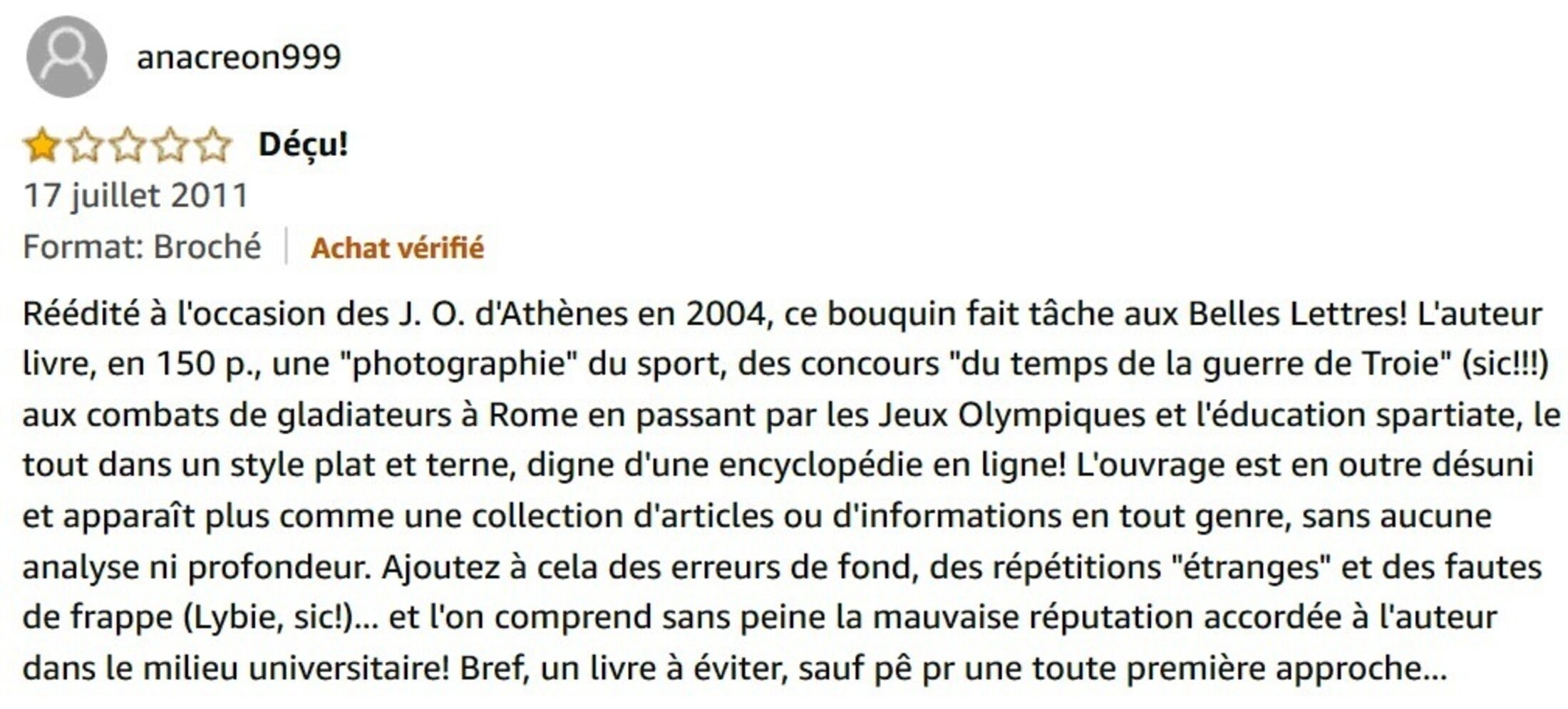
Qu’en pensent donc les universitaires spécialistes de l’Antiquité ? Ils ne sont pas nombreux à s’être exprimés. Lors de la réédition de 2004, Michel Debidour, ancien élève de l'ENS, ancien membre de l’École Française d'Archéologie d'Athènes, professeur à l'université Lyon III et directeur du Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Occident Romain, faisait part de son incompréhension : « Il manque à cette compilation une cohérence et une véritable analyse historique […]. Ce livre a été manifestement écrit beaucoup trop vite, et on ne peut que s'étonner qu'une maison sérieuse comme les Belles Lettres ait jugé bon, après douze ans, de rééditer un tel ouvrage, sans y apporter ni changement ni correction.[3] »
Cependant, la critique la plus documentée avait paru en 1995 sous la signature de Guy Lacaze, lui aussi ancien élève de l’ENS, professeur de grec à l’Université de Tours, dans une revue à la diffusion malheureusement assez confidentielle, Archipel égéen[4]. Il y dressait un catalogue sévère des innombrables et grossières erreurs, bourdes, confusions qui émaillent l’ouvrage de Violaine Vanoyeke, avant de conclure : « Dans ce livre, il est vain de chercher le rapport, la logique, la cohérence. Il vaut mieux peut-être en rester là, pour éviter de se laisser gagner par l’écœurement.
Ce travail n’a été, à l’évidence, ni pensé, ni mûri, ni même écrit. Il embrasse une matière très vaste, énorme même, mais l’érudition y est toujours maladroite, pour rester charitable, servie en vrac, dans le plus parfait désordre. […] [Cet ouvrage] est rédigé au lance-pierres. Il ne mérite certes pas le nom de livre. La démarche est sans cesse confuse, parfois puérile, le plagiat naïf omniprésent.
Tout public, et même “le public cultivé mais non spécialiste”, a droit au respect. Ce livre ne respecte pas son public. Il est regrettable que ni l’auteur ni l’éditeur ne l’aient compris. On est navré d’avoir à le dire, pour une maison d’édition qui nous avait habitués à mieux, qui est éminemment respectable, et, pour un directeur de collection qui ne l’est pas moins. »
On trouvera ci-dessous, en annexe, le texte de Guy Lacaze, que je reproduis avec son autorisation. Une lecture même superficielle de cette critique devrait permettre à chacun de se faire une idée des compétences de Violaine Vanoyeke. Je me contenterai pour ma part d’explorer plus avant une piste qu’il signale à propos du chapitre intitulé « L’éducation physique grecque » : « Il suffit de se reporter au livre d’Henri-Irénée Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité et l’on aura tout compris. » Guy Lacaze donne ensuite quelques exemples de ces « emprunts ». Il y en a bien d’autres. Voici donc un petit florilège comparatif (HIM1 = Henri-Irénée Marrou, Histoire de l’éducation… le monde grec, et HIM2, le monde romain, cités dans l’édition de la collection Points Histoire, aux éditions du Seuil / VV = le texte de madame Vanoyeke) :
HIM1 p. 65 : « A Lesbos, vers la fin du VIIe siècle, les jeunes filles pouvaient recevoir un complément d’éducation […] au sein d’une école […] sous la forme d’une confrérie religieuse, thiasos […]. Leur jeune personnalité se configure à un idéal du beau, aspirant à la Sagesse […]. On y pratique la danse collective, héritée de la tradition minoenne, la musique instrumentale […], ainsi que le chant […]. Sans être Spartiates, ces délicates Lesbiennes n’en pratiquent pas moins les sports athlétiques, et Sapho elle-même revendique fièrement l’honneur d’avoir été la monitrice d’une championne de course à pied. »
VV p. 31 : « A Lesbos […] une forme d’éducation similaire se développe dès le VIIe siècle dans la thiase (école) de Sappho[5] […]. Les jeunes filles tentent d’accéder au Beau et à la Sagesse. Elles pratiquent la danse collective héritée de la tradition minoenne, la musique et le chant, mais aussi les sports athlétiques. Sappho se déclarait fière d’avoir été la monitrice d’une championne de course à pied. »
HIM1 p. 75 : « C’est l’éducation physique qui dans cette éducation archaïque occupe la place d’honneur : il s’agit de préparer l’enfant à disputer dans les règles les épreuves d’athlétisme : course, lancer du disque et du javelot, saut en longueur, lutte et boxe […] ; il est nécessaire d’avoir reçu les leçons d’un maître compétent, le pédotribe, l’ « entraîneur des enfants » […]. L’élaboration de cette institution et de cet enseignement doit avoir été achevé dès le dernier tiers du VIIe siècle, car c’est à ce moment (précisons, pour Olympie : à partir de 632) qu’apparaissent dans les grands jeux panhelléniques les concours pour enfants. »
VV p. 34 « L’éducation sportive occupe la première place : elle consiste à préparer l’enfant à la course, au lancer du disque et du javelot, au saut en longueur, à la lutte et à la boxe, le pédotribe ayant enseigné dès le VIIe siècle, époque où apparaissent dans les jeux panhelléniques les concours pour enfants. A Olympie, ces disciplines datent de 632. »
HIM2 p. 23 : « Ce peuple de soldats-laboureurs [les vieux Romains] ne méprise pas les qualités physiques, mais l’éducation donnée à la jeunesse reste, en ce domaine comme ailleurs, strictement utilitaire ; voyez, chez Plutarque, ce que le vieux Caton fait apprendre à son fils : l’escrime, lancer le javelot, jouer de l’épée, voltiger, piquer chevaux et manier toutes armes ; combattre à coups de poing, endurer le froid et le chaud, passer à la nage le courant d’une rivière impétueuse et froide. »
VV p. 63 : « Chez ce peuple de soldats-paysans qui ne méprise certes pas les qualités physiques, l’éducation reste utilitaire. Ainsi Caton fait-il apprendre à son fils l’escrime et le javelot ; il doit savoir voltiger, piquer chevaux et manier toutes armes ; combattre à coups de poing, endurer le froid et le chaud, traverser une rivière à la nage malgré le courant froid et agité. »
HIM2 p. 36 : « Un certain engouement se manifesta pour la musique, le chant et la danse […] mais bien vite il se trouva l’objet d’une vive réaction de la sensibilité nationale […] : déjà Scipion Émilien ne parle des écoles de musique et de danse que pour flétrir le penchant de ses jeunes contemporains pour cet art déshonnête et impudique, bon pour des histrions, non pour des enfants de naissance libre et a fortiori de rang sénatorial. »
VV p. 66 : « Les Romains manifestent même un certain intérêt pour la danse soulevant la colère de Scipion Émilien qui juge cette discipline plus proche de l’art que du sport, déshonnête et impudique, bonne pour des histrions mais non appropriée à des enfants de naissance libre et de rang sénatorial. »
HIM2 p. 108 « Des collèges de jeunes gens paraissent avoir existé depuis longtemps, groupés autour de ces anciens sanctuaires que la renaissance augustéenne relevait avec piété ; nous trouvons même, à Tusculum, une sodalitas de jeunes filles organisée à l’ombre d’un vieux culte municipal. »
VV p. 69 « Des collèges de jeunes gens se forment alors autour d’un sanctuaire. A Tusculum se trouve même une sodalitas de jeunes filles organisée autour d’un vieux culte municipal. »
Ce ne sont que quelques miettes, et on pourrait aligner plusieurs pages de ces « emprunts forcés » au livre d’H.-I. Marrou. Encore ne concernent-ils ici qu’un seul ouvrage ; il y a fort à parier que d’autres auteurs ont été victimes de ce copillage.
Il est alors presque cocasse de trouver dans un document pédagogique universitaire produit en 2015 par l’Université du Québec à Montréal deux éléments dont la rencontre semble assez problématique ; c’est d’abord un avertissement tout à fait légitime :
« Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement » Est en particulier fermement prohibée « l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de référence ».
Le cours en question portant sur l'histoire de l'éducation physique, on est quand même ensuite un peu surpris de trouver mentionné dans la bibliographie le livre de madame Vanoyeke, alors que l’ouvrage fondamental d’Henri-Irénée Marrou en est absent… Une plagiaire donnée en exemple ! On ajoutera que parmi les objectifs pédagogiques affichés figure la capacité d’ « agir en tant que professionnelle ou professionnel héritier, critique et interprète d’objects (sic) de savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions[6]. » Je n’ose espérer que le livre de Violaine Vanoyeke a pu servir dans cette université à des séances d’exercice de l’esprit critique, ce qui me paraît hélas constituer sa seule utilité potentielle.
Annexe : extrait de l’article de Guy Lacaze.
L’érudition de ce dernier le conduit parfois à être un peu allusif. J’ai indiqué en notes quelques éclaircissements.
Archipel égéen 1992 Fascicule 2 Pages 1-51 (paru finalement en 1995)
Publications de l’Université de Tours, Département d’Études helléniques
Guy Lacaze « Tristes topiques : du miracle grec en général et du commerce des livres en particulier »
(Extrait concernant La naissance des Jeux Olympiques et le sport dans l’Antiquité, de Violaine Vanoyeke.)
“Comptez vos hommes, comptez-les bien”, conseillait P. Chaunu. V les a comptés ; elle en a dénombré six millions à Olympie. Ne serait-ce pas là le véritable miracle grec ? C’est dans La naissance des Jeux Olympiques et le sport dans l’Antiquité (Paris, Les Belles Lettres 1992) que l’on trouve ce compte fantastique qui est appelé à faire date.
Malheureuse V ! Partant du principe que l’on n’est jamais aussi bien cité que par soi-même, elle mentionne dans la bibliographie de ce livre sa Prostitution en Grèce et à Rome (même éditeur, 1990). Elle eût mieux fait de renoncer à une telle publicité, d’autant que les rapports entre sport et prostitution ne sont rien moins qu’évidents. Rendant compte de cet ouvrage dans Topoi 2, 1992 (pp. 285-289), F. Picard n’avait pas été tendre : “C’est peu dire qu’on est déçu : ce livre étonnant à beaucoup d’égards pourrait servir, comme |recueil d’exemples de ce qu’il ne faut pas faire, à l’édification des apprentis historiens.” V pourra toujours alléguer pour sa défense qu’elle aurait été bien en peine de tenir compte de ces remarques, parues trop tard, et de cette critique assassine et amplement méritée. C’est donc en confiance qu’elle a récidivé ; il faut dire que là, elle s’est surpassée.
Le morceau de bravoure du livre se trouve p. 74 : “les récits mythologiques entraînent une grande confusion sur l’origine des jeux auxquels assistent très vite 5 à 6 millions de Grecs de même race, de même religion, de même civilisation.” Très vite, cela veut dire sans doute dès le VIIIe siècle ou au plus tard courant VIIe. Il est infiniment probable que la population de la Grèce à l’époque n’atteignait pas la moitié de ce chiffre. Paul Faure estime que la péninsule grecque ne pouvait nourrir plus de 3 millions de personnes, hommes libres ou esclaves. Et n’oublions pas que les femmes, en dehors de la prêtresse de Déméter Chamynè, n’avaient pas le droit d’assister aux Jeux. Il faut donc inclure dans ce chiffre astronomique les Grecs de la diaspora (Amérique, Australie, Égypte). Peut-être V a-t-elle voulu, pour faire le compte, étendre son dénombrement aux téléspectateurs – le stade ne pouvant contenir, au grand maximum, qu’une quarantaine de milliers de personnes –, qui suivaient grâce au satellite et au câble les épreuves devant leurs récepteurs de télévision, – qui sait même qu’il n’existait pas, en l’occurrence, une chaîne sportive cryptée ?
On suppose qu’Olympic Airways, la bien nommée en l’occurrence, avait prévu une rotation accélérée de charters pour le transport de ces millions de personnes, que la firme d’Atlanta parrainait les jeux et étanchait la soif des spectateurs – il fait chaud l’été à Olympie ! – et sans doute aussi que Mac Donald’s s’occupait de la restauration rapide de masse.
Il est honteux – je pèse mes mots – qu’une telle énormité, crevant le plafond du ridicule et du bouffon, ait échappé, je ne dis pas à l’auteur – ne demandons pas l’impossible – mais à un directeur de collection et à un éditeur qui viennent de laisser passer coup sur coup deux livres pareils, au risque de discréditer l’ensemble de la collection Realia, voire les Belles Lettres.
Si encore les bévues de V s’arrêtaient là, elle aurait droit à une certaine indulgence. Mais que découvre-t-on dans sa bibliographie ? D’autres énormités ! Les titres y sont alignés pêle-mêle, qu’elle n’a probablement pas tous lus et qui font grosse impression par leur nombre, encore que pour ne prendre qu’un exemple, Moses Finley et Pierre de Coubertin ne tirent pas dans la même catégorie. On y apprend que Bengtson a été édité à Stuttgart par Verlag (édition !), qu’Heiligtum en allemand prend deux l, que sport en Italien est féminin (la sport), que Banten (pour Bauten) désigne les édifices en allemand, que le fameux sauteur en longueur Phaÿllos s’appelait Phayilus, que Grèce en italien se dit Graecia (pour Grecia), que Manolis Andronikos a écrit un Olympie ekdotike (ce terme signifie édition en grec, et la référence exacte est évidemment Ekdotike Athenon, largement connue en Grèce et à l’étranger) ; deux lignes plus bas, Ekdotike apparaît comme un sanctuaire ou un site archéologique doté d’un musée (les musées de Corinthe, de l’Isthme, Ekdotike, Athenon, 1984), et à la dernière ligne, Bescreibung tient lieu, pour Beschreibung, de description pour les ruines de Priène. A voir comment elle cite l’allemand et l’italien, on doutera que V ait lu les titres qu’elle mentionne dans ces deux langues. Son éditeur aurait dû lui remettre des épreuves, pour qu’elle pût procéder aux ultimes corrections. Il est à craindre, hélas ! qu’il n’y ait pas eu plus d’ultimes corrections que de premières. Ce ne sont là, dira-t-on, que lapsus dus à une rédaction ou à une lecture trop hâtives. C’est possible en effet, même si c’est regrettable.
Mais que dire (p. 49) d’une définition de l’éphébie qui fera bondir tous les historiens, et quelques autres aussi (avoir vingt ans dans le Parnès !) : “l’éphébie représente un enseignement fait de rhétorique, philosophie, médecine et gymnastique. Ce cycle d’études est accessible à une élite riche et douée.” Mais on lit p. 43 : “L’éphébie attique forme un soldat, une espèce de service militaire” ; et p. 50 : “enseignement supérieur et gymnastique” et plus bas on ajoute à ce programme les lettres, et les sciences et les arts. Il ne manque plus que les sciences humaines. Certes il vaut mieux lire cela que d’être aveugle, mais enfin… L’imposture a ses limites, non ? C’est tout simplement aberrant. Point n’est besoin d’avoir lu la thèse de Chrysis Pelikidis, Histoire de l’éphébie attique, 1962, pour savoir que cette institution était celle du service militaire obligatoire. On le trouve même dans La vie quotidienne au temps d’Homère d’Emile Mireaux ; on le trouve dans tous les manuels, dans les guides, dans les aide-mémoire. Alors, quand la quatrième de couverture nous présente ainsi le livre : “rigueur scientifique, anecdotes révélatrices, analyses historiques” et l’auteur comme “professeur de lettres classiques, historienne”, trop c’est trop : c’est proprement scandaleux. Je veux bien que la collection Realia soit destinée au grand public, mais le grand public mérite mieux que cela. Je cite Jean-Paul Néraudau (deuxième de couverture) : “Mode de relation avec un public qui ne soit pas spécialisé dans ces sujets”, “langage qui puisse être entendu de tous, sans trahir les exigences de la vérité et de la rigueur”, “les textes présentent l’état actuel de la connaissance dans les divers domaines qu’ils abordent”. Il serait cruel d’insister.
V est poétesse et romancière. Je refuse de me prononcer sur ses compétences d’historienne. Mais elle ne connaît manifestement rien au sport, même si elle partage cette lacune avec bon nombre d’auteurs qui ont pris au sérieux l’affirmation extravagante, insensée, selon laquelle Phaÿllos de Crotone aurait, grâce à ses haltères, sauté à plus de seize mètres (p. 40). Qu’un saut dont on n’est pas sûr qu’il ait été effectué avec élan – les haltères pouvant en tenir lieu –, et qui remonte à plus de 2000 ans, puisse représenter le double de la performance historique de Beamon, du record de Powell, des fantastiques séries de Lewis, cela passe l’entendement. Les gens sérieux ont essayé de retrouver sous l’absurde une apparence de raison, en envisageant la possibilité d’un triple saut, en lieu et place d’un saut en longueur simple, voire l’addition des trois meilleurs sauts d’une série – ce qui est au demeurant peu plausible. Il est évident, pour quiconque est doué de bon sens, qu’une telle performance ne sera jamais atteinte, même dans des siècles, quand on devrait pourvoir de ressorts les pointes de sauteurs.
Après cela, on s’étonnera moins de lire que le Kronion (p. 75) qui culmine à quelques dizaines des mètres au-dessus de l’Altis[7], est la “montagne qui domine l’Olympe”, lequel, non content de s’élever à 2017 m. se trouve à quelques centaines de kilomètres d’Olympie et de son Kronion.
Voilà ce que c’est que d’écrire plus vite que son ombre ! On ne s’étonnera pas davantage (p. 29) de voir dans la relation pédérastique, l’éraste représenter l’aimé, et l’éromène “l’adulte, celui qui forme son cadet”[8]. On ne sait dans quelle édition notre professeur de lettres classiques a lu Platon, mais ce devait être au moins une édition ad usum delphini[9]. Les Courètes (p. 17), souvent écrit Curètes, sont “des maîtres spécialisés de sport et de préparation militaire en Crète, en Etolie, en Eubée” qui forment à l’époque de la guerre de Troie “ceux des jeunes gens qui se destinent à la guerre” (faut-il comprendre qu’ils envisagent de faire carrière dans l’armée ?). V. eût pu consulter H. Jeanmaire, Couroi et Courètes, pour y lire p. 437 : “Conçus de façon collective, les Courètes font partie, au même titre que les nymphes et les autres divinités, de la population surnaturelle qui constitue la totalité des alliances divines dans les cités crétoises ; ils sont mentionnés dans la récapitulation qui prend place à la fin des serments qui interviennent entre cités crétoises.” C’est ainsi qu’Héraklès (p. 75) est présenté comme un prêtre (pour le jeu de mots avec Curètes ?), ailleurs comme un Dactyle. V ne s’est pas rendu compte que ce fils d’Alcmène est distinct du Dactyle Héraklès, assimilé plus tard avec ses frères aux Courètes. La méthode de notre auteur implique de fréquents télescopages entre fiches. P. 75 toujours, “les Curètes s’appelaient Heraklès, Peoneos, Epimédès, Iasos, Idas. Héraclès proposa une course à ses frères. Comme ils étaient cinq (précisons : en comptant Héraklès ; précisons encore, puisque ce n’est pas dit : les Curètes sont des frères), on renouvela la compétition tous les cinq ans” (en fait, tous les quatre ans !). Comprenne qui pourra et Dieu sauve le demeurant !
Pour gagner du temps, car l’établissement d’un tel sottisier est du temps perdu, citons pêle-mêle les plus belles perles du livre : “On doit aux soldats la création des jeux funèbres où se déroulent à l’origine de grandes compétitions sportives et des concours hippiques” (p. 18). La “méthode” adoptée pour le chapitre I, “L’éducation physique grecque”, est d’une simplicité biblique : il suffit de se reporter au livre d’Henri-Irénée Marrou, Histoire de l’éducation dans l’Antiquité et l’on aura tout compris. Qu’on en juge un peu. Subdivisions de ce chapitre dans Marrou : l’éducation homérique, l’éducation spartiate, de la pédérastie comme éducation, l’ancienne éducation athénienne ; subdivisions de V : l’éducation physique à l’époque de la guerre de Troie 1250 avant J.-C. ; heureuse V qui peut dater cette guerre à un an près ! (Les historiens en discutent encore, et ne peuvent pas prouver formellement qu’elle a bien eu lieu) ; l’éducation spartiate ; la pédérastie ; l’évolution de l’éducation physique à Athènes. Et voilà comment on écrit l’histoire ! Marrou, p. 64[10] : “Le temps de la lune de miel achevé, (l’éphèbe) recevait une armure de la part de son amant dont il devenait le parastatheis, l’écuyer.” V p. 29 : “La lune de miel achevée, l’éphèbe reçoit une armure de son amant dont il devient l’écuyer, parastatheis.” Outre que parastatheis, en lui-même, ne peut évidemment pas avoir ce sens, on admirera la diligence avec laquelle V se démarque de Marrou. Et ce n’est pas tout ! La page 77 de Marrou[11] (choix d’un prénom pour l’auguste fils de Strepsiade et de son encésyrée[12] d’épouse) se retrouve chez V p. 33, mais transcrite avec une maladresse qui la rend en partie inintelligible. Bref, les défauts dénoncés par F. Picard pour le premier livre sont encore plus choquants, plus caricaturaux dans le second. Et l’on oserait appeler cela un livre ! C’est un travail de copiste, de plagiaire tout simplement.
Mais revenons-en à nos “soldats” de la page 18 et non de l’an II. Nous avons là une lecture très personnelle (il ne fait pas prendre cela pour un compliment) du chant XXIII de l’Iliade, qui oublie le témoignage de Nestor sur les jeux funèbres d’Amaryncée (ils ne doivent rien aux soldats) et les Jeux chez les Phéaciens, ce peuple n’ayant rien de guerrier et l’avouant de bonne grâce. “L’archéologie confirmera d’ailleurs l’existence d’un sanctuaire et d’un village à Olympie dès le milieu de l’Age de Bronze” (p. 18). On aura reconnu, bien sûr, le village olympique ! Je ne sais de quelle archéologie V parle ici, mais l’archéologie allemande, qui n’a cessé de fouiller à Olympie, ne dit rien de tel. A. Mallwitz, directeur des plus récentes de ces fouilles, écrit en effet : “Aucune trouvaille du sanctuaire n’est antérieure à l’époque géométrique ; aucun niveau mycénien n’est attesté ; le culte de Zeus est le plus ancien en ce lieu et ne remonte pas au-delà du X° siècle.” Les maisons à abside de l’HM ne prouvent rien là-contre.
Page 19 : “Antilochos se souvient des conseils de son père Nestor et confie autant de leçons de sagesse au jeune Grec qui le lira.” J’ignorais qu’Antilochos eût écrit l’Iliade ; c’est très intéressant. Et je me demande qui a édité ses Mémoires : est-ce Verlag à Munich ou Ekdotikè à Athènes ?
Page 23 : Athénée, plus connu comme auteur des Deipnosophistes, se retrouve de façon cocasse en avatar de la déesse Athéna (Athéné en ionien).
Page 31 : Le “thiase (école) de Sappho”, qui doit évidemment beaucoup sinon tout, à Marrou, devient un mot féminin : la thiase. Certes, nous sommes à Lesbos, mais tout de même. On se demande où V a appris le grec, et surtout comment elle l’enseigne.
Page 35 : “L’athlète oint son corps d’huile et se fait accompagner du hautbois pendant les exercices, coutume, selon Thucydide, d’origine spartiate.” Le malheur veut que Thucydide, longuement cité par V, ne mentionne nullement le hautbois en question.
Page 37 : “C’est pourtant dans un gymnase que Platon immortalise l’Académie.” V. n’a pas l’air de se douter que l’Académie est un gymnase, avant d’être une école philosophique ; tout comme le Lycée du reste.
Page 43 : l’Isthme de Corinthe devient “la glorieuse Isthme”, mais empressons-nous d’ajouter que Pindare n’y est pour rien, même si V prétend ainsi le citer.
Page 47 : La χειρονομία, qui est habituellement un substantif féminin singulier, devient un pluriel énigmatique, les cheironomia… Comprenne qui pourra !
Page 55 : Une citation de Lucien (ou Lucius) est détournée de son contexte de façon très drôle : “Prends garde de recevoir de bonnes corrections si tu ne fais pas les mouvements prescrits.” Le texte que cette citation est censée illustrer est le suivant : “Le coureur qui démarre avant le signal est même battu”, à moins qu’il ne faille remonter plus haut, jusqu’à “drapé dans son himation, le pédotribe n’hésite pas à frapper l’élève maladroit ou tricheur.” Quelle importance au demeurant ? Il s’agit en fait d’une scène de l’Ane à l’érotisme torride qui ferait rougir jusqu’aux oreilles un collégien, entre le jeune Loukios et l’accorte servante Palaistra (Palestre) qui joue effectivement au pédotribe. Mais le Kama Soutra est à côté une lecture pour enfants de choeur !
Page 58 : On imagine difficilement à quoi peut ressembler, dans le gymnase, un “magasin à poussières” (sic).
Page 71 : S’il est vrai que, dans une des nombreuses variantes du mythe, Héraklès tue Augias après avoir nettoyé les écuries – et non après les avoir détruites –, ce n’est certainement pas “afin de s’approprier son trône” (sic), puisqu’il établit alors comme roi d’Elide (que V confond volontiers avec la ville d’Elis) Phylée, le fils de sa victime.
Même page : les Crétois ne se sont jamais “exercés au combat contre les taureaux”, mais aux acrobaties taurines, ce qui n’est pas la même chose. Le décor mural de Santorin n’atteste en aucune façon le “caractère religieux” des “sauts périlleux”. Et les acrobaties taurines, à ma connaissance, sont totalement absentes de l’iconographie d’Akrotiri.
On admirera au passage, dans ces pp. 71-73, l’art de la composition chez V : un développement sur le sport crétois (qui lui permet implicitement p. 72 de situer Vaphio en Crète alors qu’il est sur le sol de Laconie), qui ressemble fort à un fourre-tout, et que le désir forcené de faire tenir une encyclopédie en deux cents pages de format réduit transforme en un amas de fiches à peu près inintelligibles) est conclu par un superbe “Vers l’an 2000 avant J. -C., les Achéens amènent à l’Égypte et à la Crète, qui l’ignorent, le cheval”, sur lequel on devrait s’interroger jusqu’à la fin des temps – au moins – et dont les historiens feront leur miel. Juste après, non pas la fin des temps mais cette formule d’anthologie, on peut lire : “De nombreuses légendes se disputent donc la naissance des Jeux Olympiques.” Voilà qui s’appelle rédiger ; il va de soi que ces Jeux n’ont rien à voir avec la Crète.
Page 73 : Notre brillante helléniste nomme execheira la trêve olympique, pour ekecheiria (ἐκεχειρία). Si elle ne connaissait pas le terme, pourtant assez commun, elle eût pu vérifier dans son Bailly, mais cela lui eût pris trop de temps. Il fallait rédiger vite et publier encore plus vite.
Page 74 : (pour Olympie) : “Au tout début n’existent qu’un sanctuaire, un autel de Zeus, un temple d’Héra, un stade.” Ce qui veut dire qu’à la fin sans doute existent deux sanctuaires, deux stades, etc. ? On se demande si elle connaît la signification du mot sanctuaire. Et ce qu’elle entend par le tout début : l’époque géométrique peut-être ? Plus bas, “Olympie étant considérée aussi comme un site mythologique”. Cette phrase avait-elle un sens pour un Grec ?
Page 75 : “L’olympisme attique s’associe à plusieurs couches culturelles : une couche pré-grecque, attestée par un règlement sportif…” !!! Faute d’écriture, il était peut-être enregistré sur cassette ou sur ordinateur ! “Chacune de ces couches se sont superposées les unes les autres”. Pour un professeur de Lettres Classiques, ce n’est pas mal !
Page 76 : Nous découvrons le prêt-à-porter de la pensée avec ces remarques de Cornford, “dans les temps mythiques, les compétences olympiques (sic, à cette date) étaient un moyen pour déterminer qui méritait d’être roi d’une région.” Or, dans tous les Jeux funèbres attestés par la tradition, c’est l’héritier en titre, le successeur désigné et incontesté qui organisme ces jeux. On doutera qu’il le fasse pour remettre en cause et en jeu(x) son autorité.
[…]
Passons (p. 77) sur Python héros delphique[13]. L’héroïsme n’est plus ce qu’il était. Méditons sur le “renouvellement des puissances souterraines obtenu par la danse et la course à pied”. À l’évidence les Jeux pythiques, qui ont été à l’origine des concours musicaux exclusivement, renouvelaient les puissances souterraines, et ils les remplaçaient par quoi ?
Page 78 : Les comptes fantastiques de V., “à titre d’exemple” – mais on ne précise pas pour quelle cité – donnent “30 amphores (environ 10 000 f.)” pour le vainqueur du pugilat et du pancrace mais “40 amphores (environ 22 000 f.)* pour le vainqueur du pentathlon et “140 amphores (environ 70 000 f.)” pour celui de la course de biges. Celui qui trouvera, sur ces bases-là, la valeur de l’amphore d’huile d’olive aura droit à son week-end à Disneyland et à une amphore panathénaïque d’époque.
Page 180 : L’idéal olympique avant d’avoir été corrompu par la Rome décadente aurait été déjà bafoué parce qu’à Olympie “les athlètes sont déjà sélectionnés, entraînés par des spécialistes, surveillés dans leur régime alimentaire” (chacun sait que les amateurs ne sont pas sélectionnés, ne s’entraînent pas, ne se surveillent pas !) et surtout parce que les athlètes “qui participent aux Jeux Olympiques au V° siècle avant J.-C. cherchent à obtenir un titre supplémentaire, celui de périodonique, de vainqueur aux Jeux Olympiques (c’est V qui souligne !). Témoin de la dégénérescence des Jeux sous les empereurs romains, Philostrate écrit : ce ne sont que des mercantiles de la valeur athlétique (sic).” On ne voit pas le rapport entre le titre de périodonique qui n’a rien d’infamant – et qui surtout s’applique aux vainqueurs des quatre grands Jeux panhelléniques, l’équivalent d’un grand chelem moderne – et la diatribe de Philostrate. De toute façon, dans ce livre, il est vain de chercher le rapport, la logique, la cohérence. Il vaut mieux peut-être en rester là, pour éviter de se laisser gagner par l’écœurement.
Ce travail n’a été, à l’évidence, ni pensé, ni mûri, ni même écrit. Il embrasse une matière très vaste, énorme même, mais l’érudition y est toujours maladroite, pour rester charitable, servie en vrac, dans le plus parfait désordre. V a dû méditer le vers de Valéry “Souvent un beau désordre est un effet de l’art”. A cette aune, son ouvrage est un chef-d’œuvre! En fait, il est rédigé au lance-pierres. Il ne mérite certes pas le nom de livre. La démarche est sans cesse confuse, parfois puérile, le plagiat naïf omniprésent.
Tout public, et même “le public cultivé mais non spécialiste”, a droit au respect. Ce livre ne respecte pas son public. Il est regrettable que ni l’auteur ni l’éditeur ne l’aient compris. On est navré d’avoir à le dire, pour une maison d’édition qui nous avait habitués à mieux, qui est éminemment respectable, et, pour un directeur de collection qui ne l’est pas moins.
Quand on est surchargé de travail comme il l’est, on délègue ses pouvoirs, mais on assure un contrôle minimum.
J’avais pensé d’abord que cet ouvrage, relu par quelqu’un de compétent, pouvait être sauvé, et même qu’il pouvait rendre certains services car les ouvrages sur le sport en langue française sont rares. Mais il contient de telles énormités qu’il vaut mieux abandonner cet espoir. En définitive, et si l’on excepte Le corps et l’esprit qui est avant tout un catalogue d’exposition, le meilleur livre en langue française sur le sport grec est peut-être une thèse d’étruscologie, celle de Jean-Paul Thuillier : Les Jeux athlétiques dans la civilisation étrusque. On n’a rien contre les Etrusques, mais que n’a-t-il fait le choix de l’hellénisme : quel beau livre il eût publié aux Belles-Lettres dans la collection Realia…
[1] Guy Lumbroso est le compagnon de Violaine Vanoyeke.
[2] https://www.amazon.fr/Naissance-Jeux-Olympiques-sport-lAntiquit%C3%A9/dp/2251338128
[3] https://www.parutions.com/index.php?pid=1&rid=4&srid=4&ida=4555
[4] On ne trouve actuellement cette revue en bibliothèque qu’à Paris, Tours et Lille.
[5] Outre que le mot thiase est masculin, il ne signifie pas « école », mais « confrérie religieuse ».
[6] On peut accéder au document (en format Word) en tapant « université Vigneault Vanoyeke» dans un moteur de recherche.
[7] L’Altis est le territoire du sanctuaire d’Olympie.
[8] C’est en effet l’inverse : dans cette relation, l’éraste est l’adulte.
[9] Les éditions « ad usum Delphini » (à l’usage du Dauphin, c’est à dire des enfants) étaient expurgées.
[10] Guy Lacaze donne la pagination de l’édition originale ; dans la collection Points Histoire, aux éditions du Seuil, c’est la p. 58.
[11] Points Histoire p. 72.
[12] Césyra était une Athénienne célèbre pour sa coquetterie.
[13] Le serpent (ou dragon) Python régnait à Delphes avant l’arrivée d’Apollon.



