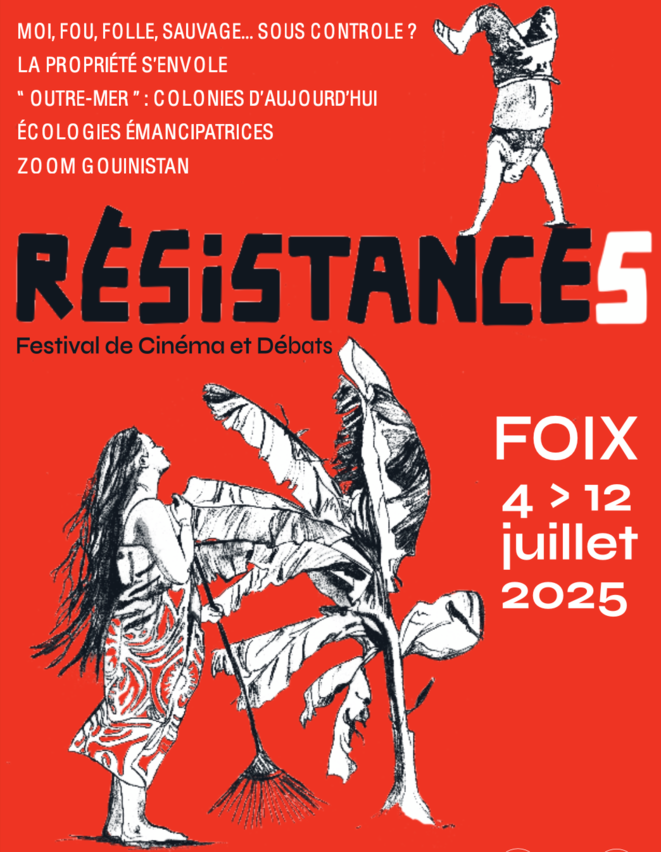Ne nous racontez plus d’histoires, de Ferhat Mouhali et Carole Filiu, est un film d’enfants qui reprennent en main leur mémoire familiale de la guerre d’Algérie. C’est le rôle de celles et ceux qui viennent après de faire l’Histoire. Ferhat est Algérien, Carole fille de pieds-noirs.
L’Histoire de la guerre est transmise de manière complètement différente en France et en Algérie. D’un côté, quelques heures à l’école, et des tentatives de commémoration qui disparaissent de l’espace public. De l’autre, la célébration, le drapeau, les chants, pour l’édification de la légende dans le coeur des enfants.
Mais ces deux blocs d’Histoire inconciliables, entretenus pas des Etats qui ont besoin de récits pour légitimer leur pouvoir, devient insuffisant pour celles et ceux qui en héritent. Le film va fragmenter peu à peu chacun des blocs. Côté français, ce sont les pieds noirs progressistes ou les porteurs de valise qui témoignent d’un autre rapport à l’autre que celui de la domination. Côté algérien, c’est la douleur des harkis ou les fosses communes d’un village massacré par erreur par le FLN qui mettent en question la légende dorée. Quête de vérité qui aboutit au constat d’une diversité.
Emergent de toutes ces rencontres deux narrations fragiles : dire ce qu’est la guerre, et se retrouver à la place du traître. La guerre d’Algérie, c’est la torture, marque indélébile pour ceux qui ont torturé comme pour ceux qui ont été torturés. Une lycéenne demande à un ancien soldat venu témoigner s’il a torturé. Oui, suivi d’un long silence. Le vieil homme à qui Carole demande s’il est retourné à la ferme améziane où il a été torturé répond non. Tout ne se met pas en mot, mais cela s’exprime.
Et puis vient la question, des deux côtés, de la place des « traîtres », celles et ceux qui en pleine guerre tentent de maintenir un lien avec l’autre. Leur présence seule est une contestation de la volonté étatique de construire des blocs de mémoire hégémonique. L’autre est le méchant, l’ennemi, celui contre lequel on construit une identité. Ces hommes et ces femmes qui à un moment de leur vie font au contraire le choix courageux de vouloir vivre avec l’autre sont les victimes du récit dominant.
Le cinéma offre alors un espace possible - celui que tente de faire exister publiquement l’association « espace franco-algérien » - pour rassembler une diversité de points de vue et commencer à tramer une histoire commune. Derrière le dos des Etats, les peuples se regardent en face.
Elodie Fuchs

Agrandissement : Illustration 1