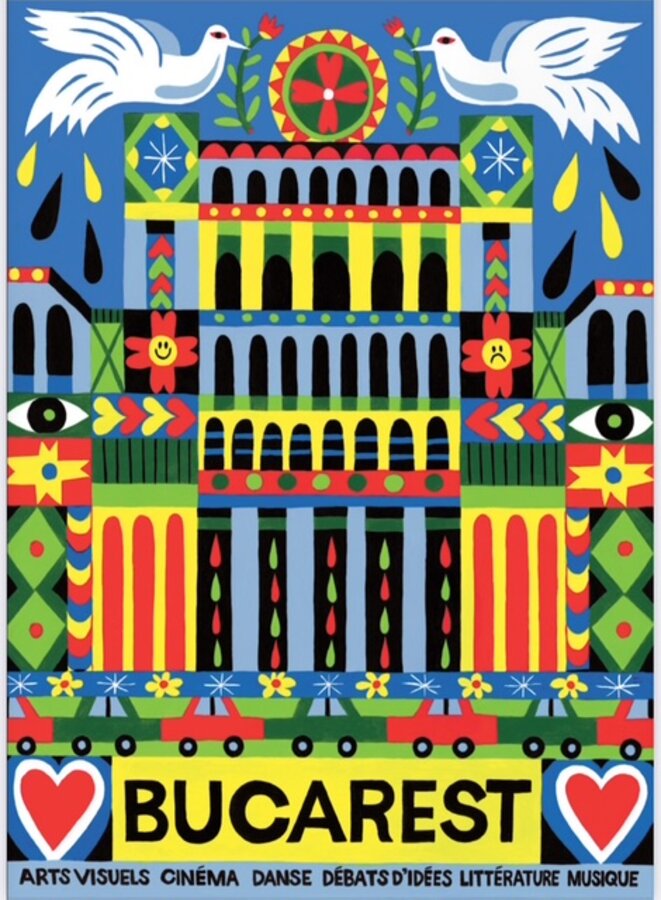Propos recueillis par Olivier Pratte
Olivier Pratte : Qu'est-ce que la préservation du patrimoine architectural en Roumanie représente pour vous ?
Ștefan Bâlici : A l’échelle locale, il n’y a pas d’intérêt particulier pour la protection du patrimoine architectural ni de la part des architectes ni de la part des maîtrises d’ouvrage, pour investir dans sa préservation. C'est ce dont je veux parler à Paris, en plus de mettre en avant certains types d'interventions et d'initiatives visant à protéger ce patrimoine rural ordinaire. Cela peut inclure des investissements locaux réalisés par des personnes qui possèdent ou achètent des maisons dans les territoires ruraux avant de les restaurer. Ce type d'initiative existe, quoique rare. Il existe également des initiatives d’ONG, de professionnels et d'organisations professionnelles d'architectes. Nous avons également, par exemple, un véritable phénomène d'écoles d'été d'architecture qui ont lieu chaque année dans les zones rurales de Roumanie, à travers tout le pays, et qui sont de plus en plus nombreuses. Elles ont autant pour objectif de préserver le patrimoine local que de le mettre en valeur et faire prendre conscience de sa valeur. Le manque de ressources est un problème, mais le principal problème est le manque d'appréciation du patrimoine ancien des bâtiments historiques par les communautés locales dans les zones rurales.
OP: Quand vous évoquez la valeur de ce patrimoine, à quoi faites-vous référence?
SP : Je fais référence aux connaissances et aux techniques constructives qui font usage des ressources locales, et même, vous savez, à la contribution humaine directe des habitants locaux, de génération en génération, qui est intégrée à un bâtiment ou à un lieu.
Soumis au développement économique du monde d’aujourd’hui, les gens commencent tout à coup à rechercher des modèles différents pour leur vie et les structures qui les habitent. Lorsqu'ils ont besoin d'une maison, au lieu de préserver celles qu'ils ont et, bien sûr, de les adapter à leurs nouveaux besoins en qualité de vie, ils préfèrent démolir et construire quelque chose de nouveau qui ressemble à ce que l'on trouve dans les villes. C'est pourquoi je dis que le plus gros problème est le manque de valorisation par les populations locales du patrimoine dont elles disposent. Mais grâce à toutes ces actions menées par les organisations, qu'il s'agisse d’écoles d'été, de projets isolés ou de réseaux de projets, on assiste également à un changement d'approche, d'attitude, et les populations locales commencent à reprendre confiance en leur environnement. C'est ce changement duquel nous sommes en quête, car il constitue la seule façon de transformer des projets en un véritable phénomène généralisé de revalorisation et de réutilisation de l'environnement bâti existant.
OP : Est-ce que ce changement s’opère aussi auprès de législateurs?
SP : Tout à fait, nous menons des actions concrètes sur ce plan (et en passant, quand je dis « nous »… je parle de tout le mouvement pour la préservation du patrimoine). En plus de réglementer la profession d’architecte en Roumanie, l’Ordre des architectes de Roumanie a toujours travaillé à la préservation du patrimoine bâti à l'aide de différents outils. L'un d'entre eux consiste à mettre en place des groupes de travail composés d'architectes de différentes régions du pays afin de rédiger des lignes directrices pour l'intégration harmonieuse des nouveaux bâtiments au tissu urbain existant ainsi que des lignes directrices pour la réutilisation des bâtiments existants. En l'espace de sept ou huit ans, nous avons réussi à couvrir l'ensemble du territoire roumain. Nous disposons d’une quarantaine de guides, chacun couvrant des zones qui sont, disons, homogènes sur le plan architectural. Ces guides ont rempli leur fonction, comme prévu. Dans certaines localités, ils ont été adoptés comme règlements par les municipalités locales. Un projet de loi visant à remplacer l'ensemble de la législation sur l'environnement bâti est en cours d'examen. La loi sur l'urbanisme, la loi sur la construction et plusieurs autres lois dans ce domaine vont être remplacées par un nouveau code, un code de la construction.
OP : Est-ce difficile de rédiger ces guides dans un pays où le paysage architectural semble changer drastiquement d’une région à l’autre?
SP : La Roumanie est une mosaïque de zones culturelles distinctes. Les grandes régions qui composent aujourd'hui le pays étaient autrefois des États à part entière. Prenons l'exemple de la Transylvanie, qui a connu sa propre évolution historique. Même au sein de son territoire, il existe une diversité très intéressante en termes de population et, bien sûr, d'architecture. C'est pourquoi je disais que nous avons plus de quarante régions avec un caractère architectural indépendant et distinct.
Nous ne voulons pas, vous savez, préserver quoique ce soit dans un état qui reste figé, mais nous voulons donner des indications sur la manière de préserver les caractéristiques fondamentales de la structure bâti, comme traiter le tissu rural, placer un bâtiment sur un terrain dans la structure bâtie et respecter les règles du lieu. Dans certaines zones marquées par un paysage culturel distinct, les bâtiments sont construits sur la rue et l'arrière du terrain n'est pas bâti ou comporte des bâtiments annexes. Dans d'autres zones, au contraire, les bâtiments sont placés au centre du terrain et sont entourés de jardins. Ce sont là des caractéristiques fondamentales de la manière dont les gens interagissaient ou agissaient en relation avec les terrains privés et les espaces publics dans un lieu donné.
Bien sûr, cela comprend aussi le choix des matériaux et des formes du bâti. Nous essayons de faire en sorte qu’au moment de construire, les gens ne créeront pas quelque chose qui détonne complètement. Ensuite, c'est à chaque architecte d'utiliser ces guides comme bon lui semble. Notre intention n'est pas de les imposer, mais de les faire accepter comme outils indicatifs.
OP : Parallèlement à ces guides, comment se manifestent les efforts déployés sur le terrain pour promouvoir la préservation du patrimoine?
SP : Certaines ONG se sont intéressées aux manoirs et aux châteaux, qui représentent un patrimoine bâti particulier, dont le destin est unique. Lorsque le régime communiste s'est installé en Roumanie, tout a été nationalisé. Les propriétaires terriens et les aristocrates ont été dépossédés de leurs biens. Leurs propriétés ont alors subi un changement brutal et ont servi à toutes sortes d’usage. Ainsi on a logé du bétail dans d'anciens manoirs, certains ont accueilli des hôpitaux ou des installations agricoles pour les coopératives agricoles nouvellement créées.
Après les années quatre-vingt-dix, la propriété privée a été restituée par l'État, une initiative bonne en soi, mais qui a été mal gérée. À ce jour, soit trente-cinq ans après la révolution, des procès sont toujours en cours pour déterminer qui est l'héritier légal de telle ou telle propriété. Cela a entraîné une longue période d'incertitude et de droits de propriété flous pour toute une catégorie du patrimoine bâti. Et en conséquence, ces propriétés ont été détruites à grande échelle. Certaines ont été pillées jusqu'à la dernière brique, d'autres ont été endommagées à des degrés divers. Aujourd'hui, de nombreuses ONG à travers tout le pays déploient des efforts considérables pour sauver ce type de patrimoine, soit lorsque les droits de propriété sont clairs, que l'identité des propriétaires est connue et que les choses peuvent revenir à la normale, soit lorsque les droits de propriété restent flous, auquel cas l’on veut s’assurer que les bâtiments continueront d’exister. Il y a toutes sortes de projets pour la préservation de cet héritage.
Nous avons mené à bien des projets de restauration et de transformation de ces manoirs ou palais, dont certains sont désormais utilisés comme résidences privées, tandis que d'autres sont destinés à un usage public. Certains ont été transformés en restaurants ou en hébergements touristiques, créant ainsi une activité économique qui a permis de redynamiser tout un village.
Dans le nord de la Moldavie, par exemple, un magnifique manoir néoclassique dans le village de Călineşti, même s’il a été vandalisé et dépouillé de tout son mobilier historique, est resté en place et a été restauré il y a déjà une vingtaine d'années. Le propriétaire, qui avait une entreprise en Allemagne comme beaucoup d'autres propriétaires ayant émigré après l'avènement du communisme, possédait une galerie d'antiquités à Munich. À son retour dans les années 90, il a remplacé le mobilier du manoir par des pièces de grande valeur provenant de sa propre collection d'antiquités. Et en se fiant à ses souvenirs d'enfance concernant la manière dont le manoir était meublé, il a essayé de recréer son atmosphère d'antan.
Sur les terres agricoles du manoir il se passe aussi quelque chose d’intéressant. Une usine de transformation des pommes de terre qui servait dans les années 60 ou 70, à l'époque communiste, a été convertie en une salle qui accueille notamment des concerts de musique classique attirant les foules et de grands artistes.

Agrandissement : Illustration 1

Je suis architecte, donc la restauration de maisons est au cœur de mon travail, mais les maisons n'ont aucun sens si personne ne les apprécie, n'y vit et ne les utilise.
OP : Est-ce que l’on retrouve aussi ces manoirs en Transylvanie ?
SP : En Transylvanie, et plus particulièrement dans le sud de la Transylvanie, il existe une région composée de villages construits par des communautés qui ont été colonisées par l'Empire austro-hongrois pendant plusieurs siècles. On appelait les membres de ces communautés les Saxons de Transylvanie, même s'ils ne sont pas saxons au sens littéral du terme, bien qu'ils soient germaniques. À partir du XIIe siècle et jusqu'au XIVe siècle, ces Saxons ont obtenu certains droits d'autonomie dans le sud de la Transylvanie, contrôlé alors par l'Empire austro-hongrois, pour y défendre ses frontières contre les invasions étrangères. Au milieu des vagues d'invasions (ottomanes, entre autres) qui commençaient à déferler dans la région, ils ont commencé à fortifier leurs églises. Aujourd'hui, on y retrouve plus de deux-cents villages dont l’église est entourée de fortifications.

Agrandissement : Illustration 2

Il s'agit là d'un autre type de patrimoine particulier, difficile à gérer. Je vous explique. Germanophones, les Saxons de Transylvanie se sont en grande partie sentis menacés par l'occupation soviétique de la Roumanie qui a conduit à des déportations massives d'Allemands vers la Sibérie (certains sont revenus et d'autres non). Cet épisode traumatisant de leur histoire, conjugué à l'ouverture des frontières en 1990, a poussé de nombreux Saxons de Transylvanie, méfiants envers la Roumanie, à partir pour l'Allemagne qui les a accueillis en tant que peuple germanophone. En 1991, en l'espace d'environ six mois, quelque 200 000 personnes ont quitté la Roumanie pour l'Allemagne, laissant derrière eux ces villages désertés. Aujourd’hui, il subsiste peut-être environ 40 000 Saxons de Transylvanie en Roumanie.
Leur communauté n'est plus très active et il ne reste plus personne pour préserver leur patrimoine. Les Roumains, et en particulier une grande partie de la population rom, se sont installés sur le territoire qu’ils occupaient sans avoir de lien direct avec ce patrimoine. Il a donc été très difficile de savoir comment le préserver.

Agrandissement : Illustration 3

Depuis de nombreuses années, plusieurs ONG s'efforcent de créer des liens entre les habitants actuels de ces villages et ce patrimoine, tout en le restaurant bien sûr. Par restauration du patrimoine, je fais principalement référence aux églises fortifiées, dont certaines sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Construites pour la plupart au XVIIIe siècle, elles sont en brique ou en pierre. D'autres, plus anciennes, ont été construites en bois, avant que les nombreux incendies qui ont dévasté les villages mènent à l'interdiction de construire en bois.
OP : Comment les ONG approchent-elles la restauration du patrimoine de villages désertés par leur communauté d’origine?
SP : Les ONG ont contribué à la création de nouvelles communautés et ont fait en sorte que celles-ci s’approprient ces lieux, notamment grâce à des activités économiques liées au patrimoine bâti.
Un exemple intéressant est le Mihai Eminescu Trust. Depuis ses débuts dans les années quatre-vingt-dix, cette ONG, la plus importante dans la région, je crois, a mené 1 200 projets à bien allant du ravalement de la façade d'une maison afin qu'elle retrouve sa dignité à la création d'un atelier de forge pour une famille de Roms doués dans cette activité en passant par la restauration d'églises fortifiées, la replantation de forêts dans la région et la création de systèmes d'égouts écologiques.
Il existe également une autre ONG que je voudrais mentionner et qui se consacre à d'autres types de projets. Elle s'appelle l’Ambulance pour les monuments. Lorsque j'ai entendu ce nom pour la première fois, j'étais incrédule et je pensais que ce projet n’allait pas fonctionner, mais c'est pourtant le cas. Tout a commencé dans un village avec un jeune architecte né dans ce village du sud de la Transylvanie. Lorsqu'il a commencé ses études à l'université de Bucarest, il a suivi une formation d'architecte, mais il est ensuite retourné chez lui avec l'idée de constituer une équipe de quelques personnes pour lancer des ateliers mobiles destinés à fournir une aide d'urgence aux bâtiments historiques menacés, en échange de nourriture, d'un logement et de matériaux locaux.

Agrandissement : Illustration 4

L’équipe s’est d’abord occupée des églises, dont beaucoup avaient été abandonnées au profit d’églises plus grandes et plus modernes. Dès que l’existence de ces églises en bois datant des XVIIIe et XIXe siècles (certaines sont même plus anciennes) est rappelée aux membres de la communauté, il est alors facile de créer un attachement.
L’Ambulance pour les monuments a été l’instigatrice d’un phénomène incroyable. Parmi les étudiants en architecture, rejoindre les rangs de l'«ambulance » est devenu une sorte de titre de noblesse. C'est très attrayant pour eux, car nos écoles d'architecture ne dispensent pas de cours pratiques sur le métier, sur la construction proprement dite. Il est très important de comprendre les choses de ce point de vue également, et de simplement faire avec un marteau, un clou et un morceau de bois. J'encourage mes étudiants de l'université d'architecture de Bucarest à suivre des cours d'été, à travailler directement auprès des gens et à comprendre les rapports qu’ils établissent à ce patrimoine.

Agrandissement : Illustration 5

Ce n'est pas un succès total, mais la transformation est visible. J'ai visité ces villages pour la première fois en tant qu'étudiant dans les années 90, et je constate aujourd'hui leur évolution. Il y a eu d'énormes améliorations dans tous les domaines. L'État roumain a également beaucoup investi dans les infrastructures, la construction de routes et de services publics, mais en matière de patrimoine et d'architecture, le mérite revient en particulier à ces ONG.
OP : Diriez-vous que l'architecture de Bucarest reflète la diversité du pays ?
SP : Bucarest est différente. Elle présente, bien sûr, quelques-unes des particularités que l’on retrouve dans le paysage architectural de tout le pays, mais son héritage est aussi, et en grande partie, le reflet de projets politiques d’État.
Bucarest était une petite ville médiévale jusqu'à la fin du XIXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, deux États, la Moldavie à l'est et la Valachie au sud, se sont unis, se donnant pour la première fois le nom de Roumanie. Peu après, en 1866, il été décidé qu’un roi issu d'une dynastie étrangère allait être élu pour gouverner le pays afin de gérer les conflits entre les différentes autorités locales. Issu d’une famille allemande, le roi était un personnage vraiment fantastique, très jeune à son arrivée en Roumanie avant de régner pendant 50 ans, période qui a été marquée par un développement important. Des architectes de toute l'Europe occidentale ont conçu des bâtiments pour le nouvel État à Bucarest, y compris des institutions et des écoles qui portent la marque de l'architecture d’inspiration française ou du style éclectique européen. Parallèlement, entre les années 1890 et 1930, le style néo-roumain est apparu et s’est aussi imposé dans l’architecture. Partout en Europe, chaque pays, chaque nation essayait de s'exprimer à travers l'architecture. Cela s'est également produit en Roumanie, où l'architecture médiévale des monastères et des églises a servi d’inspiration. La mairie de Bucarest en est un bon exemple.
Bucarest est aussi différente des autres régions du pays que celles-ci le sont entre elles.
Architecture et engagement civique des architectes dans la ruralité
Stefan Balici, Joanne Vajda
École d’architecture Paris-Malaquais
24 novembre à 18 h
Info : www.weekendalest.com