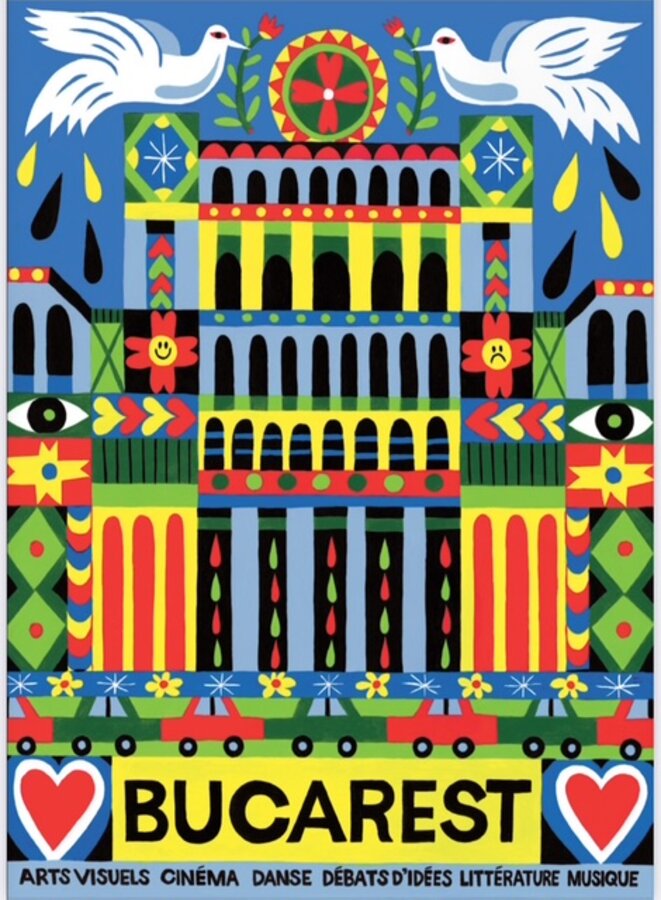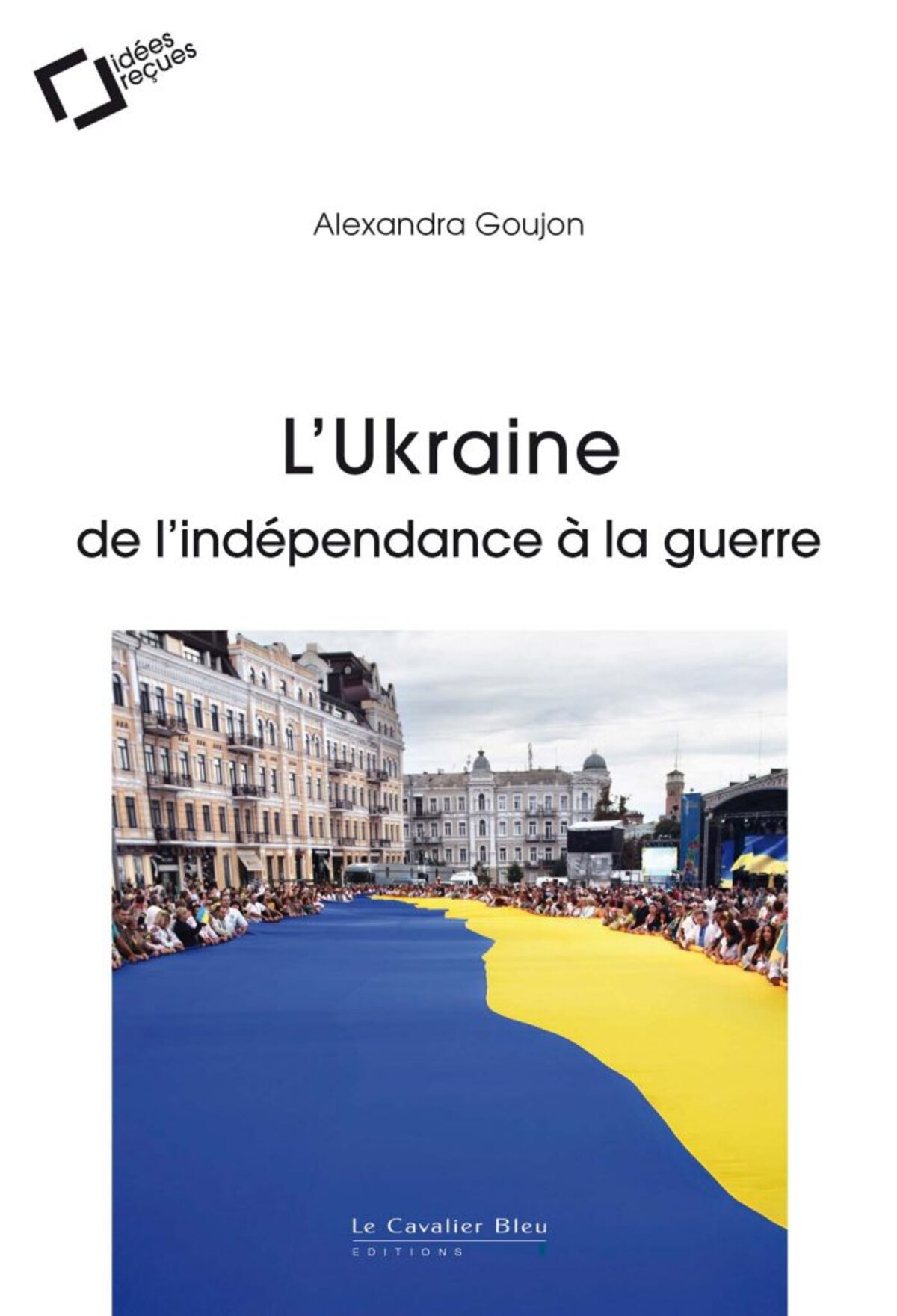
Agrandissement : Illustration 1
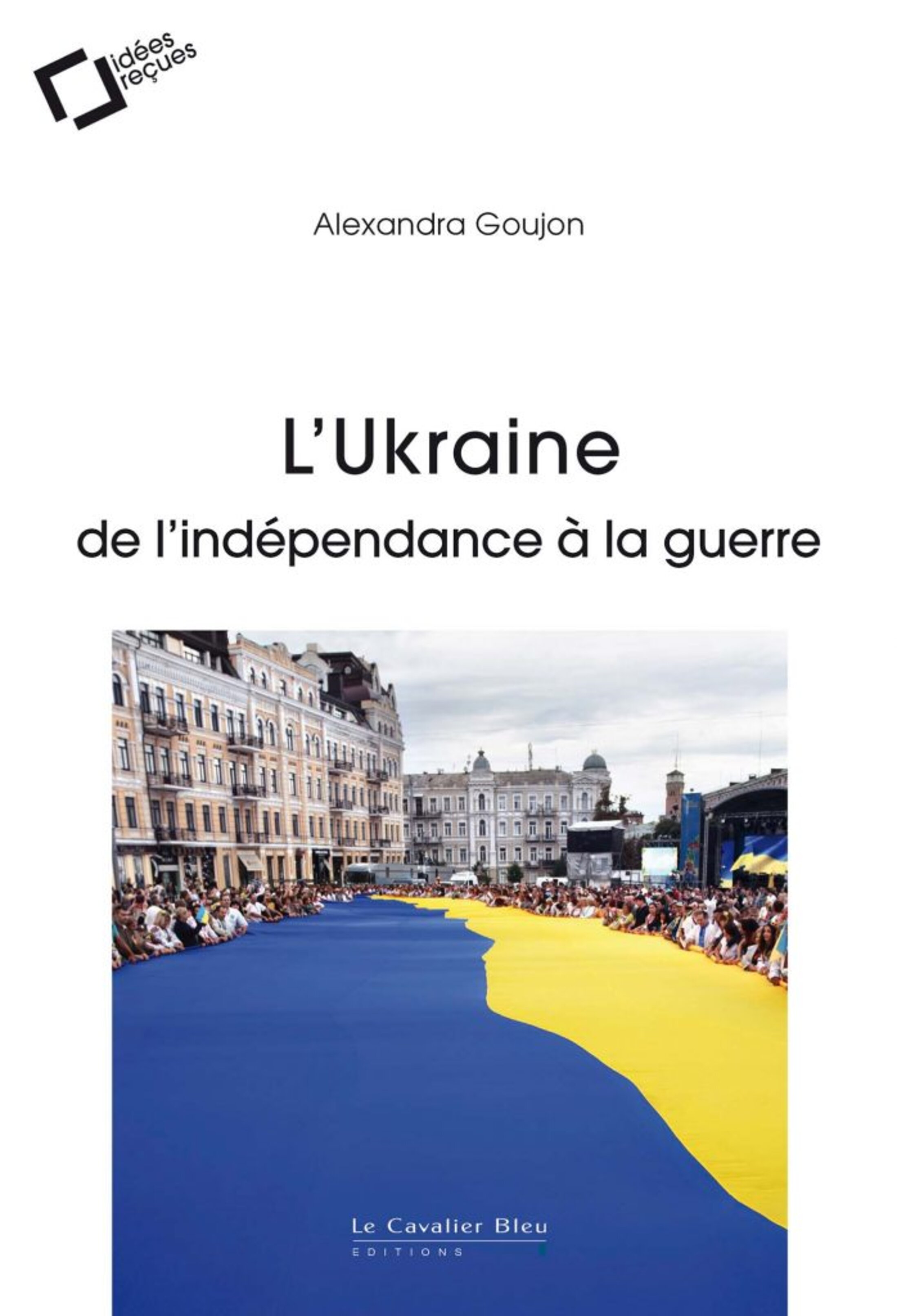
Spécialiste de l’Ukraine, Alexandra Goujon est politiste, maître de conférences à l’Université de Bourgogne et enseignante à Sciences Po Paris. Dans son dernier essai, L’Ukraine, de l’indépendance à la guerre (Le Cavalier Bleu éditions, 2021), elle évoque les idées reçues qui trop souvent sous-tendent notre perception de l’Ukraine. Il y a quelques jours, alors qu'elle y était en voyage, elle a accepté de répondre à nos questions.
Alexandra Goujon, que pensez-vous de la couverture médiatique face l’Ukraine ? Pensez-vous que notre compréhension de ce pays, notamment par la reconnaissance d’une communauté de valeurs, est meilleure aujourd’hui ?
La couverture médiatique est dense. Elle se concentre souvent sur les événements les plus immédiats. Mais de nombreux articles ont été publiés sur l’identité et la société ukrainiennes, notamment au début de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022. J’espère que ces articles de fond ont permis d’avoir une meilleure connaissance et surtout d’éviter de se concentrer sur les fractures internes au pays qui étaient le leitmotiv médiatique régulier depuis des années. Une communauté de valeurs s’était déjà formée au moment de Maïdan même si les événements liés à la Révolution de 2013-2014 pouvaient être différemment appréciés. Les idées de liberté, de démocratie et d’État de droit sont largement partagées, ce qui entraîne une différenciation grandissante entre les sociétés ukrainienne et russe, sachant que la Russie est devenue impérialiste mais aussi profondément autoritaire.
Le titre de votre livre établit un lien entre indépendance et guerre. Est-ce que les événements cruciaux des dernières années jusqu’à cette guerre aujourd’hui, tout en la meurtrissant, s’inscrivent pour l’Ukraine dans un processus de consolidation de son identité et de sa souveraineté ?
Le lien entre indépendance et guerre ne s’impose pas de lui-même. Il s’agit d’un processus lié au fait que la Russie n’accepte pas l’indépendance de l’Ukraine. Mais les Ukrainiens n’ont pas voulu la guerre et leur indépendance n’est pas agressive ni menaçante pour la Russie. Aujourd’hui les Ukrainiens sont engagés dans une lutte pour l’indépendance qui est, en effet, meurtrière parce que les dirigeants russes ont décidé de briser cette indépendance par une politique de soumission et d’annexion de parties de leur territoire. La guerre consolide le patriotisme ukrainien parce qu’elle le met à l’épreuve et que la résistance civile et militaire qui s’est exprimée depuis février 2022 témoigne de la force de ce patriotisme.
Craignez-vous que les Occidentaux ne finissent par abandonner les Ukrainiens à leur sort si la guerre se prolonge ?
Les Ukrainiens craignent cet abandon en se référant à l’attitude insuffisamment ferme des Occidentaux après 2014 et l’annexion de la Crimée, mais aussi à l’après Première guerre mondiale où les Occidentaux n’ont pas soutenu l’indépendance de l’État ukrainien. La communication du président ukrainien vise à maintenir l’attention permanente des alliés de l’Ukraine en demandant le maintien des livraisons d’armes et le durcissement des sanctions à l’égard de la Russie. La crainte est également liée à un éventuel relâchement de la position occidentale face à Vladimir Poutine si jamais ce dernier propose un jour une porte de sortie. Les demandes ukrainiennes sont non seulement l’intégrité territoriale, donc le retrait des troupes russes de tout le territoire ukrainien, et des garanties de sécurité pour empêcher une nouvelle invasion russe.
Quelles impressions avez-vous rapportées de votre dernier voyage en Ukraine ?
Je suis allée à Kyiv et à Lviv où la vie suit son cours (bars, restaurants, quelques spectacles, expositions) malgré les bombardements occasionnels et les combats intenses sur la ligne de front. À Kyiv, les habitants subissent des coupures d’électricité qui sont liées aux bombardements des infrastructures par l'armée russe au mois d’octobre et qui sont inégales selon les quartiers mais qui paralysent régulièrement la vie quotidienne. Les rues et les bâtiments ne sont pas éclairés le soir alors que la nuit tombe très tôt. À Lviv, le quotidien des gens est moins sous pression même si les sirènes d’alerte à la bombe sont régulières et, en deux jours (9-10 novembre), les funérailles de quatre soldats ont été organisées.
Vous recevrez un prix pour votre livre le 28 novembre, pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Il s’agit du prix Nathalie Pasternak de l’association Perspectives ukrainiennes, qui vise à récompenser une œuvre qui permet de faire découvrir l’Ukraine en France sous un angle nouveau en sortant des ornières des idées reçues. L’association a été créée en 2008 et cherche à promouvoir l’Ukraine dans toute sa diversité et, depuis février 2022, elle se donne également pour objectif de venir en aide au peuple ukrainien par des actions humanitaires et caritatives. L’ouvrage est également co-lauréat, en 2022, du prix du livre « Mieux comprendre l’Europe » de la fondation Jean Monnet pour l’Europe.

Agrandissement : Illustration 2

« D’hier à aujourd’hui : comprendre l’Ukraine »
24 novembre 19h
Bibliothèque André Malraux, 112 rue de Rennes Paris 6e
Alexandra Goujon dialoguera avec Cédric Gras (prix Albert Londres pour Les Alpinistes de Staline, Stock, « La Bleue », 2020) ce jeudi à la Bibliothèque André-Malraux.
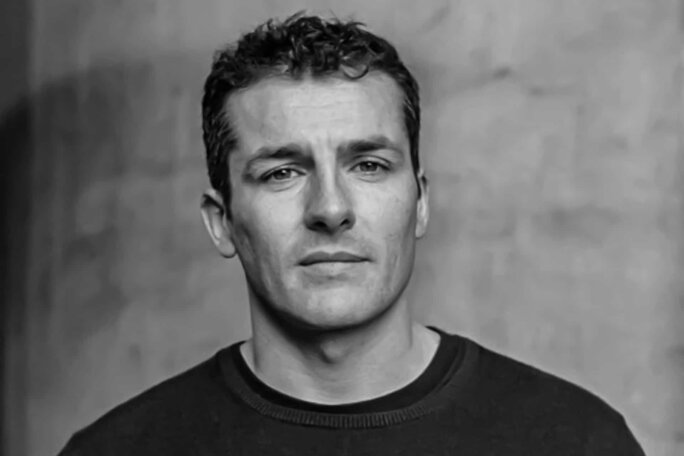
Agrandissement : Illustration 3

Écrivain géographe, grand arpenteur des immensités russes, Cédric Gras est aussi fin connaisseur de l’Ukraine où il a dirigé les Alliances françaises de Donetsk, Kharkiv et Odessa, alors que la guerre grondait dans le Donbass et que le Maïdan s’enflammait. Son premier roman, Anthracite (Stock, 2016), qui donne la voix aux habitants du Donbass en guerre, est d’une brûlante actualité.
Rencontre animée par Lou Héliot, journaliste pour le Le 1 Hebdo.
Tout le programme du festival ici