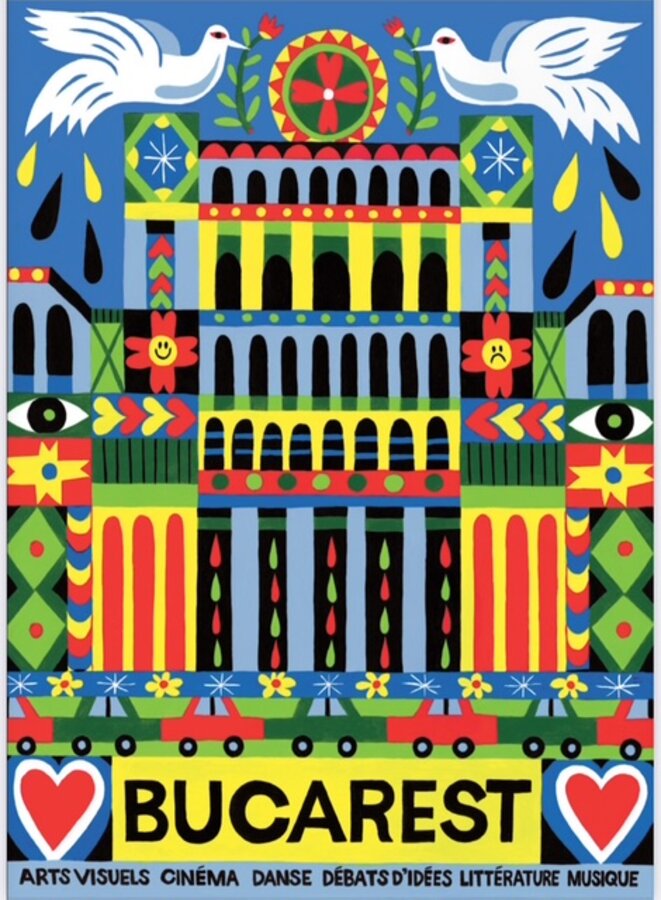Propos recueillis par Olivier Pratte
Dans quelles circonstances avez-vous imaginé « Red Black White » ?
En 2014, j’ai su de la bouche d’un ami que certaines femmes issues de milieux traditionnels et de communautés reculées de l’Arménie apprenaient qu’elles étaient séropositives seulement lorsqu’elles étaient enceintes. Prise d’un sentiment d’injustice, j’ai voulu partir à leur rencontre pour en savoir plus et en faire une série de photos documentaires. J’ai visité une ONG à Erevan, Real World, Real People, fondée par des médecins et des séropositifs.ives venant en aide à ces femmes séropositives et à qui j’ai expliqué ma démarche.
Comment avez-vous été reçue par cet organisme?
J’ai été très bien reçu. L’organisme m’a aidé dans mes recherches et m’a mis en contact avec ces femmes, auprès de qui je suis parti à la rencontre en région et dont les maris avaient passé plusieurs mois de travail en construction ou en agriculture en Russie. Elles faisaient tout juste face à leur diagnostic et découvrait ses implications, une période de leur vie à laquelle j’associe le mot « Black » du nom de mon exposition. Plusieurs tentent de se suicider, d'autres réussissent à le faire. D’autres s’éteignent dans une sorte de silence, ostracisées, étouffées par la honte, une honte vécue à plusieurs niveaux et de laquelle j’ai pu prendre une bonne mesure.
Comment se manifestaient les niveaux de cette honte?
La honte se manifestait à travers le manque d’éducation, d’opportunités, le tabou, la violence, les préjugés, l’opprobre, j’en passe, à travers tout cela en même temps. Par exemple, j’ai rencontré des femmes à qui leur belle-famille donnait des médicaments anti-VIH sans qu’on leur indique de quoi il s’agissait. On leur demandait de les ingurgiter avec un verre d’eau, chaque matin, sans poser de questions, jusqu’au jour où elles devaient accoucher et les questions sont devenues incontournables. Une femme m’a raconté s’être vu refuser le traitement à l’hôpital au moment où elle devait accoucher parce que le corps médical avait peur qu’elle infecte d’autres personnes sur place, ce qui était évidemment injustifié. Même le médecin qui devait la traiter n’avait aucune idée des mécanismes de transmission du VIH. Si on remonte plus loin, depuis une perspective plus folklorique, on peut aussi penser aux mariages anciens en Arménie, par exemple, où l’on offrait à la jeune mariée une poupée et la sommait de se consoler auprès d’elle si ça n’allait pas, sans avoir à exprimer sa douleur plus qu’il n’en fallait.
Est-ce qu’en prenant la mesure de cette honte, vous vous êtes rendue compte que vous alliez y contribuer si vous preniez, comme vous le faites à votre habitude avec vos sujets, des photos des visages de ces femmes?
Oui, j’ai compris que ma méthode plus conventionnelle ne se prêtait pas à ce projet et qu’on ne pouvait identifier ces femmes. Je me suis retrouvée dans une impasse et j’ai presque abandonné mon projet pour de bon. Je ne savais plus comment faire pour visibiliser ces femmes sans pourtant les rendre vraiment visibles. Pour moi, il était important de les aider à se libérer de leur honte tout en ne les exposant pas à plus de préjudices.

Agrandissement : Illustration 1

Et pourtant, vous avez fini par sortir de cette impasse?
Après un moment, j’ai compris qu’il nous fallait, à elles et à moi, un espace sûr dans lequel faire des photos plus conceptuelles, où nous pouvions nous sentir bien. J’ai loué un studio et photographié en ancien moyen format, en couvrant leur visage, mais en montrant des détails malgré tout intimistes, dans une nature morte empreinte du symbolisme qui les a entourées toute leur vie. Par exemple, la pomme rouge symbolise la virginité de la jeune mariée et est offert par les familles au mariage. La table rouge à laquelle la mariée s’affaire presque toute la journée est aussi représentative du sacrifice.

Agrandissement : Illustration 2

Votre travail expose cette nature morte avec beaucoup de beauté, mais est-elle aussi le rappel d’une certaine souffrance?
Autant ces symboles ont nourri une honte, autant offrir à ces femmes la possiblité de s’affirmer au milieu d’eux de cette façon, avec cet esthétisme, sans les exposer ni les étouffeur, a été transformateur. Beaucoup ont pleuré, se sont libérées d’un poids réel.

Agrandissement : Illustration 3

Cette liberté, est-ce qu’elle correspond au « White » du nom de votre expo?
On peut dire cela. C’est la page blanche, le grand horizon. Le nouveau départ.
Nazik Armenakyan en quelques mots
Nazik Armenakyan vit à Erevan. Photographe et cofondatrice du centre de photographie documentaire 4Plus, elle a publié dans de nombreux journaux comme The New York Times, Der Spiegel ou Le Monde.
L’artiste s’intéresse aux groupes sociaux qui vivent en marge de la société arménienne. À partir de 2005, elle a débuté des projets de recherche sur le long terme, dont deux ont donné lieu à des livres : Survivors (2005-2015) sur les survivants du génocide arménien et The Stamp of Loneliness (2010-2013) sur les membres d’une communauté transgenre fermée à Erevan.
La série Red Black White (2021) présentée pour Week-end à l’Est a pour sujet les femmes qui vivent avec le VIH en Arménie. C’est en 2014 que l’artiste a lancé le projet photographique Red Black White en apprenant pour la première fois l’existence de personnes séropositives en Arménie mais surtout en constatant que les femmes contractent le VIH par l’intermédiaire de leurs maris, qui sont pour la plupart des travailleurs migrants : des femmes issues de foyers arméniens ordinaires qui apprennent souvent leur séropositivité alors qu’elles sont déjà enceintes.
Le sujet est devenu encore plus difficile à aborder et plus pénible avec la rencontre de différentes femmes séropositives car leurs témoignages sont à la fois poignants, cruels et émouvants. Nazik Armenakyan s’est alors rendue compte de l’impossibilité de visualiser en tant que documentariste ces femmes et ces mères qui sont obligées de cacher leur état à leurs proches et à la société par crainte d’être victimisées.
L’impossibilité de continuer à travailler sur ce sujet l’a contrainte à y renoncer cependant les relations nouées avec ces femmes, le désir de raconter leur histoire et le nombre croissant de nouveaux cas de VIH/sida chaque année l’ont obligée à reprendre ce travail. C’est pourquoi elle a utilisé toutes les restrictions que ces femmes, et elle-même, connaissaient pour élaborer le concept du projet Red Black White en 2019 et transformer toutes les impossibilités qui couvrent ce sujet en voiles, en tissus et en objets.