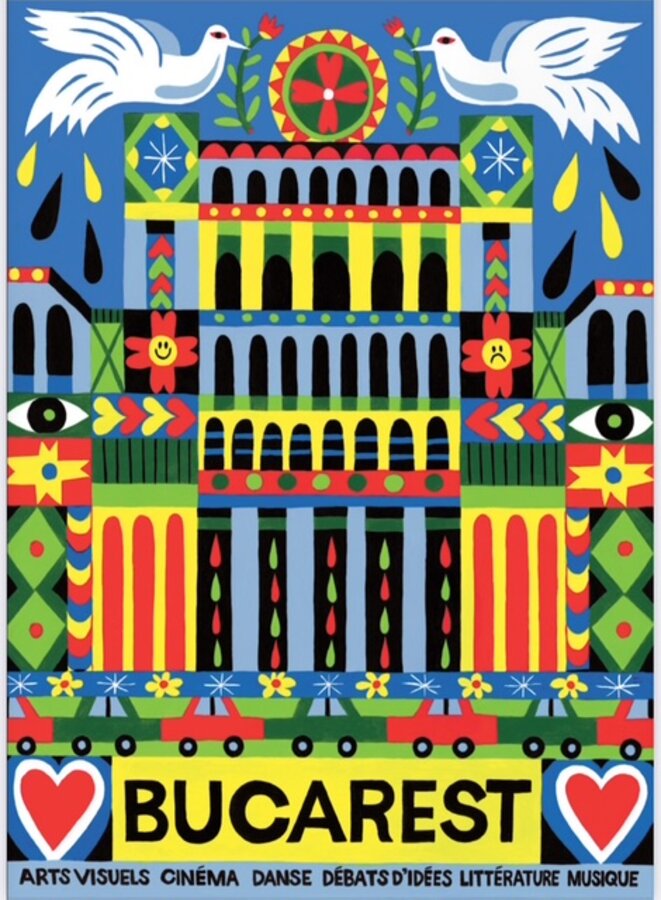Propos recueillis par Olivier Pratte
Est-ce que l’arménien est la langue que vous avez le plus parlée en grandissant? Parliez-vous l’arménien occidental?
Je suis né dans cette langue entourée de quelques dialectes véhiculés par des rescapés du génocide. Ils étaient originaires d'Erzurum, de Mouch, de Gurine, de Césarée et d'autres villes et villages de l'Empire ottoman. L'arménien occidental standard, je l'ai appris à l'école, dans une banlieue de Beyrouth qui n’était ni un camp de réfugiés, ni un ghetto. Elle était plutôt un quartier créé de toutes pièces vers 1930, doté d'une école et d'une église. Cet environnement était déjà bilingue ou trilingue. Parallèlement à l’arménien vernaculaire dans lequel je baignais, j’étais exposé, comme sur palimpseste, aussi bien à l’arabe qu’au turc, et j'écoutais le français et parfois l'hébreu à la radio. Ce plurilinguisme était en moi, bien malgré moi. Mon programme scolaire m’a obligé à apprendre trois alphabets : l'arménien, l'arabe et, pour le français et l'anglais, l'écriture latine. Ce n'était pas facile, mais les enfants possèdent une extraordinaire faculté de réception linguistique.

Agrandissement : Illustration 1

Quelle signification revêt le mot « aujourd’hui » dans le nom de votre masterclass, « écrire en arménien d’occidental aujourd’hui » ? Est-ce que l’arménien occidental serait en perpétuel changement?
« Aujourd’hui » représente ce moment – toujours actuel – où l'arménien occidental parlé dans les communautés du Proche-Orient (j'exclus l'Iran, où les Arméniens parlent l'arménien oriental depuis leur exil du début du XVIIème siècle) devient complètement une langue déterritorialisée. Il n’est plus lié à des lieux déterminés, mais à des lieux déplacés et multipliés avec la migration déjà entamée dans les années 1970. L'arménien occidental est devenue une langue de communication et d'expression littéraire vers le milieu du XIXème siècle, sa « capitale », si on peut le dire ainsi, d’alors étant Constantinople (que l’on connaît aujourd’hui comme Istanbul) de l'Empire ottoman. Sa grammaire fut fixée à cette époque, alors que les dialectes étaient encore vivaces dans les provinces habitées par les Arméniens. Ce sont les évènements de 1915 qui en ont fait une langue rescapée et qui ont éradiqué la plupart des dialectes. Même si son orthographe, sa phonétique et sa grammaire ont été préservés, l’arménien occidental a beaucoup changé en un peu plus d'un siècle. Il suffit de comparer, même d'une manière superficielle, deux moments, celui de l’an 1890 et celui de l'an 2000, pour se rendre compte de sa formidable évolution. Les formules héritées de la langue « classique » ont quasiment disparu, les conjugaisons sont devenues plus régulières, les déclinaisons plus simples (l'arménien est une langue à déclinaisons, comme le latin et le grec ancien), les tournures plus diverses, moins rigides, plus complexes. Depuis 1922, dans un contexte de diaspora, l'arménien occidental est en contact direct avec les langues des pays d'accueil des communautés arméniennes : l'anglais, le français, l'arabe. Cette « épreuve de l'étranger » l'a mise dans un état de crise salutaire. La langue en situation minoritaire ou mineure (au sens deleuzien du terme) se trouve enrichie par la langue majoritaire, les deux se faisant la concurrence. Ce renouvèlement s'est fait avant tout dans la presse, ce lieu privilégié où l'exilé lit les noms des choses du monde auquel il fait face. Faute de réel lexique, rédacteurs et journalistes ont inventé, proposé des néologismes, des calques, des emprunts en se dotant de moyens pour définir non seulement l'environnement social, politique, culturel du monde, mais également pour s'en protéger. La presse arménienne en France a pratiqué une sorte de politique de la langue pendant pratiquement plus d'un siècle. Cette tendance à innover s'est répandue dans toutes les communautés qui s'étaient données une presse écrite. Il faut bien comprendre que c'est la presse qui est toujours aux avant-postes de l'innovation linguistique, dans ce cas précis, d'une langue mineure en situation d'exil, donc non territorialisée.
Dans cette « non territorialité », l’arménien occidental parlé est ainsi sujet au changement d’un lieu à l’autre, par exemple de Beyrouth à Istanbul. Est-ce que vous trouvez que l’arménien occidental écrit est plus « homogène »?
Quand on est en France, à Paris ou ailleurs, le français court les rues, n'est-ce pas? Et ce même si l'anglais-américain n'est pas tout à fait absent, snobisme oblige. En ce sens, l'arménien occidental est l'absent de toute cité. Aujourd’hui, maintenant et nulle part au monde, il ne jouit pas de la visibilité propre aux langues territorialisée. Au Liban, dans certains quartiers, l'arménien occidental se lit sur les enseignes, souvent aux côtés de l'arabe ou de l'anglais. A part ces cas exceptionnels, son statut est celui d'un clandestin. On ne le rencontre que dans certains lieux, à des moments marquants ; on ne le voit écrit que dans des publications « spécialisées » et dans des situations qui n'engagent que les locuteurs de cette langue. C'est à ces moments et dans ces lieux-là que la langue fait son apparition. Comme un animal caché, il montre son museau, se retire, se cache et se dérobe, pour réapparaitre dans l'espace du chez-soi. Ces lieux constituent plusieurs réseaux plus ou moins homogènes, à l'instar des réseaux sociaux.
Quant aux différences entre divers « arméniens occidentaux », elles sont minimes et peu significatives. Elles n'entament pas son « homogénéité », comme vous le dîtes. Ces différences sont dues aux pays, aux cultures, aux langues que les locuteurs arméniens pratiquent ailleurs. Il y a l'impact de la langue où l'on réside. Un impact qui peut parfois toucher des éléments spécifiques à l'arménien occidental. Par exemple, la plupart des arménophones, en France et en Amérique, ignorent carrément ce que la grammaire appelle « les temps du récit » dans la conjugaison. Ils ne comprennent pas l'usage, voire la nécessité d'une telle « déviance ». Ni le français, ni l'anglais, ni l'arménien oriental n'a de temps spécifique pour distinguer une action accomplie en présence du sujet qui en parle d’une action accomplie en son absence. Ces temps du récit qui constituent l'un des plus grands plaisirs de l'écrivain arméno-occidental, sont exclus de l'usage courant. En exil, « l'épreuve de l'étranger » n’apporte donc pas que des bénéfices. Il y a des pertes incommensurables. Cette situation se reflète dans des livres qui continuent à paraitre aussi bien à Istanbul qu'à Glendale. C'est la même langue, mais avec des inflexions différentes. Ici avec une tonalité turquisante, là avec une accentuation nord-américaine.
Est-ce que la littérature arménienne est aussi le reflet d’une « dichotomie » entre l’arménien occidental et l’arménien oriental ? La trouve-t-on dans les deux langues ou majoritairement dans une plutôt que dans une autre?
Les deux langues se sont développées presque en même temps et ont donné lieu à deux littératures différentes, mais parallèles, lisibles et compréhensibles des lecteurs et lectrices des deux côtés. Leurs orientations respectives ont suivi des préférences politiques. La littérature arméno-orientale s’est tournée vers la Russie, tandis que la littérature arméno-occidentale s’est tournée vers l'Europe. La première a perduré dans la République soviétique arménienne après 1920 et depuis dans la République de l'Arménie, la seconde a été relayée par les écrivains de la diaspora dans la configuration géographique qui va du Proche-Orient aux Etats-Unis. Il existe, bien sûr, des différences. Longtemps les valeurs de la « terre » ont été à l’honneur à Erevan, en général plus traditionnaliste et fermée que la diaspora, réputée plus ouverte aux « vents du large ». Mais depuis 1991 et l’indépendance, les choses ont évolué. La nouvelle génération d'écrivain.es en Arménie est avertie et plus concernée par les problèmes et les formes artistiques contemporains. Les rencontres d'écrivain.es des deux bords sont plus fréquentes, aussi bien dans les publications que dans l'espace social, tant ici qu’ailleurs. Les écrivain.es de la diaspora éditent en Arménie (c'est mon cas) et y trouvent un lectorat parfois plus impliqué dans la création. Les lecteurs et lectrices de la diaspora ne sont pas nécessairement intéressés par ce qui se pratique en Arménie, dont ils rejettent l'orthographe « réformée » qui leur semble « barbare ». Malgré quelques tentatives de rapprochement entre les deux langues et les deux littératures, ce que vous appelez « dichotomie », cette brèche séculaire, est loin d'être colmatée. La sera-t-elle jamais? En fait, les deux langues nées d'une même souche, possédant quasiment le même vocabulaire, la même graphie, mais dotées de systèmes phonétiques propres, découpent le réel de manières différentes et impliquent des visions du monde parfois opposées. Une telle différence constitutive ne peut être aisément éradiquée ou dépassée.
Krikor Beledian en quelques mots
Krikor Beledian naît à Beyrouth en 1945, dans le quartier chrétien d'Achrafieh. Auteur de nombreux recueils de poèmes, de récits et d'essais littéraires publiés en arménien occidental, en anglais et en français, il est aussi l'un des principaux traducteurs de la poésie arménienne. Installé en France depuis les années 1970, il est jusqu'à sa retraite en 2012 maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales de Paris (INALCO) et professeur de patrologie et de littérature médiévale arméniennes à la Faculté de Théologie de Lyon.